Lorsque j’ai déclaré en leur compagnie que je soutenais le candidat Bernie Sanders pour la présidentielle, ces élites n’en croyaient pas leurs oreilles, s’étouffant presque comme si j’avais invoqué le diable. Elles sont convaincues que Sanders ne sera jamais élu, ou qu’une telle élection signerait l’effondrement de la république. À des degrés divers, un sentiment comparable s’observe dans des médias même « libéraux » tels que le New York Times et le Washington Post.
Ce mépris est à la fois révélateur et absurde. En Europe, Sanders serait le représentant démocrate social d’un parti de gouvernement. Il entend rétablir une certaine décence dans la vie des Américains : santé universelle publiquement financée ; salaires supérieurs au seuil de pauvreté pour les travailleurs à temps plein, et prestations sociales de base telles que les congés parentaux et maladie ; études universitaires qui ne plongent pas de jeunes adultes dans l’endettement à vie ; élections qui ne peuvent être achetées par des milliardaires ; et politiques publiques déterminées par l’opinion publique plutôt que par le lobbying du monde des affaires (qui a représenté 3,47 milliards $ aux États-Unis en 2019).
L’opinion américaine soutient en grande majorité ces positions. Les Américains attendent du gouvernement qu’il assure une couverture santé pour tous . Ils veulent que les plus fortunés soient davantage imposés . Ils souhaitent une transition vers des énergies renouvelables . Et ils veulent que le pouvoir de l’argent sans limite soit restreint en politique . Ce sont autant de positions essentielles chez Sanders, qui sont couramment défendues en Europe. Pour autant, après chaque victoire de Sanders aux primaires, l’élite aveugle de Wall Street et ses experts favoris voient une énigme dans la réussite électorale d’un candidat aussi « extrémiste » que Sanders.
Une récente interview de l’ancien PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, dans le Financial Times, nous permet de saisir la véritable déconnexion dont fait preuve Wall Street. Blankfein, milliardaire qui perçoit plusieurs dizaines de millions de dollars chaque année, affirme ne pas être riche, mais plutôt « aisé ». Le pire, c’est qu’il le pense sincèrement. Voyez-vous, Blankfein n’est qu’un milliardaire à un chiffre , en cette époque où plus de 50 Américains jouissent d’une fortune nette d’au moins 10 milliards $. L’impression d’être riche ou non dépend de ceux à qui vous vous comparez.
Seulement voilà, on observe ici toute l’ignorance choquante de ces élites (et des médias qui les soutiennent) autour du quotidien de la plupart des Américains. Elles ignorent, voire se moquent, que plusieurs dizaines de millions d’Américains ne disposent d’aucune couverture maladie de base, que les dépenses médicales ruinent environ 500 000 Américains chaque année, ou encore qu’un ménage américain sur cinq possède un patrimoine nul voire négatif, et qu’environ 40 % des citoyens peinent à subvenir à leurs besoins essentiels.
L’élite ne remarque pas non plus que 44 millions d’Américains croulent sous le poids d’une dette étudiante qui représente au total 1 600 milliards $, un phénomène pour l’essentiel inexistant dans les autres pays développés. Et si les marchés boursiers sont en plein essor, s’ils ne cessent d’enrichir les élites, les taux de suicide et le nombre de « morts du désespoir » (liées par exemple aux overdoses d’opiacés) grimpent également en flèche, la classe ouvrière étant plongée dans une insécurité financière et psychologique.
Parmi les raisons de cette méconnaissance de la réalité par les élites, celles-ci n’ont pendant trop longtemps pas été mises en face de leurs responsabilités. Les responsables politiques américains des deux partis agissent comme bon leur semble au moins depuis que le président Ronald Reagan a pris ses fonctions en 1981, puis engendré quatre décennies de réductions d’impôts, de démantèlement syndical, et autres démarches favorables aux ultrariches. Le confort et l’intimité de Wall Street et Washington s’observent parfaitement sur une photographie de 2008 qui circule de nouveau aujourd’hui : Donald Trump, Michael Bloomberg et Bill Clinton jouent une partie de golf, comme s’ils formaient une grande et heureuse famille.
Cette camaraderie de Clinton avec les milliardaires de Wall Street est tout à fait révélatrice. Elle a toujours constitué la norme pour les Républicains depuis le début du XXe siècle. En revanche, cette proximité entre Wall Street et les Démocrates est plus récente. En 1992, alors candidat à la présidentielle, Clinton manœuvre pour rapprocher le Parti démocrate de Goldman Sachs via son coprésident de l’époque, Robert Rubin, qui deviendra plus tard secrétaire du Trésor de Clinton.
Avec le soutien de Wall Street, Clinton remporte la présidence. Dès lors, les deux partis ne cesseront de se tourner vers Wall Street pour le financement de leurs campagnes. Barack Obama suivra la méthode Clinton lors des élections de 2008, et embauchera une fois au pouvoir les collaborateurs de Rubin au sein de son équipe économique.
Wall Street récoltera pleinement les fruits de ses investissements dans les campagnes. Clinton déréglementera en effet les marchés financiers, permettant ainsi l’avènement de géants tels que Citigroup (dont Rubin prendra la direction à sa sortie de la Maison-Blanche). Clinton supprimera également les versements de prestations sociales aux mères célibataires pauvres, ce qui produira des effets dommageables pour les jeunes enfants , tout en élevant l’incarcération de masse des jeunes hommes afro-américains. Pour sa part, Obama donnera largement carte blanche aux banquiers qui provoqueront le krach de 2008. Ceux-ci recevront sauvetages financiers et invitations aux dîners de la Maison-Blanche, plutôt que les peines de prison que nombre d’entre eux auraient méritées.
Fort de l’orgueil démesuré d’un multimilliardaire, l’ancien maire de New York Michael Bloomberg pense pouvoir s’acheter l’investiture démocrate en dépensant 1 milliard $ de sa fortune de 62 milliards $ dans des publicités de campagne, puis vaincre son adversaire milliardaire Donald Trump au mois de novembre. Ici encore, quel parfait exemple de déconnexion avec la réalité. Les perspectives de Bloomberg sont retombées dès lors qu’il est apparu sur la scène du débat aux côtés de Sanders et d’autres candidats démocrates, qui n’ont pas manqué de rappeler aux téléspectateurs le passé républicain de Bloomberg, les accusations d’environnement de travail hostile aux femmes dans ses entreprises, ainsi que son soutien aux techniques policières violentes contre les hommes afro et hispano-américains.
Nul ne doit sous-estimer le déluge d’hystérie que Trump et Wall Street tenteront d’alimenter à l’encontre de Sanders. Trump accuse Sanders de vouloir changer l’Amérique en une sorte de Venezuela, là où le Canada ou le Danemark semblent des comparaisons plus justes. Lors du débat du Nevada, Bloomberg a de manière grotesque qualifié de « communiste » la proposition de Sanders pour une représentation des travailleurs aux conseils d’administration des entreprises, que l’on retrouve dans le système allemand de la codétermination.
Ce sont néanmoins d’autres sujets qui intéressent les Américains : santé, éducation, salaires décents, congé maladie rémunéré, énergies renouvelables, ainsi que fin des réductions d’impôts et mesures d’impunité pour les ultrariches. Autant de sujets qui apparaissent éminemment sensés, et tout simplement universels, dès lors que l’on raisonne au-delà du discours de Wall Street, et qui expliquent pourquoi Sanders remporte aujourd’hui des victoires – et pourquoi pas une victoire en novembre.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Jeffrey D. Sachs, est professeur de développement durable, ainsi que professeur en politique et gestion de la santé à l'Université de Columbia. Il est également directeur du Centre de Columbia pour le développement durable, et directeur du Réseau des solutions pour le développement durable auprès des Nations Unies.
© Project Syndicate 1995–2020
Ce mépris est à la fois révélateur et absurde. En Europe, Sanders serait le représentant démocrate social d’un parti de gouvernement. Il entend rétablir une certaine décence dans la vie des Américains : santé universelle publiquement financée ; salaires supérieurs au seuil de pauvreté pour les travailleurs à temps plein, et prestations sociales de base telles que les congés parentaux et maladie ; études universitaires qui ne plongent pas de jeunes adultes dans l’endettement à vie ; élections qui ne peuvent être achetées par des milliardaires ; et politiques publiques déterminées par l’opinion publique plutôt que par le lobbying du monde des affaires (qui a représenté 3,47 milliards $ aux États-Unis en 2019).
L’opinion américaine soutient en grande majorité ces positions. Les Américains attendent du gouvernement qu’il assure une couverture santé pour tous . Ils veulent que les plus fortunés soient davantage imposés . Ils souhaitent une transition vers des énergies renouvelables . Et ils veulent que le pouvoir de l’argent sans limite soit restreint en politique . Ce sont autant de positions essentielles chez Sanders, qui sont couramment défendues en Europe. Pour autant, après chaque victoire de Sanders aux primaires, l’élite aveugle de Wall Street et ses experts favoris voient une énigme dans la réussite électorale d’un candidat aussi « extrémiste » que Sanders.
Une récente interview de l’ancien PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, dans le Financial Times, nous permet de saisir la véritable déconnexion dont fait preuve Wall Street. Blankfein, milliardaire qui perçoit plusieurs dizaines de millions de dollars chaque année, affirme ne pas être riche, mais plutôt « aisé ». Le pire, c’est qu’il le pense sincèrement. Voyez-vous, Blankfein n’est qu’un milliardaire à un chiffre , en cette époque où plus de 50 Américains jouissent d’une fortune nette d’au moins 10 milliards $. L’impression d’être riche ou non dépend de ceux à qui vous vous comparez.
Seulement voilà, on observe ici toute l’ignorance choquante de ces élites (et des médias qui les soutiennent) autour du quotidien de la plupart des Américains. Elles ignorent, voire se moquent, que plusieurs dizaines de millions d’Américains ne disposent d’aucune couverture maladie de base, que les dépenses médicales ruinent environ 500 000 Américains chaque année, ou encore qu’un ménage américain sur cinq possède un patrimoine nul voire négatif, et qu’environ 40 % des citoyens peinent à subvenir à leurs besoins essentiels.
L’élite ne remarque pas non plus que 44 millions d’Américains croulent sous le poids d’une dette étudiante qui représente au total 1 600 milliards $, un phénomène pour l’essentiel inexistant dans les autres pays développés. Et si les marchés boursiers sont en plein essor, s’ils ne cessent d’enrichir les élites, les taux de suicide et le nombre de « morts du désespoir » (liées par exemple aux overdoses d’opiacés) grimpent également en flèche, la classe ouvrière étant plongée dans une insécurité financière et psychologique.
Parmi les raisons de cette méconnaissance de la réalité par les élites, celles-ci n’ont pendant trop longtemps pas été mises en face de leurs responsabilités. Les responsables politiques américains des deux partis agissent comme bon leur semble au moins depuis que le président Ronald Reagan a pris ses fonctions en 1981, puis engendré quatre décennies de réductions d’impôts, de démantèlement syndical, et autres démarches favorables aux ultrariches. Le confort et l’intimité de Wall Street et Washington s’observent parfaitement sur une photographie de 2008 qui circule de nouveau aujourd’hui : Donald Trump, Michael Bloomberg et Bill Clinton jouent une partie de golf, comme s’ils formaient une grande et heureuse famille.
Cette camaraderie de Clinton avec les milliardaires de Wall Street est tout à fait révélatrice. Elle a toujours constitué la norme pour les Républicains depuis le début du XXe siècle. En revanche, cette proximité entre Wall Street et les Démocrates est plus récente. En 1992, alors candidat à la présidentielle, Clinton manœuvre pour rapprocher le Parti démocrate de Goldman Sachs via son coprésident de l’époque, Robert Rubin, qui deviendra plus tard secrétaire du Trésor de Clinton.
Avec le soutien de Wall Street, Clinton remporte la présidence. Dès lors, les deux partis ne cesseront de se tourner vers Wall Street pour le financement de leurs campagnes. Barack Obama suivra la méthode Clinton lors des élections de 2008, et embauchera une fois au pouvoir les collaborateurs de Rubin au sein de son équipe économique.
Wall Street récoltera pleinement les fruits de ses investissements dans les campagnes. Clinton déréglementera en effet les marchés financiers, permettant ainsi l’avènement de géants tels que Citigroup (dont Rubin prendra la direction à sa sortie de la Maison-Blanche). Clinton supprimera également les versements de prestations sociales aux mères célibataires pauvres, ce qui produira des effets dommageables pour les jeunes enfants , tout en élevant l’incarcération de masse des jeunes hommes afro-américains. Pour sa part, Obama donnera largement carte blanche aux banquiers qui provoqueront le krach de 2008. Ceux-ci recevront sauvetages financiers et invitations aux dîners de la Maison-Blanche, plutôt que les peines de prison que nombre d’entre eux auraient méritées.
Fort de l’orgueil démesuré d’un multimilliardaire, l’ancien maire de New York Michael Bloomberg pense pouvoir s’acheter l’investiture démocrate en dépensant 1 milliard $ de sa fortune de 62 milliards $ dans des publicités de campagne, puis vaincre son adversaire milliardaire Donald Trump au mois de novembre. Ici encore, quel parfait exemple de déconnexion avec la réalité. Les perspectives de Bloomberg sont retombées dès lors qu’il est apparu sur la scène du débat aux côtés de Sanders et d’autres candidats démocrates, qui n’ont pas manqué de rappeler aux téléspectateurs le passé républicain de Bloomberg, les accusations d’environnement de travail hostile aux femmes dans ses entreprises, ainsi que son soutien aux techniques policières violentes contre les hommes afro et hispano-américains.
Nul ne doit sous-estimer le déluge d’hystérie que Trump et Wall Street tenteront d’alimenter à l’encontre de Sanders. Trump accuse Sanders de vouloir changer l’Amérique en une sorte de Venezuela, là où le Canada ou le Danemark semblent des comparaisons plus justes. Lors du débat du Nevada, Bloomberg a de manière grotesque qualifié de « communiste » la proposition de Sanders pour une représentation des travailleurs aux conseils d’administration des entreprises, que l’on retrouve dans le système allemand de la codétermination.
Ce sont néanmoins d’autres sujets qui intéressent les Américains : santé, éducation, salaires décents, congé maladie rémunéré, énergies renouvelables, ainsi que fin des réductions d’impôts et mesures d’impunité pour les ultrariches. Autant de sujets qui apparaissent éminemment sensés, et tout simplement universels, dès lors que l’on raisonne au-delà du discours de Wall Street, et qui expliquent pourquoi Sanders remporte aujourd’hui des victoires – et pourquoi pas une victoire en novembre.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Jeffrey D. Sachs, est professeur de développement durable, ainsi que professeur en politique et gestion de la santé à l'Université de Columbia. Il est également directeur du Centre de Columbia pour le développement durable, et directeur du Réseau des solutions pour le développement durable auprès des Nations Unies.
© Project Syndicate 1995–2020
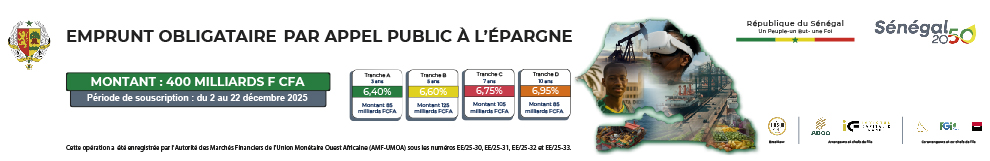

 chroniques
chroniques





















