La réalité est que durant la prochaine décennie, ces nouvelles institutions ne seront pas des prêteurs énormes. Le capital versé par chacune d'elle est de 10 milliards de dollars. Donc même avec un ratio mise de fonds/prêts de 20% (le plancher actuel de la Banque mondiale), chacune sera en mesure de prêter seulement environ 50 milliards de dollars durant la prochaine décennie, à moins qu'elles n'amassent une quantité conséquente d'investissements privés. Ce qui importe, c'est que les grands marchés émergents placent des quantités considérables de capitaux dans des institutions qui seront dominées par la Chine : une indication de leur degré de frustration à l'égard de la Banque mondiale et du FMI.
La Banque mondiale est comme un vieux navire : au bout de sept décennies, toutes sortes de barnacles (rélutions budgétaires et coûts de transaction), se sont accumulées sur sa coque, en diminuant constamment sa vitesse et son efficacité. Au cours de l'exercice 2015, la BEI a prêté plus de deux fois le montant prêté par la Banque, avec seulement un sixième de son effectif. Si l'on mesure les flux (décaissements de prêts) ou le stock (encours), la Banque mondiale a un excédent d'effectif massif, avec un budget administratif beaucoup plus élevé que celui de la BEI.
Lorsque la Banque a été formée, le mécanisme principal de gouvernance était un Conseil d'administration résident qui rendait des comptes à un Conseil d'administration, en général à des ministres des Finances ou à de hautes autorités équivalentes des pays membres. Au fil du temps, les nouveaux bureaux se sont multipliés : un Bureau d'audit interne, un Bureau d'évaluation indépendant, un Comité d'inspection, un Responsable de l'éthique et un Service de déontologie institutionnelle.
La plupart de cette croissance bureaucratique a été le résultat de pressions exercées par les pays développés, qui ont synchronisé leurs efforts avec la reconstitution périodique de l'Association internationale de développement (le guichet concessionnel de la Banque mondiale). Des critiques de la part d'ONG occidentales bien organisées ont mis davantage de pression sur la Banque, en détournant l'attention de tout changement structurel réel dans la gouvernance de l'institution. Et les présidents aguerris de la Banque savent bien que la meilleure façon de détourner la pression politique consiste à renforcer d'autant plus cet arsenal, en le rendant encore plus visible à grand renfort de communication.
Il y a près de deux décennies, il y avait un Médiateur et un Tribunal administratif de la Banque mondiale pour traiter les plaintes internes du personnel. Il y a maintenant tout une panoplie de « Services internes de Justice » : des Conseillers aux relations professionnelles, un Bureau de médiation (qui sera vraisemblablement suivi par un Bureau de la méditation), des Comités d'examen par les pairs, un Bureau de l'éthique et de la déontologie et une Vice-présidence de l'intégrité. Pour paraphraser le comédien Fred Allen, « Sur les navires, on les appelle des barnacles : à la Banque mondiale, ils se cramponnent à un bureau et on les appelle des vice-présidents. » Et après la dernière réorganisation, il y en a plus de deux douzaines.
Pendant ce temps, la culture extrême d'aversion au risque de la Banque reflète une réponse rationnelle aux critiques qui font un énorme tapage de chaque échec d'un projet ou d'un programme. Les critiques qui acceptent sans sourciller les échecs des projets commerciaux trouvent la Banque paresseuse comparée au secteur privé et s'indignent quand ses projets échouent. Pourtant, au lieu de faire valoir le bien-fondé que le risque est intrinsèque au développement économique et de développer un portefeuille de projets équilibré en termes de risques (et d'ajuster les prix de ses prêts en conséquence), la Banque prétend qu'elle peut être infaillible. Par conséquent, le mieux est devenu l'ennemi du bien.
L'aversion au risque va de pair avec des priorités institutionnelles asymétriques, comme en témoigne le budget de la Banque. Au cours de l'exercice 2015, 623 millions de dollars ont été alloués à la « Mobilisation des clients, » tandis que presque 1,5 fois ce montant, soit 931,6 millions de dollars, ont été affectés au service « Institutionnel, gouvernance et administration » (les 600 millions de dollars restants, des « Programmes ou pratiques de gestion, » étant soi-disant affectés à des opérations de prêt). Les dépenses du Conseil d'administration ont représenté à elles seules 87 millions de dollars. La Banque fait un grand battage autour des vertus de la recherche et dépense ensuite presque autant, soit 44 millions de dollars, en « Relations publiques et relations d'affaires. »
Bon nombre des défis que la Banque mondiale doit relever proviennent des pressions exercées sur elle par ses plus gros actionnaires. Parce qu'ils refusent de céder le pouvoir aux petits actionnaires, ou de permettre une augmentation substantielle des ressources pour répondre à des besoins à un niveau beaucoup plus global, les économies émergentes n'ont pas eu d'autre choix que de créer leurs propres institutions.
La Banque mondiale ne va pas disparaître : il y a trop d'intérêts particuliers (dont ceux d'universitaires et d'ONG) qui comptent sur une part de l'argent des autres. Mais la performance de la Banque est un exemple : même les navires bien conçus et bien construits ralentissent quand les barnacles s'accumulent, jusqu'à devoir doivent céder la place à des navires plus récents.
Devesh Kapur est professeur de sciences politiques à l'Université de Pennsylvanie.
© Project Syndicate 1995–2015
La Banque mondiale est comme un vieux navire : au bout de sept décennies, toutes sortes de barnacles (rélutions budgétaires et coûts de transaction), se sont accumulées sur sa coque, en diminuant constamment sa vitesse et son efficacité. Au cours de l'exercice 2015, la BEI a prêté plus de deux fois le montant prêté par la Banque, avec seulement un sixième de son effectif. Si l'on mesure les flux (décaissements de prêts) ou le stock (encours), la Banque mondiale a un excédent d'effectif massif, avec un budget administratif beaucoup plus élevé que celui de la BEI.
Lorsque la Banque a été formée, le mécanisme principal de gouvernance était un Conseil d'administration résident qui rendait des comptes à un Conseil d'administration, en général à des ministres des Finances ou à de hautes autorités équivalentes des pays membres. Au fil du temps, les nouveaux bureaux se sont multipliés : un Bureau d'audit interne, un Bureau d'évaluation indépendant, un Comité d'inspection, un Responsable de l'éthique et un Service de déontologie institutionnelle.
La plupart de cette croissance bureaucratique a été le résultat de pressions exercées par les pays développés, qui ont synchronisé leurs efforts avec la reconstitution périodique de l'Association internationale de développement (le guichet concessionnel de la Banque mondiale). Des critiques de la part d'ONG occidentales bien organisées ont mis davantage de pression sur la Banque, en détournant l'attention de tout changement structurel réel dans la gouvernance de l'institution. Et les présidents aguerris de la Banque savent bien que la meilleure façon de détourner la pression politique consiste à renforcer d'autant plus cet arsenal, en le rendant encore plus visible à grand renfort de communication.
Il y a près de deux décennies, il y avait un Médiateur et un Tribunal administratif de la Banque mondiale pour traiter les plaintes internes du personnel. Il y a maintenant tout une panoplie de « Services internes de Justice » : des Conseillers aux relations professionnelles, un Bureau de médiation (qui sera vraisemblablement suivi par un Bureau de la méditation), des Comités d'examen par les pairs, un Bureau de l'éthique et de la déontologie et une Vice-présidence de l'intégrité. Pour paraphraser le comédien Fred Allen, « Sur les navires, on les appelle des barnacles : à la Banque mondiale, ils se cramponnent à un bureau et on les appelle des vice-présidents. » Et après la dernière réorganisation, il y en a plus de deux douzaines.
Pendant ce temps, la culture extrême d'aversion au risque de la Banque reflète une réponse rationnelle aux critiques qui font un énorme tapage de chaque échec d'un projet ou d'un programme. Les critiques qui acceptent sans sourciller les échecs des projets commerciaux trouvent la Banque paresseuse comparée au secteur privé et s'indignent quand ses projets échouent. Pourtant, au lieu de faire valoir le bien-fondé que le risque est intrinsèque au développement économique et de développer un portefeuille de projets équilibré en termes de risques (et d'ajuster les prix de ses prêts en conséquence), la Banque prétend qu'elle peut être infaillible. Par conséquent, le mieux est devenu l'ennemi du bien.
L'aversion au risque va de pair avec des priorités institutionnelles asymétriques, comme en témoigne le budget de la Banque. Au cours de l'exercice 2015, 623 millions de dollars ont été alloués à la « Mobilisation des clients, » tandis que presque 1,5 fois ce montant, soit 931,6 millions de dollars, ont été affectés au service « Institutionnel, gouvernance et administration » (les 600 millions de dollars restants, des « Programmes ou pratiques de gestion, » étant soi-disant affectés à des opérations de prêt). Les dépenses du Conseil d'administration ont représenté à elles seules 87 millions de dollars. La Banque fait un grand battage autour des vertus de la recherche et dépense ensuite presque autant, soit 44 millions de dollars, en « Relations publiques et relations d'affaires. »
Bon nombre des défis que la Banque mondiale doit relever proviennent des pressions exercées sur elle par ses plus gros actionnaires. Parce qu'ils refusent de céder le pouvoir aux petits actionnaires, ou de permettre une augmentation substantielle des ressources pour répondre à des besoins à un niveau beaucoup plus global, les économies émergentes n'ont pas eu d'autre choix que de créer leurs propres institutions.
La Banque mondiale ne va pas disparaître : il y a trop d'intérêts particuliers (dont ceux d'universitaires et d'ONG) qui comptent sur une part de l'argent des autres. Mais la performance de la Banque est un exemple : même les navires bien conçus et bien construits ralentissent quand les barnacles s'accumulent, jusqu'à devoir doivent céder la place à des navires plus récents.
Devesh Kapur est professeur de sciences politiques à l'Université de Pennsylvanie.
© Project Syndicate 1995–2015
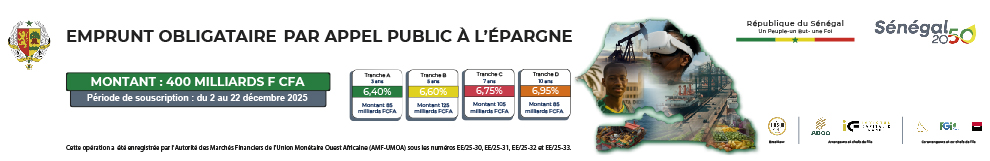

 chroniques
chroniques





















