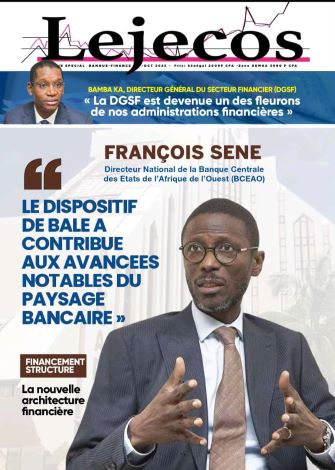Les retombées de la guerre commerciale mercantile de Trump sont particulièrement difficiles pour les pays africains, entravant leurs progrès vers le développement durable et exacerbant les inégalités mondiales existantes. En tant qu'hôte de cet événement historique, le président sud-africain Cyril Ramaphosa cherche à promouvoir les priorités de développement pour l'Afrique et le Sud en général. Compte tenu de la vision du monde transactionnelle et à somme nulle de Trump, ses efforts se heurtent à des vents contraires.
M. Trump brandit ostensiblement des droits de douane pour améliorer la balance commerciale des États-Unis, se plaignant que le monde a "[arnaqué [les États-Unis]]url:https://abcnews.go.com/Politics/theyre-ripping-us-off-trumps-long-standing-grievance/story?id=120447216 "au cours des 40 dernières années. En réalité, les pays les plus exploités par les puissances extérieures se trouvent en Afrique. Pendant des décennies, le continent a toujours été le plus malmené dans les négociations financières et commerciales internationales, par l'intermédiaire du secteur réel et du secteur financier
.
Désavantagé dès le départ
La croissance du commerce africain a été freinée par la combinaison d'une diversification limitée dans les biens de grande valeur, d'infrastructures inadéquates et d'un faible pouvoir de négociation - des inégalités structurelles héritées du passé et renforcées par l'ordre international actuel. Les pays africains sont donc exposés de manière disproportionnée à la volatilité mondiale et à des termes de l'échange défavorables, ce qui entraîne des déficits commerciaux persistants, des crises récurrentes de la balance des paiements et l'augmentation inexorable des dettes extérieures.
Au fil du temps, ces déséquilibres extérieurs, qui découlent de la composition et de l'orientation historiques du commerce africain, ont accentué l'instabilité macroéconomique et faussé la perception des risques, les agences de notation attribuant à la plupart des pays africains des notes inférieures à la qualité d'investissement (junk). Par exemple, bien que S&P Global Ratings ait récemment relevé la dette extérieure à long terme de l'Afrique du Sud, l'économie africaine la plus industrialisée et la plus sophistiquée, pour la première fois depuis une génération, elle reste deux crans en dessous de la catégorie d'investissement. L'affaiblissement et la médiocrité des notations de crédit soumettent les pays africains à des taux d'emprunt et à des risques de refinancement sur les dettes à court terme, qui ont pour effet d'écraser la croissance et d'entraîner des défaillances.
Le fait de payer systématiquement des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les pays plus industrialisés et prospères amplifie l'impact budgétaire de la dette souveraine des pays africains. À la suite de l'annonce par Trump de ses tarifs douaniers du "Liberation Day" le 2 avril, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est passé de moins de 4 % à environ 4,5 %, ce qui a effrayé la Maison-Blanche. Mais cela n'est rien en comparaison des rendements de la dette souveraine de la plupart des pays africains. Le rendement des obligations d'État à dix ans du Nigeria, par exemple, avoisinait les 19 % à la mi-avril.
Ces coûts d'emprunt élevés ont drainé les maigres ressources des pays africains et sapé leurs efforts pour assurer la viabilité des finances publiques et de la dette, créant ainsi un piège financier mortel. Bien que l'encours de la dette extérieure de l'Afrique soit relativement faible (746 milliards de dollars, soit 25 % du revenu national brut du continent), plus d'argent sort aujourd'hui du continent pour le service de la dette qu'il n'en entre par le biais de nouveaux financements et de l'aide au développement. Selon le Programme des Nations unies pour le développement, les pays africains pourraient économiser jusqu'à 74,5 milliards de dollars si les notations de crédit étaient basées sur des évaluations moins subjectives.
Pire encore, les gouvernements africains ont été contraints de se concentrer sur la gestion des crises de balance des paiements à court terme, au détriment de la poursuite d'une politique économique à long terme. Au fil du temps, il est devenu plus difficile d'investir dans les infrastructures porteuses de croissance - tant physiques que numériques - et dans le capital humain, qui sont essentiels pour stimuler la productivité, catalyser la transformation structurelle et créer un cycle vertueux de croissance et de développement.
Un marché déloyal
Faute d'investissements dans ces domaines, les pays africains sont restés en marge de l'économie mondiale, trop dépendants des matières premières et incapables de diversifier leurs sources de croissance. En conséquence, les exportations africaines sont restées lamentablement faibles et sont principalement alimentées par la demande mondiale de matières premières, la part médiane des exportations de produits de base du continent atteignant le chiffre stupéfiant de 90 % - plus élevé que dans toute autre région.
Alors que les secteurs manufacturiers et technologiques à forte valeur ajoutée sont devenus les nouveaux moteurs de la croissance au cours des dernières décennies, la part de l'Afrique dans le commerce mondial n'a cessé de diminuer, passant de 5 % dans les années 1970 à moins de 3 % aujourd'hui. Le continent est également devenu le plus pauvre du monde, près de la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne vivant sous le seuil de pauvreté.
Pour aider l'Afrique à s'intégrer dans l'économie mondiale et à améliorer le niveau de vie sur le continent, le secrétaire général des Nations unies , António Guterres, a appelé à plusieurs reprises à réformer l'architecture financière internationale, qui a entravé le développement de nombreuses économies africaines injustement endettées. Dans le même ordre d'idées, la présidence sud-africaine du G20 cherche à assurer la viabilité de la dette des pays à faible revenu, en réduisant le coût du capital à un niveau qui reflète plus fidèlement le risque réel dans le monde en développement.
Dans ce contexte, les Africains ont réagi à l'affirmation de Trump selon laquelle l'Amérique a été traitée injustement avec incrédulité et dérision. Après tout, la suprématie du dollar dans le commerce et la finance mondiale confère un "privilège exorbitant" aux États-Unis, renforçant la viabilité de leurs déficits et de leur dette. Le "convenience yield " - la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour détenir un actif très liquide et sûr - a maintenu les coûts de financement de la dette américaine à des niveaux historiquement bas. Outre la profondeur et la liquidité de leur marché des capitaux, les États-Unis représentent encore 27 % du PIB mondial, alors que les Américains ne représentent qu'environ 4 % de la population mondiale, et le pays reste un leader mondial en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique, de technologie et d'innovation.
Ces caractéristiques exceptionnelles attirent depuis longtemps les universitaires, les investisseurs et les immigrants aux États-Unis, alimentant l'expansion économique américaine et atténuant les vents contraires démographiques qui ont freiné la croissance dans d'autres pays. Entre 1980 et 2024, le PIB par habitant aux États-Unis (en dollars constants de 2015) est passé de 31 082 dollars à 66 683 dollars, alors que le PIB mondial par habitant n'a augmenté que de 5 899 dollars, pour atteindre 11 876 dollars. En Afrique subsaharienne - où le PIB par habitant de 16 pays était inférieur à 1 000 dollars en 2024 - il n'a augmenté que de 115 dollars pour atteindre 1 601 dollars.
Bien entendu, de nombreuses raisons expliquent cette énorme disparité entre l'Afrique et d'autres régions du monde. La mauvaise gouvernance et les conflits fréquents ont entravé le développement économique du continent, les dépenses militaires augmentant de 22 % entre 2015 et 2024, pour atteindre 52 milliards de dollars, ce qui ne fait qu'aggraver des contraintes budgétaires déjà très fortes. La croissance annuelle dans les pays touchés par les conflits est inférieure d'environ 2,5 points de pourcentage en moyenne, l'impact cumulatif sur le PIB par habitant augmentant au fil du temps.
Mais les inégalités qui caractérisent le commerce et la finance au niveau mondial sont la principale source des piètres performances de l'Afrique en matière de croissance. Le piège de la mort financière, associé aux subventions accordées par les pays riches à des secteurs clés (tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'énergie et la technologie), a encouragé la mauvaise répartition des ressources, sapé la concurrence internationale, étranglé l'industrialisation africaine et perpétué le modèle de développement colonial fondé sur l'extraction des ressources. Les pays africains riches en ressources ont ainsi été relégués au rôle de fournisseurs de matières premières dans un monde où l'industrie manufacturière est le moteur de la croissance à long terme, de la création d'emplois de plus grande valeur et de l'intégration effective dans l'économie mondiale.
Des décennies après que de nombreux pays africains ont obtenu leur indépendance des puissances coloniales, la politique d'extraction des ressources continue de façonner leurs relations avec le reste du monde. Rappelons que le seul voyage de l'ancien président américain Joe Biden en Afrique était centré sur le corridor de Lobito, un projet d'infrastructure soutenu par les États-Unis pour transporter des minéraux essentiels de la ceinture de cuivre d'Afrique centrale, qui chevauche la Zambie et la République démocratique du Congo, jusqu'au port de Lobito en Angola pour l'exportation. Le premier engagement de Trump avec l'Afrique au cours de son second mandat a consisté à obtenir un accord de "paix" en échange de l'accès à des minerais essentiels en RDC.
En raison de la persistance du modèle de développement colonial, les pays africains exportent leurs matières premières et importent ensuite des produits manufacturés à des prix plus élevés, ce qui a des conséquences négatives sur le développement économique régional et la stabilité macroéconomique. En 2023, le déficit commercial du continent s 'est creusé pour atteindre 65,5 milliards de dollars, soit plus du double des 31,1 milliards de dollars enregistrés en 2022. Ce déficit devrait se creuser au fil du temps, car la croissance démographique de l'Afrique stimule la demande de biens importés et les termes de l'échange des produits de base se détériorent.
Un exemple qui illustre bien la position de l'Afrique dans l'ordre économique mondial actuel est la nature et la composition de ses échanges avec l'Inde, troisième partenaire commercial du continent. L'Inde importe du pétrole brut des pays africains producteurs de combustibles fossiles et exporte ensuite des produits pétroliers raffinés vers le continent. Cet "aller-retour" à forte intensité de carbone met en évidence la persistance du modèle de développement colonial de l'extraction des ressources, que les puissances impériales européennes ont d'abord établi et que les acteurs mondiaux ont continué d'exploiter à l'ère de la mondialisation dirigée par les États-Unis.
Pas tous les bateaux
Après la conférence de Bretton Woods de 1944, les États-Unis sont devenus le moteur de la croissance mondiale, tirant parti de leur vaste marché de consommateurs (qui représente toujours environ 30 % de la consommation mondiale) pour façonner les chaînes d'approvisionnement et stimuler la demande de biens intermédiaires et finaux. Cette évolution a commencé en Europe occidentale, où les trois décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont été appelées les trente glorieuses. Plus récemment, le modèle s'est déplacé vers l'Asie, où les économies de marché émergentes ont poursuivi une croissance manufacturière tirée par les exportations et se sont intégrées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, reliant la région à l'Amérique du Nord et à l'Europe.
En fait, l'Amérique a été une marée économique montante qui a soulevé les pays et les régions qui se sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dirigées par les États-Unis. Mais l'Afrique a été reléguée au rôle de fournisseur de ressources naturelles pour d'autres marchés, ce qui a empêché les pays du continent de profiter du potentiel de croissance et de développement offert par le système généralisé de préférences, le programme américain de préférences commerciales, ou la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (African Growth and Opportunity Act), que les États-Unis ont promulguée en 2000 pour permettre aux économies africaines éligibles d'accéder à leur marché en franchise de droits.
Par conséquent, les déséquilibres commerciaux qui obsèdent l'administration Trump concernent en grande partie des pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. En 2024, la Chine, le Japon, le Mexique, le Canada et l'Allemagne représentaient 621,4 milliards de dollars du déficit commercial américain, soit plus de la moitié du total d'environ 1 000 milliards de dollars. Le déficit commercial de l'Afrique avec deux de ces pays - la Chine et l'Allemagne - a dépassé 70 milliards de dollars au cours de la même période.
Malgré cela, les "droits de douane réciproques" de Trump ont ciblé plusieurs pays africains, y compris certains des plus pauvres du monde. Madagascar, par exemple, dont le principal produit d'exportation vers les États-Unis est la vanille brute, a été menacé d'un droit de douane de 47 % le jour de la libération, avant d'être finalement frappé d'un taux de 15 % en août. En 2024, les exportations des 54 pays africains vers les États-Unis totaliseront un peu moins de 40 milliards de dollars, ce qui fait pâle figure par rapport à d'autres régions et souvent par rapport à des pays individuels. Les exportations du Viêt Nam vers les États-Unis, par exemple, ont dépassé 124 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial de 113,1 milliards de dollars.
Si les pays africains et les États-Unis sont confrontés à des déficits commerciaux persistants, les similitudes s'arrêtent là. Les avantages conférés par le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale ne peuvent être surestimés. La demande mondiale d'actifs libellés en dollars permet aux États-Unis d'émettre de la dette à moindre coût et de maintenir une croissance économique robuste.
En revanche, la contrainte de la balance des paiements associée au financement en dollars a imposé une camisole de force anti-croissance aux gouvernements africains, en raison du "péché originel" (l'incapacité d'emprunter en monnaie nationale sur les marchés internationaux) et de la prime de risque qui maintient des taux d'intérêt plus élevés sur leurs obligations souveraines. Les coûts d'emprunt liés aux défauts de paiement ont entravé l'investissement public et augmenté considérablement l'incidence fiscale de la dette extérieure, sapant ainsi les efforts visant à attirer les capitaux privés et à accélérer la diversification des échanges. Dépendants de l'aide et des exportations de matières premières, les pays africains souffrent de stagnation économique et de taux de pauvreté élevés, qui alimentent tous deux les migrations internationales.
L'approche à somme nulle de Trump pour réduire le déficit commercial des États-Unis a déclenché des turbulences sur les marchés obligataires, une dépréciation du dollar et des incertitudes macroéconomiques, augmentant ainsi les risques à court terme pour la croissance mondiale et la stabilité financière. Pour les pays africains déjà menacés par une crise de la dette, ces changements dans la politique commerciale américaine pourraient être le point de basculement : Les droits de douane réduisent leur accès au marché américain, les empêchant d'obtenir les dollars dont ils ont besoin pour financer leurs importations et payer leurs créanciers.
Uniformiser les règles du jeu
Pour remédier à ces disparités, il est nécessaire de procéder à une refonte globale et coordonnée du commerce et de la finance internationaux. M. Guterres s'est fait le champion de cette démarche, exhortant les pays à renforcer leur résistance aux forces de la fragmentation, à favoriser le commerce équitable et à promouvoir un accès équitable au financement. Ces réformes stimuleraient les investissements et favoriseraient les transformations structurelles dans le monde entier, jetant ainsi les bases de la stabilité et d'une prospérité partagée.
La refonte du régime commercial mondial nécessite des changements correspondants dans l'architecture financière internationale. À cette fin, l'Afrique du Sud a mis en place un groupe d'experts du G 20 pendant sa présidence du G20 afin d'examiner les coûts d'emprunt élevés et injustifiés auxquels sont confrontés les pays en développement. Le rapport très attendu du groupe d'experts, qui sera présenté lors du sommet des 22 et 23 novembre, sera l'un des principaux points forts de la présidence sud-africaine du G20, qui a mis l'accent sur l' accès équitable à des financements à long terme abordables.
Des règles de financement plus équitables créeraient l'espace fiscal dont les pays en développement ont besoin pour mener des politiques économiques audacieuses, augmenteraient les flux de capitaux étrangers vers des investissements à plus haut rendement dans les économies à faible revenu, en particulier le développement du capital humain, et limiteraient l'allocation asymétrique des subventions publiques. Un autre avantage de l'égalisation des règles du jeu pourrait être un accès plus large aux technologies d'avant-garde, y compris l'IA qui améliore la productivité. Au fil du temps, cela permettrait aux pays africains et à d'autres économies en développement de tirer parti de leurs capacités intellectuelles pour concevoir une industrialisation basée sur les produits de base et développer la capacité industrielle, améliorant ainsi les résultats en matière de développement humain.
Une telle évolution permettrait également de diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui sont actuellement concentrées sur une poignée de marchés, en particulier en Asie. À mesure qu'un plus grand nombre de pays africains se hissent sur l'échelle de valeur, leur résilience économique sera renforcée et les déséquilibres persistants entre l'offre et la demande intérieures seront atténués. Cela accélérerait la convergence économique et, surtout, ouvrirait la voie à un système multilatéral plus juste et plus représentatif, qui mettrait l'accent sur un développement équitable et inclusif.
La présidence historique de l'Afrique du Sud au sein du G20 a jeté les bases d'une approche plus inclusive de la finance et de la coopération internationales. Maintenir cet élan sera un défi dans notre monde de plus en plus à somme nulle. Mais c'est un défi que les dirigeants du G20 doivent relever - avec ou sans Trump - si la communauté mondiale veut s'attaquer aux déséquilibres macroéconomiques et aux inégalités qui alimentent les pressions migratoires et les tensions géopolitiques.
Hippolyte Fofack, ancien économiste en chef de la Banque africaine d'import-export, est membre du Réseau des solutions pour le développement durable de l'Université de Columbia, chercheur associé au Centre d'études africaines de l'Université de Harvard, membre éminent de la Fédération mondiale des conseils de compétitivité et membre de l'Académie africaine des sciences.
© Project Syndicate 1995–2025
M. Trump brandit ostensiblement des droits de douane pour améliorer la balance commerciale des États-Unis, se plaignant que le monde a "[arnaqué [les États-Unis]]url:https://abcnews.go.com/Politics/theyre-ripping-us-off-trumps-long-standing-grievance/story?id=120447216 "au cours des 40 dernières années. En réalité, les pays les plus exploités par les puissances extérieures se trouvent en Afrique. Pendant des décennies, le continent a toujours été le plus malmené dans les négociations financières et commerciales internationales, par l'intermédiaire du secteur réel et du secteur financier
.
Désavantagé dès le départ
La croissance du commerce africain a été freinée par la combinaison d'une diversification limitée dans les biens de grande valeur, d'infrastructures inadéquates et d'un faible pouvoir de négociation - des inégalités structurelles héritées du passé et renforcées par l'ordre international actuel. Les pays africains sont donc exposés de manière disproportionnée à la volatilité mondiale et à des termes de l'échange défavorables, ce qui entraîne des déficits commerciaux persistants, des crises récurrentes de la balance des paiements et l'augmentation inexorable des dettes extérieures.
Au fil du temps, ces déséquilibres extérieurs, qui découlent de la composition et de l'orientation historiques du commerce africain, ont accentué l'instabilité macroéconomique et faussé la perception des risques, les agences de notation attribuant à la plupart des pays africains des notes inférieures à la qualité d'investissement (junk). Par exemple, bien que S&P Global Ratings ait récemment relevé la dette extérieure à long terme de l'Afrique du Sud, l'économie africaine la plus industrialisée et la plus sophistiquée, pour la première fois depuis une génération, elle reste deux crans en dessous de la catégorie d'investissement. L'affaiblissement et la médiocrité des notations de crédit soumettent les pays africains à des taux d'emprunt et à des risques de refinancement sur les dettes à court terme, qui ont pour effet d'écraser la croissance et d'entraîner des défaillances.
Le fait de payer systématiquement des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les pays plus industrialisés et prospères amplifie l'impact budgétaire de la dette souveraine des pays africains. À la suite de l'annonce par Trump de ses tarifs douaniers du "Liberation Day" le 2 avril, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est passé de moins de 4 % à environ 4,5 %, ce qui a effrayé la Maison-Blanche. Mais cela n'est rien en comparaison des rendements de la dette souveraine de la plupart des pays africains. Le rendement des obligations d'État à dix ans du Nigeria, par exemple, avoisinait les 19 % à la mi-avril.
Ces coûts d'emprunt élevés ont drainé les maigres ressources des pays africains et sapé leurs efforts pour assurer la viabilité des finances publiques et de la dette, créant ainsi un piège financier mortel. Bien que l'encours de la dette extérieure de l'Afrique soit relativement faible (746 milliards de dollars, soit 25 % du revenu national brut du continent), plus d'argent sort aujourd'hui du continent pour le service de la dette qu'il n'en entre par le biais de nouveaux financements et de l'aide au développement. Selon le Programme des Nations unies pour le développement, les pays africains pourraient économiser jusqu'à 74,5 milliards de dollars si les notations de crédit étaient basées sur des évaluations moins subjectives.
Pire encore, les gouvernements africains ont été contraints de se concentrer sur la gestion des crises de balance des paiements à court terme, au détriment de la poursuite d'une politique économique à long terme. Au fil du temps, il est devenu plus difficile d'investir dans les infrastructures porteuses de croissance - tant physiques que numériques - et dans le capital humain, qui sont essentiels pour stimuler la productivité, catalyser la transformation structurelle et créer un cycle vertueux de croissance et de développement.
Un marché déloyal
Faute d'investissements dans ces domaines, les pays africains sont restés en marge de l'économie mondiale, trop dépendants des matières premières et incapables de diversifier leurs sources de croissance. En conséquence, les exportations africaines sont restées lamentablement faibles et sont principalement alimentées par la demande mondiale de matières premières, la part médiane des exportations de produits de base du continent atteignant le chiffre stupéfiant de 90 % - plus élevé que dans toute autre région.
Alors que les secteurs manufacturiers et technologiques à forte valeur ajoutée sont devenus les nouveaux moteurs de la croissance au cours des dernières décennies, la part de l'Afrique dans le commerce mondial n'a cessé de diminuer, passant de 5 % dans les années 1970 à moins de 3 % aujourd'hui. Le continent est également devenu le plus pauvre du monde, près de la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne vivant sous le seuil de pauvreté.
Pour aider l'Afrique à s'intégrer dans l'économie mondiale et à améliorer le niveau de vie sur le continent, le secrétaire général des Nations unies , António Guterres, a appelé à plusieurs reprises à réformer l'architecture financière internationale, qui a entravé le développement de nombreuses économies africaines injustement endettées. Dans le même ordre d'idées, la présidence sud-africaine du G20 cherche à assurer la viabilité de la dette des pays à faible revenu, en réduisant le coût du capital à un niveau qui reflète plus fidèlement le risque réel dans le monde en développement.
Dans ce contexte, les Africains ont réagi à l'affirmation de Trump selon laquelle l'Amérique a été traitée injustement avec incrédulité et dérision. Après tout, la suprématie du dollar dans le commerce et la finance mondiale confère un "privilège exorbitant" aux États-Unis, renforçant la viabilité de leurs déficits et de leur dette. Le "convenience yield " - la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour détenir un actif très liquide et sûr - a maintenu les coûts de financement de la dette américaine à des niveaux historiquement bas. Outre la profondeur et la liquidité de leur marché des capitaux, les États-Unis représentent encore 27 % du PIB mondial, alors que les Américains ne représentent qu'environ 4 % de la population mondiale, et le pays reste un leader mondial en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique, de technologie et d'innovation.
Ces caractéristiques exceptionnelles attirent depuis longtemps les universitaires, les investisseurs et les immigrants aux États-Unis, alimentant l'expansion économique américaine et atténuant les vents contraires démographiques qui ont freiné la croissance dans d'autres pays. Entre 1980 et 2024, le PIB par habitant aux États-Unis (en dollars constants de 2015) est passé de 31 082 dollars à 66 683 dollars, alors que le PIB mondial par habitant n'a augmenté que de 5 899 dollars, pour atteindre 11 876 dollars. En Afrique subsaharienne - où le PIB par habitant de 16 pays était inférieur à 1 000 dollars en 2024 - il n'a augmenté que de 115 dollars pour atteindre 1 601 dollars.
Bien entendu, de nombreuses raisons expliquent cette énorme disparité entre l'Afrique et d'autres régions du monde. La mauvaise gouvernance et les conflits fréquents ont entravé le développement économique du continent, les dépenses militaires augmentant de 22 % entre 2015 et 2024, pour atteindre 52 milliards de dollars, ce qui ne fait qu'aggraver des contraintes budgétaires déjà très fortes. La croissance annuelle dans les pays touchés par les conflits est inférieure d'environ 2,5 points de pourcentage en moyenne, l'impact cumulatif sur le PIB par habitant augmentant au fil du temps.
Mais les inégalités qui caractérisent le commerce et la finance au niveau mondial sont la principale source des piètres performances de l'Afrique en matière de croissance. Le piège de la mort financière, associé aux subventions accordées par les pays riches à des secteurs clés (tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'énergie et la technologie), a encouragé la mauvaise répartition des ressources, sapé la concurrence internationale, étranglé l'industrialisation africaine et perpétué le modèle de développement colonial fondé sur l'extraction des ressources. Les pays africains riches en ressources ont ainsi été relégués au rôle de fournisseurs de matières premières dans un monde où l'industrie manufacturière est le moteur de la croissance à long terme, de la création d'emplois de plus grande valeur et de l'intégration effective dans l'économie mondiale.
Des décennies après que de nombreux pays africains ont obtenu leur indépendance des puissances coloniales, la politique d'extraction des ressources continue de façonner leurs relations avec le reste du monde. Rappelons que le seul voyage de l'ancien président américain Joe Biden en Afrique était centré sur le corridor de Lobito, un projet d'infrastructure soutenu par les États-Unis pour transporter des minéraux essentiels de la ceinture de cuivre d'Afrique centrale, qui chevauche la Zambie et la République démocratique du Congo, jusqu'au port de Lobito en Angola pour l'exportation. Le premier engagement de Trump avec l'Afrique au cours de son second mandat a consisté à obtenir un accord de "paix" en échange de l'accès à des minerais essentiels en RDC.
En raison de la persistance du modèle de développement colonial, les pays africains exportent leurs matières premières et importent ensuite des produits manufacturés à des prix plus élevés, ce qui a des conséquences négatives sur le développement économique régional et la stabilité macroéconomique. En 2023, le déficit commercial du continent s 'est creusé pour atteindre 65,5 milliards de dollars, soit plus du double des 31,1 milliards de dollars enregistrés en 2022. Ce déficit devrait se creuser au fil du temps, car la croissance démographique de l'Afrique stimule la demande de biens importés et les termes de l'échange des produits de base se détériorent.
Un exemple qui illustre bien la position de l'Afrique dans l'ordre économique mondial actuel est la nature et la composition de ses échanges avec l'Inde, troisième partenaire commercial du continent. L'Inde importe du pétrole brut des pays africains producteurs de combustibles fossiles et exporte ensuite des produits pétroliers raffinés vers le continent. Cet "aller-retour" à forte intensité de carbone met en évidence la persistance du modèle de développement colonial de l'extraction des ressources, que les puissances impériales européennes ont d'abord établi et que les acteurs mondiaux ont continué d'exploiter à l'ère de la mondialisation dirigée par les États-Unis.
Pas tous les bateaux
Après la conférence de Bretton Woods de 1944, les États-Unis sont devenus le moteur de la croissance mondiale, tirant parti de leur vaste marché de consommateurs (qui représente toujours environ 30 % de la consommation mondiale) pour façonner les chaînes d'approvisionnement et stimuler la demande de biens intermédiaires et finaux. Cette évolution a commencé en Europe occidentale, où les trois décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont été appelées les trente glorieuses. Plus récemment, le modèle s'est déplacé vers l'Asie, où les économies de marché émergentes ont poursuivi une croissance manufacturière tirée par les exportations et se sont intégrées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, reliant la région à l'Amérique du Nord et à l'Europe.
En fait, l'Amérique a été une marée économique montante qui a soulevé les pays et les régions qui se sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dirigées par les États-Unis. Mais l'Afrique a été reléguée au rôle de fournisseur de ressources naturelles pour d'autres marchés, ce qui a empêché les pays du continent de profiter du potentiel de croissance et de développement offert par le système généralisé de préférences, le programme américain de préférences commerciales, ou la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (African Growth and Opportunity Act), que les États-Unis ont promulguée en 2000 pour permettre aux économies africaines éligibles d'accéder à leur marché en franchise de droits.
Par conséquent, les déséquilibres commerciaux qui obsèdent l'administration Trump concernent en grande partie des pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. En 2024, la Chine, le Japon, le Mexique, le Canada et l'Allemagne représentaient 621,4 milliards de dollars du déficit commercial américain, soit plus de la moitié du total d'environ 1 000 milliards de dollars. Le déficit commercial de l'Afrique avec deux de ces pays - la Chine et l'Allemagne - a dépassé 70 milliards de dollars au cours de la même période.
Malgré cela, les "droits de douane réciproques" de Trump ont ciblé plusieurs pays africains, y compris certains des plus pauvres du monde. Madagascar, par exemple, dont le principal produit d'exportation vers les États-Unis est la vanille brute, a été menacé d'un droit de douane de 47 % le jour de la libération, avant d'être finalement frappé d'un taux de 15 % en août. En 2024, les exportations des 54 pays africains vers les États-Unis totaliseront un peu moins de 40 milliards de dollars, ce qui fait pâle figure par rapport à d'autres régions et souvent par rapport à des pays individuels. Les exportations du Viêt Nam vers les États-Unis, par exemple, ont dépassé 124 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial de 113,1 milliards de dollars.
Si les pays africains et les États-Unis sont confrontés à des déficits commerciaux persistants, les similitudes s'arrêtent là. Les avantages conférés par le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale ne peuvent être surestimés. La demande mondiale d'actifs libellés en dollars permet aux États-Unis d'émettre de la dette à moindre coût et de maintenir une croissance économique robuste.
En revanche, la contrainte de la balance des paiements associée au financement en dollars a imposé une camisole de force anti-croissance aux gouvernements africains, en raison du "péché originel" (l'incapacité d'emprunter en monnaie nationale sur les marchés internationaux) et de la prime de risque qui maintient des taux d'intérêt plus élevés sur leurs obligations souveraines. Les coûts d'emprunt liés aux défauts de paiement ont entravé l'investissement public et augmenté considérablement l'incidence fiscale de la dette extérieure, sapant ainsi les efforts visant à attirer les capitaux privés et à accélérer la diversification des échanges. Dépendants de l'aide et des exportations de matières premières, les pays africains souffrent de stagnation économique et de taux de pauvreté élevés, qui alimentent tous deux les migrations internationales.
L'approche à somme nulle de Trump pour réduire le déficit commercial des États-Unis a déclenché des turbulences sur les marchés obligataires, une dépréciation du dollar et des incertitudes macroéconomiques, augmentant ainsi les risques à court terme pour la croissance mondiale et la stabilité financière. Pour les pays africains déjà menacés par une crise de la dette, ces changements dans la politique commerciale américaine pourraient être le point de basculement : Les droits de douane réduisent leur accès au marché américain, les empêchant d'obtenir les dollars dont ils ont besoin pour financer leurs importations et payer leurs créanciers.
Uniformiser les règles du jeu
Pour remédier à ces disparités, il est nécessaire de procéder à une refonte globale et coordonnée du commerce et de la finance internationaux. M. Guterres s'est fait le champion de cette démarche, exhortant les pays à renforcer leur résistance aux forces de la fragmentation, à favoriser le commerce équitable et à promouvoir un accès équitable au financement. Ces réformes stimuleraient les investissements et favoriseraient les transformations structurelles dans le monde entier, jetant ainsi les bases de la stabilité et d'une prospérité partagée.
La refonte du régime commercial mondial nécessite des changements correspondants dans l'architecture financière internationale. À cette fin, l'Afrique du Sud a mis en place un groupe d'experts du G 20 pendant sa présidence du G20 afin d'examiner les coûts d'emprunt élevés et injustifiés auxquels sont confrontés les pays en développement. Le rapport très attendu du groupe d'experts, qui sera présenté lors du sommet des 22 et 23 novembre, sera l'un des principaux points forts de la présidence sud-africaine du G20, qui a mis l'accent sur l' accès équitable à des financements à long terme abordables.
Des règles de financement plus équitables créeraient l'espace fiscal dont les pays en développement ont besoin pour mener des politiques économiques audacieuses, augmenteraient les flux de capitaux étrangers vers des investissements à plus haut rendement dans les économies à faible revenu, en particulier le développement du capital humain, et limiteraient l'allocation asymétrique des subventions publiques. Un autre avantage de l'égalisation des règles du jeu pourrait être un accès plus large aux technologies d'avant-garde, y compris l'IA qui améliore la productivité. Au fil du temps, cela permettrait aux pays africains et à d'autres économies en développement de tirer parti de leurs capacités intellectuelles pour concevoir une industrialisation basée sur les produits de base et développer la capacité industrielle, améliorant ainsi les résultats en matière de développement humain.
Une telle évolution permettrait également de diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui sont actuellement concentrées sur une poignée de marchés, en particulier en Asie. À mesure qu'un plus grand nombre de pays africains se hissent sur l'échelle de valeur, leur résilience économique sera renforcée et les déséquilibres persistants entre l'offre et la demande intérieures seront atténués. Cela accélérerait la convergence économique et, surtout, ouvrirait la voie à un système multilatéral plus juste et plus représentatif, qui mettrait l'accent sur un développement équitable et inclusif.
La présidence historique de l'Afrique du Sud au sein du G20 a jeté les bases d'une approche plus inclusive de la finance et de la coopération internationales. Maintenir cet élan sera un défi dans notre monde de plus en plus à somme nulle. Mais c'est un défi que les dirigeants du G20 doivent relever - avec ou sans Trump - si la communauté mondiale veut s'attaquer aux déséquilibres macroéconomiques et aux inégalités qui alimentent les pressions migratoires et les tensions géopolitiques.
Hippolyte Fofack, ancien économiste en chef de la Banque africaine d'import-export, est membre du Réseau des solutions pour le développement durable de l'Université de Columbia, chercheur associé au Centre d'études africaines de l'Université de Harvard, membre éminent de la Fédération mondiale des conseils de compétitivité et membre de l'Académie africaine des sciences.
© Project Syndicate 1995–2025
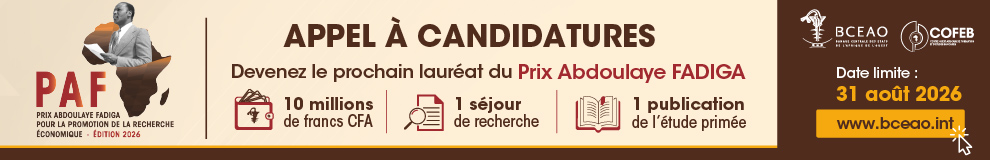

 chroniques
chroniques