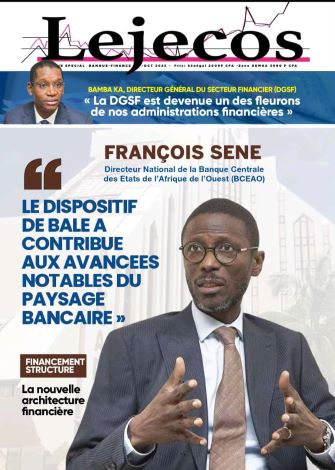La dette publique rapportée au PIB passe de 90,8 % en 2014 à 80,0 % en 2021. Le taux de pression fiscale rapportée au PIB baisse de 18,0 % à 15,9 % dans la même période. Le déficit global (en pourcentage du PIB) s’améliore de –13,3 % à –11,8 %) et le solde extérieur courant suit en s’améliorant de –12,1 % à –10,7 % du PIB. C’est ce qui ressort du Rebasing (Rebasage) national qui consiste en un changement d’année de base des comptes nationaux du Sénégal vers une information économique plus précise en 2025. Un exercice réalisé par l’Agence Nationale de Statistique et de la Démographie (ANSD) qui vise à fournir aux utilisateurs des informations économiques de qualité reflétant au mieux les structures actuelles de l’économie sénégalaise et le niveau des agrégats macroéconomiques.
Par ailleurs, le Rebasing, par nature, permet d’intégrer des activités auparavant mal ou peu couvertes : secteur informel, consommation des ménages, nouvelles branches productives (p.ex. certaines activités minières, services, mobile-money, etc.). De même, on observe une redéfinition de la structure sectorielle : le tertiaire (services) pèse désormais ~53,4 % du PIB, contre 50,5 auparavant ; le secondaire (industrie) recule légèrement, le primaire reste stable. C’est donc plus un rattrapage statistique qu’un « gain économique réel ». En gros, cela donne une image plus large, plus à jour et sans doute plus fidèle de l’économie sénégalaise. Ce qui, sur le papier, renforce la crédibilité des statistiques, améliore les indicateurs de soutenabilité et peut rassurer les partenaires/investisseurs.
Une tendance africaine
Le Sénégal s’inscrit dans une dynamique continentale : le Nigeria avait vu son PIB bondir de 89 % en 2014 ; le Ghana avait enregistré une hausse de plus de 20 % ; plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ont déjà engagé des révisions similaires. Partout, les rebasing ont offert un répit, une amélioration des ratios, un regain de confiance temporaire.
Mais les partenaires internationaux et les investisseurs « ne se font pas avoir », ils n’ont réellement révisé leurs positions que lorsque les gouvernements ont mené des réformes structurelles profondes.
Les marchés savent désormais distinguer rattrapage statistique et progrès économique réel.
L’histoire ne s’écrit pas qu’avec des chiffres
Aux termes des résultats du Rebasing national, l’année-de-base des comptes nationaux est passée de 2014 à 2021, dévoilant une hausse d’environ 13,5 % du PIB qui passe ainsi de 15 261 milliards de Fcfa (2014) à 17 316 milliards FCFA (2021). C’est l’effet mécanique immédiat et politique du rebasing. Du coup, la structure sectorielle est mise à jour, intégrant l’essor du mobile money, des services numériques et des plateformes ; une meilleure mesure du secteur informel, souvent dominant mais invisible ; le poids accru des services, qui représentent désormais plus de 53 % du PIB ; la montée en puissance des ressources naturelles (or, pétrole, gaz).
À première vue, Dakar rejoint ainsi la liste des économies africaines dont la taille réelle était sous-estimée. Mais derrière ce saut comptable, une question essentielle se pose : cette revalorisation traduit-elle une économie réellement plus solide, ou offre-t-elle surtout un répit statistique dans un contexte de fortes tensions macroéconomiques ?
En réalité, ces chiffres ne traduisent pas, loin s’en faut, une économie qui a soudainement grandi de 13,5 % ; c’est juste la mesure de la richesse produite qui s’enrichit.
Pour les bailleurs internationaux, les agences de notation et les marchés obligataires, cette révision peut changer la donne. À un moment où la soutenabilité de la dette du Sénégal suscite des inquiétudes, la nouvelle base offre une bouffée d’air statistique qui pourrait faciliter les discussions en cours avec les partenaires financiers.
Mais attention au mirage statistique : le rebasing ne règle rien en profondeur. La dette reste la dette : aucun franc n’a été remboursé ; le ratio baisse, mais l’encours, lui, reste inchangé ; le service de la dette continue de peser sur les finances publiques, dans un contexte où les échéances des eurobonds s’approchent, les besoins de financement de l’État demeurent élevés, les recettes pétrolières restent encore modestes et volatiles. Pour l’heure, la “détente” est donc plus optique que réelle.
La crédibilité statistique ne remplace pas la nécessité de renforcer la transparence budgétaire, clarifier la gestion des recettes pétro-gazières, améliorer la surveillance parlementaire, rendre publics les comptes et engagements quasi-budgétaires.
Dès lors, l’exercice est certes nécessaire, mais il y a un risque politique réel car, communiquer sur ces “bons” ratios peut masquer des difficultés sous-jacentes — comme des recettes faibles, des dépenses rigides, ou un modèle économique vulnérable. Certains analystes mettent en garde contre une “fraction statistique” présentable, sans impact dans la vie quotidienne.
Pour que cette révision statistique se traduise en gains réels pour la population — emploi, service public, investissement, réduction de la pauvreté, il faut qu’il serve de point de départ à des réformes structurelles : consolidation budgétaire crédible : réduction des dépenses improductives, meilleure hiérarchisation des projets, gestion proactive de la dette ; rendement fiscal renforcé : lutter contre l’évasion, élargir l’assiette, digitaliser le recouvrement, entre autres.
Dans le cas contraire, le Sénégal risque de reproduire le scénario observé dans d’autres pays africains : une économie “plus large” statistiquement, mais pas plus résiliente, ni plus équitable.
Les vrais défis
Le défi n’est pas statistique et le rebasing doit être suivi d’actions concrètes. Par ailleurs, le “nouveau” PIB ne doit pas reposer uniquement sur des secteurs “médiatiquement intégrés” hydrocarbures, mobile-money…), mais sur un tissu économique large et résilient.
En somme, le rebasing 2025 de l’ANSD est un outil de vérité statistique, pas une promesse de prospérité. Tout dépend maintenant des choix de politique économique, de la gestion de la dette, des investissements, et de la gouvernance. Pourvu que les nouveaux chiffres irriguent des politiques audacieuses, crédibles et surtout… efficaces.
L’enjeu désormais est simple : faire du rebasing, un tremplin, et non un écran de fumée. Un test pour la crédibilité économique du Sénégal, et un marqueur du sérieux de sa trajectoire de réformes.
Malick NDAW
Par ailleurs, le Rebasing, par nature, permet d’intégrer des activités auparavant mal ou peu couvertes : secteur informel, consommation des ménages, nouvelles branches productives (p.ex. certaines activités minières, services, mobile-money, etc.). De même, on observe une redéfinition de la structure sectorielle : le tertiaire (services) pèse désormais ~53,4 % du PIB, contre 50,5 auparavant ; le secondaire (industrie) recule légèrement, le primaire reste stable. C’est donc plus un rattrapage statistique qu’un « gain économique réel ». En gros, cela donne une image plus large, plus à jour et sans doute plus fidèle de l’économie sénégalaise. Ce qui, sur le papier, renforce la crédibilité des statistiques, améliore les indicateurs de soutenabilité et peut rassurer les partenaires/investisseurs.
Une tendance africaine
Le Sénégal s’inscrit dans une dynamique continentale : le Nigeria avait vu son PIB bondir de 89 % en 2014 ; le Ghana avait enregistré une hausse de plus de 20 % ; plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ont déjà engagé des révisions similaires. Partout, les rebasing ont offert un répit, une amélioration des ratios, un regain de confiance temporaire.
Mais les partenaires internationaux et les investisseurs « ne se font pas avoir », ils n’ont réellement révisé leurs positions que lorsque les gouvernements ont mené des réformes structurelles profondes.
Les marchés savent désormais distinguer rattrapage statistique et progrès économique réel.
L’histoire ne s’écrit pas qu’avec des chiffres
Aux termes des résultats du Rebasing national, l’année-de-base des comptes nationaux est passée de 2014 à 2021, dévoilant une hausse d’environ 13,5 % du PIB qui passe ainsi de 15 261 milliards de Fcfa (2014) à 17 316 milliards FCFA (2021). C’est l’effet mécanique immédiat et politique du rebasing. Du coup, la structure sectorielle est mise à jour, intégrant l’essor du mobile money, des services numériques et des plateformes ; une meilleure mesure du secteur informel, souvent dominant mais invisible ; le poids accru des services, qui représentent désormais plus de 53 % du PIB ; la montée en puissance des ressources naturelles (or, pétrole, gaz).
À première vue, Dakar rejoint ainsi la liste des économies africaines dont la taille réelle était sous-estimée. Mais derrière ce saut comptable, une question essentielle se pose : cette revalorisation traduit-elle une économie réellement plus solide, ou offre-t-elle surtout un répit statistique dans un contexte de fortes tensions macroéconomiques ?
En réalité, ces chiffres ne traduisent pas, loin s’en faut, une économie qui a soudainement grandi de 13,5 % ; c’est juste la mesure de la richesse produite qui s’enrichit.
Pour les bailleurs internationaux, les agences de notation et les marchés obligataires, cette révision peut changer la donne. À un moment où la soutenabilité de la dette du Sénégal suscite des inquiétudes, la nouvelle base offre une bouffée d’air statistique qui pourrait faciliter les discussions en cours avec les partenaires financiers.
Mais attention au mirage statistique : le rebasing ne règle rien en profondeur. La dette reste la dette : aucun franc n’a été remboursé ; le ratio baisse, mais l’encours, lui, reste inchangé ; le service de la dette continue de peser sur les finances publiques, dans un contexte où les échéances des eurobonds s’approchent, les besoins de financement de l’État demeurent élevés, les recettes pétrolières restent encore modestes et volatiles. Pour l’heure, la “détente” est donc plus optique que réelle.
La crédibilité statistique ne remplace pas la nécessité de renforcer la transparence budgétaire, clarifier la gestion des recettes pétro-gazières, améliorer la surveillance parlementaire, rendre publics les comptes et engagements quasi-budgétaires.
Dès lors, l’exercice est certes nécessaire, mais il y a un risque politique réel car, communiquer sur ces “bons” ratios peut masquer des difficultés sous-jacentes — comme des recettes faibles, des dépenses rigides, ou un modèle économique vulnérable. Certains analystes mettent en garde contre une “fraction statistique” présentable, sans impact dans la vie quotidienne.
Pour que cette révision statistique se traduise en gains réels pour la population — emploi, service public, investissement, réduction de la pauvreté, il faut qu’il serve de point de départ à des réformes structurelles : consolidation budgétaire crédible : réduction des dépenses improductives, meilleure hiérarchisation des projets, gestion proactive de la dette ; rendement fiscal renforcé : lutter contre l’évasion, élargir l’assiette, digitaliser le recouvrement, entre autres.
Dans le cas contraire, le Sénégal risque de reproduire le scénario observé dans d’autres pays africains : une économie “plus large” statistiquement, mais pas plus résiliente, ni plus équitable.
Les vrais défis
Le défi n’est pas statistique et le rebasing doit être suivi d’actions concrètes. Par ailleurs, le “nouveau” PIB ne doit pas reposer uniquement sur des secteurs “médiatiquement intégrés” hydrocarbures, mobile-money…), mais sur un tissu économique large et résilient.
En somme, le rebasing 2025 de l’ANSD est un outil de vérité statistique, pas une promesse de prospérité. Tout dépend maintenant des choix de politique économique, de la gestion de la dette, des investissements, et de la gouvernance. Pourvu que les nouveaux chiffres irriguent des politiques audacieuses, crédibles et surtout… efficaces.
L’enjeu désormais est simple : faire du rebasing, un tremplin, et non un écran de fumée. Un test pour la crédibilité économique du Sénégal, et un marqueur du sérieux de sa trajectoire de réformes.
Malick NDAW


 chroniques
chroniques