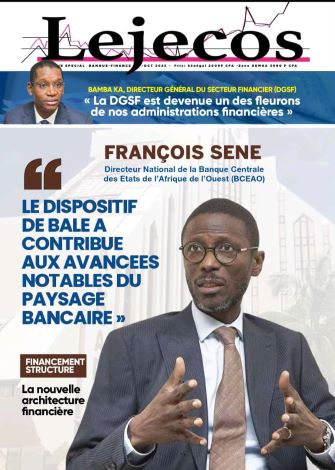Un partenariat plus ciblé sur le développement du secteur manufacturier africain permettrait d’ouvrir une nouvelle page de la coopération sino-africaine.
Les tendances lourdes du commerce entre la Chine et l’Afrique
Le réveil du tigre chinois, qui a atteint son point culminant avec son adhésion à l’OMC en 2001, a complètement redéfini les tendances du commerce mondial. La Chine qui avait été pendant longtemps un pays arriéré, dont l’économie reposait sur des produits de base, est devenue le premier pays exportateur du monde à la veille de la Covid19, avec une part dans les exportations mondiales atteignant les 15,2%, en 2023, contre seulement 0.6% en 1970. Lorsqu’on considère les exportations manufacturières, cette part augmente significativement. D’où l’appellation qui lui a été attribuée « d’usine du monde ». Le niveau de complexité d’une économie s’apprécie souvent à travers la structure de ses exportations. Les produits industriels représentent environ 94% des exportations chinoises, selon les données de l’UnComTrade. Les produits mécaniques et électriques en constituent 42%, soit 396 milliards de dollars, suivis des produits audiovisuels et téléphoniques (310 milliards de dollars), et les ordinateurs et produits dérivés (217 milliards), en 2020. Les données agrégées de la World Integrated Trade Solution, indiquent qu’à la veille de la Covid, les matières premières ne contribuaient que pour 1,58% dans les exportations de la Chine. Ceci n’est pas trivial, car le secteur manufacturier est incontestablement celui qui a le plus de potentiel pour créer des emplois, booster la croissance, et sortir des millions de personnes de la pauvreté. La hausse tendancielle des coûts du travail dans les pays occidentaux a conduit beaucoup de leurs entreprises à se délocaliser dans les pays en développement, où le coût de la main-d’œuvre est réputé plus faible. La Chine en a reçu une part considérable, ce qui en a augmenté d’autant la capacité productive à travers des investissements massifs venant de l’ouest et l’innovation qu’ils incorporaient.
Lorsqu’on regarde de plus près le commerce entre la Chine et l’Afrique, certaines tendances lourdes sautent à l’œil. D’abord, la Chine a progressivement rogné sur les parts de marché des anciens partenaires commerciaux africains, les Occidentaux en particulier, pour devenir le premier partenaire, tant pour les importations que pour les exportations. Ainsi la part de la Chine dans les importations africaines qui étaient marginales en 1990 (moins de 2%) atteint les 16% en 2022. Tandis que les exportations africaines vers la Chine représentent maintenant 20% des exportations totales, contre à peu près 1% en 1990. L’analyse de la structure du commerce sino-africain révèle un contraste plus très frappant : le continent achète de la Chine des produits manufacturés, incorporant des niveaux importants de valeur ajoutée et exporte vers la Chine des produits de base, à très faible valeur ajoutée (produits agricoles, produits miniers, en particulier).
La croissance, les investissements directs étrangers et la dette
Les mêmes tendances qui sont observées au niveau des exportations le sont aussi largement pour les investissements directs étrangers (IDE). La Chine compte pour plus de 12% des flux sortants d’IDE mondiaux, 21% pour les flux entrants d’IDE mondiaux, et 40% des flux totaux, en 2023, contre seulement 7% pour le continent africain. Les investissements chinois en Afrique sont fortement concentrés dans les mines et les infrastructures publiques, essentiellement financées par la dette. Sans surprise, la part de la Chine dans la dette africaine est devenue au fil des ans prépondérante. Elle représentait 20% en 2023, contre 12% en 2019.
Depuis les réformes économiques entreprises par l’empire du Milieu vers la fin des années 70, ses performances de croissance sont devenues des cas d’études dans les manuels d’économie du développement. La Chine est en effet passée d’un taux de croissance moyen annuel d’environ 3,6% dans l’intervalle 1960-1980 à une moyenne de 8,3% dans l’intervalle 1980-2020, soit un doublement du revenu par tête tous les 8 ans. A titre de comparaison, les pays de l’Europe de l’Ouest ont connu des performances beaucoup plus modestes dans leur phases d’émergence respective, ayant suivi la révolution industrielle. La Hollande, la France, et le Royaume Uni, ont en effet, malgré les avancées technologiques liées à la machine à vapeur, au textile, et au charbon, dans un premier temps, et puis ensuite à l’acier, à l’électricité et au chemin de fer, connu des niveaux de croissance du revenu par tête tournant autour de 1% par an. Ce qui fait un doublement du revenu par tête tous les 70 ans ou au-delà !
Pour un renouveau des relations économiques sino-africaines
Les performances économiques de la Chine ne s’arrêtent pas au niveau de la production, du commerce mondial et des IDE, elles s’étendent également au numérique, où elle compte un nombre grandissant de licornes, aux énergies renouvelables, et la recherche-développement, domaines dans lesquels, elle engrange d’importantes parts de marché à ses rivaux occidentaux.
Malgré tout, la Chine risque de faire face très rapidement aux défis que son processus rapide de développement risque de poser à la poursuite de son modèle économique, basée sur l’industrialisation. Le succès d’un pays dans le secteur industriel traditionnel est en effet très fortement dépendant de la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché. Pendant très longtemps, le coût unitaire relatif de la main-d’œuvre (le ratio du salaire en dollar à la productivité), a été largement plus favorable à la Chine qu’à la plupart des pays du monde. Ceci s’explique par un niveau de salaire maitrisé et un niveau de productivité en rapide progression au fil des ans. Avec la hausse soutenue de son niveau de revenu sur plus de 40 ans, le pays réussira de plus en plus difficilement à contenir la pression à la hausse sur les salaires. De plus, l’adoption d’une technologie faisant de plus en plus recours à l’automation, aura tendance à éloigner ses entreprises des procédés de production intensifs en main-d’œuvre au profit de ceux plus intensifs en capital. Au fur et à mesure qu’un pays se développe, en effet, de telles tendances s’amplifient, lui faisant perdre progressivement son avantage comparatif dans le secteur de l’industrie traditionnelle, le seul capable de générer des emplois de manière exponentielle. L’économiste chinois de Peking University, Lin Yifu, et son coauteur camerounais, Célestin Monga, ont consacré beaucoup d’études à cette question émergente et des réflexions sur comment un renouveau des relations sino-africaines pourrait bénéficier aux deux régions du monde, dans un tel contexte.
En effet, malgré les efforts de Pékin pour délocaliser ses activités manufacturières en Afrique, très peu de succès ont été obtenus sur ce front. En dépit de l’abondance de la main-d’œuvre en Afrique, le coût unitaire de la main-d’œuvre reste anormalement élevé dans la plupart des pays africains. Selon nos dernières estimations (Golub, Celowski, Mbaye et Varan, The World Economy 2017), il était de 14,9 au Burundi, 6,5 au Sénégal et 3 en Tanzanie. Cela signifie qu’un travailleur au Burundi coûte presque 15 fois plus cher à son employeur qu’il ne lui rapporte, et plus de 6 fois au Sénégal. L’île Maurice est une notable exception, avec un niveau de coût de seulement 0,8 dans la même période. En Asie, par contre le coût de la main-d’œuvre est beaucoup plus modeste (0,7 en Malaisie et 0,6 en Indonésie, par exemple). Les mêmes obstacles, qui font que les investissements occidentaux ont du mal à pénétrer le marché africain, expliquent également les difficultés de pénétration du marché africain par les investisseurs chinois. Ils ont pour nom : cherté de l’énergie, faible qualité et coûts élevés des services d’infrastructures publiques (port, route, autres), salaires très élevés en comparaison de la productivité du travail, procédures fiscales et douanières erratiques et onéreuses, etc.
Incontestablement, des plages de convergences existent pour le financement d’infrastructures de qualité et le développement de réformes institutionnelles adéquates en Afrique, pour que l’activité manufacturière, très concurrentielle à l’échelle mondiale, puisse enfin décoller en Afrique. Ce qui serait un raccourci pour créer des emplois de masse et sortir de la pauvreté la grande majorité de la population sur le continent.
Ahmadou ALY MBAYE
Professeur d’économie et de politiques publiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Les tendances lourdes du commerce entre la Chine et l’Afrique
Le réveil du tigre chinois, qui a atteint son point culminant avec son adhésion à l’OMC en 2001, a complètement redéfini les tendances du commerce mondial. La Chine qui avait été pendant longtemps un pays arriéré, dont l’économie reposait sur des produits de base, est devenue le premier pays exportateur du monde à la veille de la Covid19, avec une part dans les exportations mondiales atteignant les 15,2%, en 2023, contre seulement 0.6% en 1970. Lorsqu’on considère les exportations manufacturières, cette part augmente significativement. D’où l’appellation qui lui a été attribuée « d’usine du monde ». Le niveau de complexité d’une économie s’apprécie souvent à travers la structure de ses exportations. Les produits industriels représentent environ 94% des exportations chinoises, selon les données de l’UnComTrade. Les produits mécaniques et électriques en constituent 42%, soit 396 milliards de dollars, suivis des produits audiovisuels et téléphoniques (310 milliards de dollars), et les ordinateurs et produits dérivés (217 milliards), en 2020. Les données agrégées de la World Integrated Trade Solution, indiquent qu’à la veille de la Covid, les matières premières ne contribuaient que pour 1,58% dans les exportations de la Chine. Ceci n’est pas trivial, car le secteur manufacturier est incontestablement celui qui a le plus de potentiel pour créer des emplois, booster la croissance, et sortir des millions de personnes de la pauvreté. La hausse tendancielle des coûts du travail dans les pays occidentaux a conduit beaucoup de leurs entreprises à se délocaliser dans les pays en développement, où le coût de la main-d’œuvre est réputé plus faible. La Chine en a reçu une part considérable, ce qui en a augmenté d’autant la capacité productive à travers des investissements massifs venant de l’ouest et l’innovation qu’ils incorporaient.
Lorsqu’on regarde de plus près le commerce entre la Chine et l’Afrique, certaines tendances lourdes sautent à l’œil. D’abord, la Chine a progressivement rogné sur les parts de marché des anciens partenaires commerciaux africains, les Occidentaux en particulier, pour devenir le premier partenaire, tant pour les importations que pour les exportations. Ainsi la part de la Chine dans les importations africaines qui étaient marginales en 1990 (moins de 2%) atteint les 16% en 2022. Tandis que les exportations africaines vers la Chine représentent maintenant 20% des exportations totales, contre à peu près 1% en 1990. L’analyse de la structure du commerce sino-africain révèle un contraste plus très frappant : le continent achète de la Chine des produits manufacturés, incorporant des niveaux importants de valeur ajoutée et exporte vers la Chine des produits de base, à très faible valeur ajoutée (produits agricoles, produits miniers, en particulier).
La croissance, les investissements directs étrangers et la dette
Les mêmes tendances qui sont observées au niveau des exportations le sont aussi largement pour les investissements directs étrangers (IDE). La Chine compte pour plus de 12% des flux sortants d’IDE mondiaux, 21% pour les flux entrants d’IDE mondiaux, et 40% des flux totaux, en 2023, contre seulement 7% pour le continent africain. Les investissements chinois en Afrique sont fortement concentrés dans les mines et les infrastructures publiques, essentiellement financées par la dette. Sans surprise, la part de la Chine dans la dette africaine est devenue au fil des ans prépondérante. Elle représentait 20% en 2023, contre 12% en 2019.
Depuis les réformes économiques entreprises par l’empire du Milieu vers la fin des années 70, ses performances de croissance sont devenues des cas d’études dans les manuels d’économie du développement. La Chine est en effet passée d’un taux de croissance moyen annuel d’environ 3,6% dans l’intervalle 1960-1980 à une moyenne de 8,3% dans l’intervalle 1980-2020, soit un doublement du revenu par tête tous les 8 ans. A titre de comparaison, les pays de l’Europe de l’Ouest ont connu des performances beaucoup plus modestes dans leur phases d’émergence respective, ayant suivi la révolution industrielle. La Hollande, la France, et le Royaume Uni, ont en effet, malgré les avancées technologiques liées à la machine à vapeur, au textile, et au charbon, dans un premier temps, et puis ensuite à l’acier, à l’électricité et au chemin de fer, connu des niveaux de croissance du revenu par tête tournant autour de 1% par an. Ce qui fait un doublement du revenu par tête tous les 70 ans ou au-delà !
Pour un renouveau des relations économiques sino-africaines
Les performances économiques de la Chine ne s’arrêtent pas au niveau de la production, du commerce mondial et des IDE, elles s’étendent également au numérique, où elle compte un nombre grandissant de licornes, aux énergies renouvelables, et la recherche-développement, domaines dans lesquels, elle engrange d’importantes parts de marché à ses rivaux occidentaux.
Malgré tout, la Chine risque de faire face très rapidement aux défis que son processus rapide de développement risque de poser à la poursuite de son modèle économique, basée sur l’industrialisation. Le succès d’un pays dans le secteur industriel traditionnel est en effet très fortement dépendant de la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché. Pendant très longtemps, le coût unitaire relatif de la main-d’œuvre (le ratio du salaire en dollar à la productivité), a été largement plus favorable à la Chine qu’à la plupart des pays du monde. Ceci s’explique par un niveau de salaire maitrisé et un niveau de productivité en rapide progression au fil des ans. Avec la hausse soutenue de son niveau de revenu sur plus de 40 ans, le pays réussira de plus en plus difficilement à contenir la pression à la hausse sur les salaires. De plus, l’adoption d’une technologie faisant de plus en plus recours à l’automation, aura tendance à éloigner ses entreprises des procédés de production intensifs en main-d’œuvre au profit de ceux plus intensifs en capital. Au fur et à mesure qu’un pays se développe, en effet, de telles tendances s’amplifient, lui faisant perdre progressivement son avantage comparatif dans le secteur de l’industrie traditionnelle, le seul capable de générer des emplois de manière exponentielle. L’économiste chinois de Peking University, Lin Yifu, et son coauteur camerounais, Célestin Monga, ont consacré beaucoup d’études à cette question émergente et des réflexions sur comment un renouveau des relations sino-africaines pourrait bénéficier aux deux régions du monde, dans un tel contexte.
En effet, malgré les efforts de Pékin pour délocaliser ses activités manufacturières en Afrique, très peu de succès ont été obtenus sur ce front. En dépit de l’abondance de la main-d’œuvre en Afrique, le coût unitaire de la main-d’œuvre reste anormalement élevé dans la plupart des pays africains. Selon nos dernières estimations (Golub, Celowski, Mbaye et Varan, The World Economy 2017), il était de 14,9 au Burundi, 6,5 au Sénégal et 3 en Tanzanie. Cela signifie qu’un travailleur au Burundi coûte presque 15 fois plus cher à son employeur qu’il ne lui rapporte, et plus de 6 fois au Sénégal. L’île Maurice est une notable exception, avec un niveau de coût de seulement 0,8 dans la même période. En Asie, par contre le coût de la main-d’œuvre est beaucoup plus modeste (0,7 en Malaisie et 0,6 en Indonésie, par exemple). Les mêmes obstacles, qui font que les investissements occidentaux ont du mal à pénétrer le marché africain, expliquent également les difficultés de pénétration du marché africain par les investisseurs chinois. Ils ont pour nom : cherté de l’énergie, faible qualité et coûts élevés des services d’infrastructures publiques (port, route, autres), salaires très élevés en comparaison de la productivité du travail, procédures fiscales et douanières erratiques et onéreuses, etc.
Incontestablement, des plages de convergences existent pour le financement d’infrastructures de qualité et le développement de réformes institutionnelles adéquates en Afrique, pour que l’activité manufacturière, très concurrentielle à l’échelle mondiale, puisse enfin décoller en Afrique. Ce qui serait un raccourci pour créer des emplois de masse et sortir de la pauvreté la grande majorité de la population sur le continent.
Ahmadou ALY MBAYE
Professeur d’économie et de politiques publiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
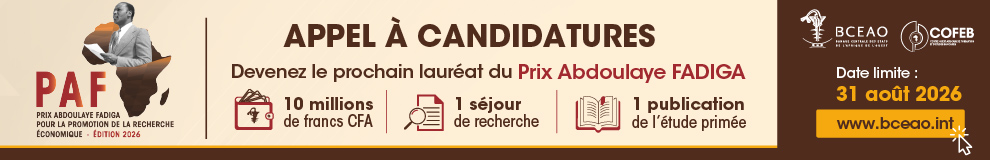

 chroniques
chroniques