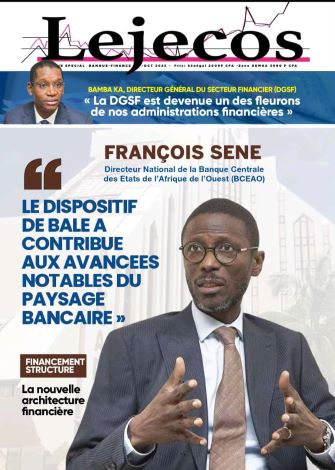Le dernier événement majeur avant la période estivale a eu lieu fin juin, lorsque la communauté internationale s’est réunie à Séville, en Espagne, dans le cadre de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4). Intervenue dans un contexte de crises – fracturation de l’ordre multilatéral, réductions substantielles des budgets d’aide américains et européens, écroulement du système mondial de développement sous le poids de ses propres contradictions – la très attendue FfD4 n’a guère produit d’avancées concernant ces problèmes systémiques.
Cet événement mondial n’est malheureusement pas le seul à avoir déçu, loin de là. Du Sommet de l’avenir de l’ONU jusqu’aux conférences annuelles des Nations Unies sur le changements climatiques, les forums internationaux échouent régulièrement à créer une alternative juste à un système multilatéral aujourd’hui dysfonctionnel, qui se concentre de plus en plus sur les victoires symboliques et les changements progressifs. Le temps est venu pour les dirigeants africains – qui s’expriment lors de ces rencontres, puis regagnent leur pays sans avoir obtenu grand-chose – de renoncer à ce système, et d’en bâtir un nouveau, qui fonctionne pour l’Afrique.
Comme l’ expliquent de nombreux économistes politiques, le sous-développement de l’Afrique n’est pas le reflet d’un manque de potentiel, mais d’une intégration historique injuste dans l’économie mondiale : traite des esclaves, puis colonialisme, et désormais néolibéralisme alimenté par la dette, et dépendance aux aides en provenance de l’étranger.
Moteur de ces systèmes, le capitalisme marchandise les terres, le travail et l’atmosphère même, dans sa quête incessante de nouvelles frontières. À titre d’illustration, plutôt que de s’attaquer aux causes du changement climatique, les marchés du carbone donnent carte blanche aux pays du Nord pour continuer de polluer. L’ordre international actuel n’est pas conçu pour assurer la justice ou promouvoir la durabilité, mais pour préserver des flux de capitaux mondialisés, au travers de formes d’extraction toujours plus abstraites.
La philosophie africaine de l’Ubuntu – « Nous sommes, donc je suis » – pourrait constituer la base d’un système de valeurs radicalement différent, qui aurait pour racines l’attention, la solidarité, la réciprocité et la responsabilité, plutôt que la concurrence et la recherche du profit. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une idéologie économique, ce concept remet en question la logique dominante de l’accumulation, et nous invite à imaginer de nouveaux forums internationaux, qui placeraient l’accent sur le bien-être collectif, la gestion écologique, la sagesse indigène et la dignité commune.
Ce changement de système nécessite que l’Afrique affirme sa capacité d’action, ce qui impose de réviser l’Acte constitutif de l’Union africaine, afin que puisse être délégué un véritable pouvoir décisionnel à la Commission de l’UA, qui est aujourd’hui paralysée par les désaccords entre États membres. La Commission doit être en capacité de définir son propre agenda, ce qui nécessite des financements prévisibles et durables. Sa dépendance actuelle vis-à-vis des donateurs conduit en effet à une fragmentation des programmes.
Enfin, il est nécessaire que l’UA devienne partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, afin de pouvoir agir en tant que bloc continental dans les négociations, plutôt que de se contenter d’assurer une coordination technique. La CCNUCC est en effet la seule plateforme axée sur les dangers du changement climatique, même si les négociations en son sein se révèlent bien souvent inopérantes lorsqu’il s’agit de mise en œuvre et de financement. Il est essentiel qu’une double approche soit adoptée : l’Afrique doit respecter les règles, tout en œuvrant pour la construction d’un système entièrement nouveau, ancré dans les propres valeurs du continent.
Il est également important que soient établies des relations commerciales et financières régionales qui ne dépendent ni de prêts à conditions préférentielles, ni de la bienveillance occidentale. L’état de catastrophe nationale déclaré par le Lesotho au mois de juillet – après l’offensive douanière américaine, et dans un contexte de spéculations autour d’un possible non-renouvellement de la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique – doit servir d’avertissement. Lorsqu’une économie est excessivement dépendante de préférences commerciales unilatérales accordées par un riche État, et qu’elle ne présente pas la diversification essentielle à sa résilience à long terme, cette économie est vulnérable aux changements de politique du gouvernement de cet État – ce qui équivaut en fin de compte à une dépendance aux aides.
Plutôt que de suivre le modèle dominant de la modernisation à l’occidentale, l’Afrique doit viser un nouveau type de développement, ancré dans les valeurs locales. Cela signifie redynamiser les systèmes de connaissance indigènes, notamment en matière de responsabilité et de santé, tout en réaffirmant son indépendance culturelle et linguistique..
Il est nécessaire que les universitaires africains élaborent des modèles sur la base des travaux de Kwame Nkrumah – premier président du Ghana et leader de la libération panafricaine – et de Samir Amin, pionnier de l’économie politique, ainsi que d’autres intellectuels qui ont œuvré pour l’émancipation économique et politique du continent. Le continent a non seulement besoin de ses propres universitaires, mais également de groupes de la société civile indépendants ainsi que d’organisations philanthropiques locales, qui répondent aux aspirations des citoyens africains, plutôt qu’aux agendas des donateurs.
Ce processus, qu’Amin a appelé la « dissociation », n’est pas celui de l’autarcie ou de l’isolement, mais consiste en une redéfinition stratégique des valeurs et des objectifs. En phase avec les principes de l’Ubuntu, il appelle à prendre des décisions économiques fondées sur les priorités et les besoins nationaux, pas sur une logique d’accumulation mondiale de capitaux.
Faire primer les êtres humains sur les bénéfices, l’attention sur la concurrence, et la dignité collective sur la croissance extractive, ce n’est pas faire preuve d’irrationalité – contrairement à ce que l’actuel système multilatéral voudrait nous faire croire. Il ne sera pas facile d’avancer sur ce chemin, qui semblera impraticable, voire naïf. Il n’existe cependant pas d’autre option : il est impossible de réformer l’ordre mondial en l’état actuel des règles. L’Afrique doit oser imaginer et bâtir quelque chose de meilleur.
Martha Bekele est cofondatrice de DevTransform. Arthur Larok est secrétaire général d’ActionAid International.
© Project Syndicate 1995–2025
Cet événement mondial n’est malheureusement pas le seul à avoir déçu, loin de là. Du Sommet de l’avenir de l’ONU jusqu’aux conférences annuelles des Nations Unies sur le changements climatiques, les forums internationaux échouent régulièrement à créer une alternative juste à un système multilatéral aujourd’hui dysfonctionnel, qui se concentre de plus en plus sur les victoires symboliques et les changements progressifs. Le temps est venu pour les dirigeants africains – qui s’expriment lors de ces rencontres, puis regagnent leur pays sans avoir obtenu grand-chose – de renoncer à ce système, et d’en bâtir un nouveau, qui fonctionne pour l’Afrique.
Comme l’ expliquent de nombreux économistes politiques, le sous-développement de l’Afrique n’est pas le reflet d’un manque de potentiel, mais d’une intégration historique injuste dans l’économie mondiale : traite des esclaves, puis colonialisme, et désormais néolibéralisme alimenté par la dette, et dépendance aux aides en provenance de l’étranger.
Moteur de ces systèmes, le capitalisme marchandise les terres, le travail et l’atmosphère même, dans sa quête incessante de nouvelles frontières. À titre d’illustration, plutôt que de s’attaquer aux causes du changement climatique, les marchés du carbone donnent carte blanche aux pays du Nord pour continuer de polluer. L’ordre international actuel n’est pas conçu pour assurer la justice ou promouvoir la durabilité, mais pour préserver des flux de capitaux mondialisés, au travers de formes d’extraction toujours plus abstraites.
La philosophie africaine de l’Ubuntu – « Nous sommes, donc je suis » – pourrait constituer la base d’un système de valeurs radicalement différent, qui aurait pour racines l’attention, la solidarité, la réciprocité et la responsabilité, plutôt que la concurrence et la recherche du profit. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une idéologie économique, ce concept remet en question la logique dominante de l’accumulation, et nous invite à imaginer de nouveaux forums internationaux, qui placeraient l’accent sur le bien-être collectif, la gestion écologique, la sagesse indigène et la dignité commune.
Ce changement de système nécessite que l’Afrique affirme sa capacité d’action, ce qui impose de réviser l’Acte constitutif de l’Union africaine, afin que puisse être délégué un véritable pouvoir décisionnel à la Commission de l’UA, qui est aujourd’hui paralysée par les désaccords entre États membres. La Commission doit être en capacité de définir son propre agenda, ce qui nécessite des financements prévisibles et durables. Sa dépendance actuelle vis-à-vis des donateurs conduit en effet à une fragmentation des programmes.
Enfin, il est nécessaire que l’UA devienne partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, afin de pouvoir agir en tant que bloc continental dans les négociations, plutôt que de se contenter d’assurer une coordination technique. La CCNUCC est en effet la seule plateforme axée sur les dangers du changement climatique, même si les négociations en son sein se révèlent bien souvent inopérantes lorsqu’il s’agit de mise en œuvre et de financement. Il est essentiel qu’une double approche soit adoptée : l’Afrique doit respecter les règles, tout en œuvrant pour la construction d’un système entièrement nouveau, ancré dans les propres valeurs du continent.
Il est également important que soient établies des relations commerciales et financières régionales qui ne dépendent ni de prêts à conditions préférentielles, ni de la bienveillance occidentale. L’état de catastrophe nationale déclaré par le Lesotho au mois de juillet – après l’offensive douanière américaine, et dans un contexte de spéculations autour d’un possible non-renouvellement de la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique – doit servir d’avertissement. Lorsqu’une économie est excessivement dépendante de préférences commerciales unilatérales accordées par un riche État, et qu’elle ne présente pas la diversification essentielle à sa résilience à long terme, cette économie est vulnérable aux changements de politique du gouvernement de cet État – ce qui équivaut en fin de compte à une dépendance aux aides.
Plutôt que de suivre le modèle dominant de la modernisation à l’occidentale, l’Afrique doit viser un nouveau type de développement, ancré dans les valeurs locales. Cela signifie redynamiser les systèmes de connaissance indigènes, notamment en matière de responsabilité et de santé, tout en réaffirmant son indépendance culturelle et linguistique..
Il est nécessaire que les universitaires africains élaborent des modèles sur la base des travaux de Kwame Nkrumah – premier président du Ghana et leader de la libération panafricaine – et de Samir Amin, pionnier de l’économie politique, ainsi que d’autres intellectuels qui ont œuvré pour l’émancipation économique et politique du continent. Le continent a non seulement besoin de ses propres universitaires, mais également de groupes de la société civile indépendants ainsi que d’organisations philanthropiques locales, qui répondent aux aspirations des citoyens africains, plutôt qu’aux agendas des donateurs.
Ce processus, qu’Amin a appelé la « dissociation », n’est pas celui de l’autarcie ou de l’isolement, mais consiste en une redéfinition stratégique des valeurs et des objectifs. En phase avec les principes de l’Ubuntu, il appelle à prendre des décisions économiques fondées sur les priorités et les besoins nationaux, pas sur une logique d’accumulation mondiale de capitaux.
Faire primer les êtres humains sur les bénéfices, l’attention sur la concurrence, et la dignité collective sur la croissance extractive, ce n’est pas faire preuve d’irrationalité – contrairement à ce que l’actuel système multilatéral voudrait nous faire croire. Il ne sera pas facile d’avancer sur ce chemin, qui semblera impraticable, voire naïf. Il n’existe cependant pas d’autre option : il est impossible de réformer l’ordre mondial en l’état actuel des règles. L’Afrique doit oser imaginer et bâtir quelque chose de meilleur.
Martha Bekele est cofondatrice de DevTransform. Arthur Larok est secrétaire général d’ActionAid International.
© Project Syndicate 1995–2025
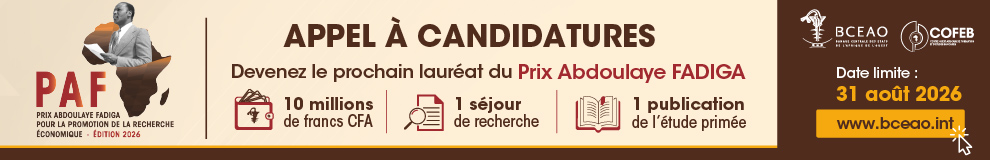

 chroniques
chroniques