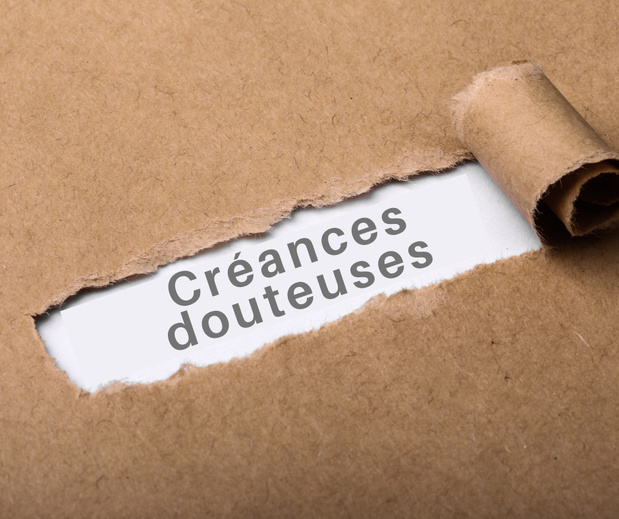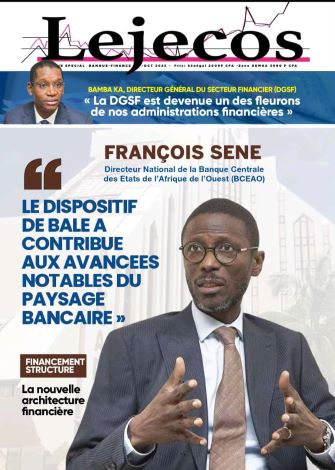Que faire des créances bancaires douteuses (« non performing loans – NPL ») dont le taux dans l’UEMOA tourne autour de 9% en moyenne et près de 16 % au Kenya et dans la CEMAC ? En dépit de la hausse des crédits au sein de l’UMOA, la montée des créances douteuses met à l’épreuve les bilans bancaires, avec un provisionnement moyen de 61,8%, loin des standards. Les banques, coincées entre exigences prudentielles et besoins de liquidités, peinent à relancer le crédit.
La question est prise très au sérieux et l’idée de créer ou renforcer un marché secondaire de ces créances douteuses (elles seraient cédées à des investisseurs spécialisés) pour réduire l’exposition des banques, a réuni régulateurs, investisseurs spécialisés et banques commerciales dans les salons de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS) 2025 à Casablanca (Maroc), pour définir les conditions d’un marché NPL africain dynamique. Le panel intitulé “Créances douteuses : le développement des marchés secondaires, une bouffée d’oxygène pour les banques ?” a ouvert un chantier majeur : la création de marchés africains dédiés au rachat des NPL (non-performing loans).
60 milliards d’actifs
Hadiza Ambursa, Directrice exécutive d’Access Bank Nigeria, a résumé la situation d’une formule saisissante : « Nos bilans portent encore les cicatrices du Covid-19, des chocs inflationnistes et du resserrement monétaire. » Pour elle, le problème n’est plus seulement comptable : il est structurel. « Chaque prêt non recouvré, c’est un entrepreneur en moins financé », dit-elle.
Selon la Banque mondiale, ces créances gelées représentent près de 60 milliards de dollars d’actifs immobilisés à l’échelle du continent. Un fardeau qui bride la transformation économique. D’où la nécessité de créer un marché secondaire pour transformer cette montagne de dettes en levier de relance.
L’idée est simple : permettre à des investisseurs spécialisés – fonds, sociétés de recouvrement, institutions régionales – d’acheter ces portefeuilles de créances à prix décoté, de les gérer ou restructurer et ainsi, de libérer les bilans bancaires. En cédant ces actifs en souffrance dont les ratios sont préoccupants, à des investisseurs privés, comme cela a été fait en Europe après la crise de 2008, les banques seraient susceptibles de réduire leur exposition.
Rowan Gordon, Directeur général du sud-africain Nimble Group, n’y voit pas qu’un instrument technique : « Les NPL ne sont pas des déchets financiers : ce sont des actifs mal gérés. Si on les structure, on peut en extraire de la valeur et redonner de l’air aux banques. »
Pour Cláudia Conceição, directrice régionale à la SFI, « Il y a de l’appétit, mais il manque les fondations ». Marchés encore embryonnaires, manque de transparence sur la qualité des actifs, insécurité juridique : les obstacles sont nombreux.
A la question de comment créer des véhicules d’investissement facilitant la vente et le traitement des créances douteuses ? Comme plusieurs intervenants, Mme Conceição plaide pour la création de “bad banks” régionales ou de fonds spécialisés capables d’absorber les créances les plus risquées et de mutualiser les pertes.
Transparence, valorisation, confiance
Vendre ses créances à perte ? Un sujet explosif pour les banquiers. « Nous devons accepter que céder aujourd’hui à bas prix puisse être un gain collectif demain », reconnaît Felix Egbon, Directeur des risques de Zenith Bank.
Les banques veulent limiter les pertes comptables ; les acheteurs exigent de fortes décotes. Entre les deux, les négociations s’enlisent. Certains experts proposent d’introduire des mécanismes de partage du risque – où les banques conserveraient une partie de la plus-value en cas de recouvrement supérieur aux prévisions – pour réconcilier les deux camps.
De son côté, El-Hassan Kaba, patron de Mansa Bank, met en garde : « Un investisseur ne veut pas devoir comprendre vingt législations différentes. Sans harmonisation des règles, le capital restera à distance. ». Une harmonisation réglementaire entre zones monétaires africaines est ainsi jugée essentielle : sans cadre commun, les investisseurs hésiteront à entrer sur le marché.
Aussi, pour que le mécanisme fonctionne, encore faut-il disposer d’un cadre légal et fiscal capable d’accueillir ces transactions.
Les intervenants ont été unanimes : sans infrastructures juridiques solides ni transparence sur la qualité des portefeuilles, ces marchés ne pourront pas prospérer. L’Afrique doit construire sa propre ingénierie du risque. Pour attirer ces acheteurs, la mise en place de cadres réglementaires appropriés, la réduction des écarts de valorisation et l’amélioration de la transparence des données sont impératifs.
Autre point névralgique : la qualité des données. Les investisseurs réclament des informations fiables sur les portefeuilles : historique des défauts, garanties, procédures en cours. D’où l’appel à une digitalisation accélérée des registres de crédit et à une classification unifiée des NPL.
Le journaliste Julians Amboko, modérateur du panel, a résumé l’esprit du moment : « La data, c’est la nouvelle garantie bancaire. »
Derrière les chiffres, se joue une équation simple : des bilans bancaires saturés : moins de prêts, moins d’investissements, et donc une croissance freinée. « Les banques africaines doivent pouvoir tourner la page de la dette improductive », a résumé un participant. « Sinon, elles resteront prisonnières de leur propre passé », a-t-il poursuivi.
Les obstacles ne sont pas que techniques. Recouvrer une créance reste souvent un parcours judiciaire long et coûteux. Les intervenants ont plaidé pour des procédures extrajudiciaires — médiation, arbitrage, plateformes fintech — capables d’accélérer le recouvrement et d’assainir les relations entre prêteurs et emprunteurs.
Un tournant discret mais décisif
Au-delà du nettoyage comptable, le débat s’inscrit dans une dynamique plus large : celle de la souveraineté financière africaine, thème central de cette édition 2025 de l’AFIS.
En reprenant le contrôle sur leurs bilans, les banques africaines peuvent redevenir des moteurs de financement du développement local plutôt que des gestionnaires de passif.
« Les créances douteuses ne doivent plus être vues comme des poids morts, mais comme des opportunités de réinvention ». Car, derrière chaque prêt en souffrance, il y a une leçon de résilience – et peut-être, demain, la base d’un nouveau cycle de confiance.
Le panel s’est clos sur une évidence : la bataille des NPL est peut-être le chantier le plus stratégique pour l’avenir financier du continent. Ce n’est pas un sujet “sexy”, mais c’est celui qui conditionne tout le reste — du financement climatique à la bancarisation de masse.
L’AFIS 2025 a montré que l’Afrique ne manque ni d’idées ni d’expertise. Ce qu’il lui faut désormais, c’est du courage politique et une architecture commune pour faire circuler le capital à la vitesse du développement.
Malick NDAW, Casablanca
La question est prise très au sérieux et l’idée de créer ou renforcer un marché secondaire de ces créances douteuses (elles seraient cédées à des investisseurs spécialisés) pour réduire l’exposition des banques, a réuni régulateurs, investisseurs spécialisés et banques commerciales dans les salons de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS) 2025 à Casablanca (Maroc), pour définir les conditions d’un marché NPL africain dynamique. Le panel intitulé “Créances douteuses : le développement des marchés secondaires, une bouffée d’oxygène pour les banques ?” a ouvert un chantier majeur : la création de marchés africains dédiés au rachat des NPL (non-performing loans).
60 milliards d’actifs
Hadiza Ambursa, Directrice exécutive d’Access Bank Nigeria, a résumé la situation d’une formule saisissante : « Nos bilans portent encore les cicatrices du Covid-19, des chocs inflationnistes et du resserrement monétaire. » Pour elle, le problème n’est plus seulement comptable : il est structurel. « Chaque prêt non recouvré, c’est un entrepreneur en moins financé », dit-elle.
Selon la Banque mondiale, ces créances gelées représentent près de 60 milliards de dollars d’actifs immobilisés à l’échelle du continent. Un fardeau qui bride la transformation économique. D’où la nécessité de créer un marché secondaire pour transformer cette montagne de dettes en levier de relance.
L’idée est simple : permettre à des investisseurs spécialisés – fonds, sociétés de recouvrement, institutions régionales – d’acheter ces portefeuilles de créances à prix décoté, de les gérer ou restructurer et ainsi, de libérer les bilans bancaires. En cédant ces actifs en souffrance dont les ratios sont préoccupants, à des investisseurs privés, comme cela a été fait en Europe après la crise de 2008, les banques seraient susceptibles de réduire leur exposition.
Rowan Gordon, Directeur général du sud-africain Nimble Group, n’y voit pas qu’un instrument technique : « Les NPL ne sont pas des déchets financiers : ce sont des actifs mal gérés. Si on les structure, on peut en extraire de la valeur et redonner de l’air aux banques. »
Pour Cláudia Conceição, directrice régionale à la SFI, « Il y a de l’appétit, mais il manque les fondations ». Marchés encore embryonnaires, manque de transparence sur la qualité des actifs, insécurité juridique : les obstacles sont nombreux.
A la question de comment créer des véhicules d’investissement facilitant la vente et le traitement des créances douteuses ? Comme plusieurs intervenants, Mme Conceição plaide pour la création de “bad banks” régionales ou de fonds spécialisés capables d’absorber les créances les plus risquées et de mutualiser les pertes.
Transparence, valorisation, confiance
Vendre ses créances à perte ? Un sujet explosif pour les banquiers. « Nous devons accepter que céder aujourd’hui à bas prix puisse être un gain collectif demain », reconnaît Felix Egbon, Directeur des risques de Zenith Bank.
Les banques veulent limiter les pertes comptables ; les acheteurs exigent de fortes décotes. Entre les deux, les négociations s’enlisent. Certains experts proposent d’introduire des mécanismes de partage du risque – où les banques conserveraient une partie de la plus-value en cas de recouvrement supérieur aux prévisions – pour réconcilier les deux camps.
De son côté, El-Hassan Kaba, patron de Mansa Bank, met en garde : « Un investisseur ne veut pas devoir comprendre vingt législations différentes. Sans harmonisation des règles, le capital restera à distance. ». Une harmonisation réglementaire entre zones monétaires africaines est ainsi jugée essentielle : sans cadre commun, les investisseurs hésiteront à entrer sur le marché.
Aussi, pour que le mécanisme fonctionne, encore faut-il disposer d’un cadre légal et fiscal capable d’accueillir ces transactions.
Les intervenants ont été unanimes : sans infrastructures juridiques solides ni transparence sur la qualité des portefeuilles, ces marchés ne pourront pas prospérer. L’Afrique doit construire sa propre ingénierie du risque. Pour attirer ces acheteurs, la mise en place de cadres réglementaires appropriés, la réduction des écarts de valorisation et l’amélioration de la transparence des données sont impératifs.
Autre point névralgique : la qualité des données. Les investisseurs réclament des informations fiables sur les portefeuilles : historique des défauts, garanties, procédures en cours. D’où l’appel à une digitalisation accélérée des registres de crédit et à une classification unifiée des NPL.
Le journaliste Julians Amboko, modérateur du panel, a résumé l’esprit du moment : « La data, c’est la nouvelle garantie bancaire. »
Derrière les chiffres, se joue une équation simple : des bilans bancaires saturés : moins de prêts, moins d’investissements, et donc une croissance freinée. « Les banques africaines doivent pouvoir tourner la page de la dette improductive », a résumé un participant. « Sinon, elles resteront prisonnières de leur propre passé », a-t-il poursuivi.
Les obstacles ne sont pas que techniques. Recouvrer une créance reste souvent un parcours judiciaire long et coûteux. Les intervenants ont plaidé pour des procédures extrajudiciaires — médiation, arbitrage, plateformes fintech — capables d’accélérer le recouvrement et d’assainir les relations entre prêteurs et emprunteurs.
Un tournant discret mais décisif
Au-delà du nettoyage comptable, le débat s’inscrit dans une dynamique plus large : celle de la souveraineté financière africaine, thème central de cette édition 2025 de l’AFIS.
En reprenant le contrôle sur leurs bilans, les banques africaines peuvent redevenir des moteurs de financement du développement local plutôt que des gestionnaires de passif.
« Les créances douteuses ne doivent plus être vues comme des poids morts, mais comme des opportunités de réinvention ». Car, derrière chaque prêt en souffrance, il y a une leçon de résilience – et peut-être, demain, la base d’un nouveau cycle de confiance.
Le panel s’est clos sur une évidence : la bataille des NPL est peut-être le chantier le plus stratégique pour l’avenir financier du continent. Ce n’est pas un sujet “sexy”, mais c’est celui qui conditionne tout le reste — du financement climatique à la bancarisation de masse.
L’AFIS 2025 a montré que l’Afrique ne manque ni d’idées ni d’expertise. Ce qu’il lui faut désormais, c’est du courage politique et une architecture commune pour faire circuler le capital à la vitesse du développement.
Malick NDAW, Casablanca
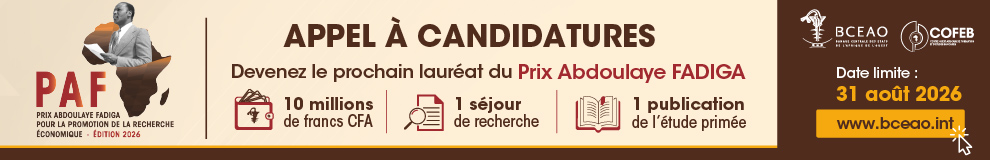

 chroniques
chroniques