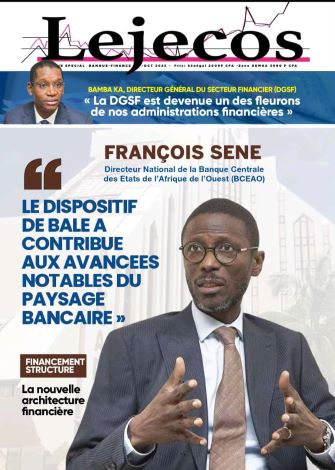La quête de souveraineté financière s’intensifie et pousse certains États africains à envisager de confier leurs réserves de change à des banques commerciales panafricaines (plutôt qu’à des institutions internationales) et de responsabiliser les banques locales dans la couverture du risque de change. Entre volonté d’émancipation et impératif de prudence, le débat sur l’utilisation des réserves de change a atterri dans un panel portant sur la question, dans le cadre de la 5ème édition de l’AFIS à Casablanca (Maroc), et a mis en lumière un dilemme central : comment renforcer l’autonomie financière de nos États sans compromettre la sécurité de leurs fondations monétaires ?
La question est d’autant plus délicate que, même s’il reconnait que « La Banque Centrale assure la gestion intégrale des réserves de change des huit pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), et accorde aux banques commerciales 20 % de leurs recettes en devises étrangères, destinées à leurs opérations avec la clientèle », le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean Claude Kassi Brou, avertit : « Nous pouvons aller plus loin, mais avec des conditions sérieuses. »
Le sujet est « crucial » pour Ini Ebong, Manager de la First Bank of Nigeria. Pour lui, « Investir les réserves par les banques commerciales c’est très important, mais les régulateurs auront la responsabilité de bien surveiller la faisabilité. » Yamungu Kayandabila , Deputy Governor Bank of Tanzania, lui , semble plus optimiste en déclarant « Nous faisons confiance aux banques locales », mais Jean Pierre Godeme , Chairman et Ceo de Madupay, tempére et estime qu’ « il ya un besoin de réglementation robuste et une bonne gouvernance est une condition sine qua non ». On prend dés lors , que ces ressources sont les bienvenues pour le banques commerciales, mais la question fondamentale est : les banques commerciales africaines ont -elles la capacité, la liquidité, la gouvernance et les garanties nécessaires pour gérer des réserves de change souveraines ?
Pour mémoire, depuis des décennies, la majorité des États africains déposent leurs réserves de change dans des banques centrales étrangères, principalement en Europe et aux États-Unis. Cette pratique, héritée des structures coloniales garantit la sécurité et la liquidité, mais prive l’Afrique d’un levier financier considérable. Selon la Banque africaine de développement , le continent détient plus de 430 milliards de dollars de réserves de change , pour la plupart hors du continent. Une épargne dormante, alors même que les besoins de financement interne explosent.
Un double défi
Le panel a cependant exprimé des doutes, car les normes de crédit, de gestion d’actifs, de transparence et de couverture de change sont élevées. Un double défie se pose, alors. Il faudra construire ou renforcer un cadre de supervision et de règlementation (compliance, reporting, contrôle des risques) pour permettre à ces banques de gérer des réserves de manière fiable ; il faudra également assurer que le rôle ne crée pas de conflit d’intérêts ou ne fragilise pas le système bancaire domestique (par exemple en exposant la banque commerciale à des risques souverains élevés) — ce que le panel a appelé « soulever la question de la frontière entre banque commerciale et gestion d’actifs souverains ».
Par ailleurs, le transfert ou la domiciliation des réserves en Afrique doit être accompagné de mécanismes de gestion efficace du risque de contrepartie, du risque de change, et de la liquidité. Si la banque ne peut pas rapidement convertir ou mobiliser les actifs en cas de crise, cela pourrait poser un grave problème. En outre, le panel souligne que cela ne doit pas être perçu comme un remplacement immédiat, mais plutôt comme un complément ou une hybridation : garder une partie dans des banques africaines, tout en maintenant un accès à des institutions de réserve internationales pour certains besoins.
Enfin, les membres du panel ont insisté sur la nécessité de « pooler » les réserves (Un pool de liquidité est une collection de fonds bloqués dans un contrat intelligent sur un réseau financier décentralisé (DeFi)), de développer des swaps régionaux (Un swap de devises, ou cross-currency swap, est un contrat entre deux parties visant à échanger des paiements d’intérêts et des montants en capital dans deux devises différentes, selon un taux de change prédéfini) et d’utiliser des infrastructures comme le Pan‑African Payment and Settlement System (PAPSS) pour renforcer la liquidité intra-africaine et la gestion des devises.
En somme, pour un État envisageant de confier une partie de ses réserves à une banque commerciale panafricaine, les grandes lignes à retenir sont d’abord de s’assurer que la banque choisie répond à des critères solides de gestion des actifs, de liquidité et de supervision. Le transfert doit s’inscrire dans une stratégie plus large d’utilisation productive des réserves : par exemple les mobiliser pour l’investissement domestique, la stabilité monétaire, ou des mécanismes de swap régionaux ; il est aussi nécessaire de revoir les cadres réglementaires nationaux pour autoriser et encadrer ce type de domiciliation de réserves dans des banques commerciales, en intégrant des garanties, des clauses de liquidité, de reporting, etc.
Entre audace et prudence
Les réserves de change ne sont pas de simples dépôts dormants : elles sont la garantie de stabilité financière d’un pays, son bouclier contre les chocs externes et les crises monétaires. Confier leur gestion à des banques locales — souvent moins capitalisées, plus exposées au risque politique ou de liquidité — pourrait fragiliser la confiance des partenaires internationaux et des marchés.
Les économistes , plus prudents rappellent que la souveraineté n’a de sens que si elle s’appuie sur une infrastructure solide. Les réserves de change sont une ligne de défense stratégique. Les confier à des banques locales, souvent vulnérables aux fluctuations politiques, aux faillites ou à la mauvaise gouvernance, pourrait créer un risque systémique.
Entre audace et prudence, une solution intermédiaire semble se dessiner et certains suggèrent la création de fonds souverains africains, à l’image de ceux du Botswana ou du Nigéria, capables d’investir une portion des réserves dans des projets rentables tout en maintenant la discipline monétaire.
Ainsi, la question n’est peut-être pas de savoir où placer les réserves, mais comment les gérer pour concilier souveraineté, rendement et sécurité. Car une chose est sûre : la véritable indépendance financière de l’Afrique ne se décrète pas, elle se construit dans la rigueur, la transparence et la confiance.
Une autre lecture
En 2024, les réserves de change de l’UEMOA (gérées par la BCEAO) ont été estimées à 13 514 milliards de FCFA (23,4 milliards USD) soit une hausse de +42 % par rapport à l’année précédente. Concernant l’or, les réserves de la BCEAO en métal auraient atteint 2 531,8 milliards de FCFA à fin 2024, soit une hausse notable par rapport à l’année précédente.
Si le débat autour de la gestion locale des réserves de change divise, il prend une résonance encore plus particulière au Sénégal. Même si l’idée de confier une partie des réserves de change aux banques locales semble séduisante, elle se heurte à une réalité structurelle : le système bancaire national est largement dominé par des groupes étrangers.
Autrement dit, “relocaliser” les réserves reviendrait, dans les faits, à les placer sous gestion de filiales dont le centre de décision se trouve à Casablanca, Paris ou Lagos.
« Ce serait une souveraineté de façade », confie un économiste. Selon lui, « Tant que les institutions de dépôt ne sont pas véritablement nationales, transférer les réserves au niveau local ne changera pas la dépendance stratégique. On déplacerait les fonds sans rapatrier le pouvoir. »
Dans un tel contexte, le risque serait double : celui d’exposer une ressource critique à des acteurs eux-mêmes vulnérables, et celui de perdre l’argument de stabilité qui fonde la crédibilité monétaire du pays.
La véritable souveraineté ne viendra donc pas d’un transfert symbolique, mais d’un renforcement des capacités institutionnelles et du capital local au sein du système bancaire.
Malick NDAW, Casablanca
La question est d’autant plus délicate que, même s’il reconnait que « La Banque Centrale assure la gestion intégrale des réserves de change des huit pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), et accorde aux banques commerciales 20 % de leurs recettes en devises étrangères, destinées à leurs opérations avec la clientèle », le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean Claude Kassi Brou, avertit : « Nous pouvons aller plus loin, mais avec des conditions sérieuses. »
Le sujet est « crucial » pour Ini Ebong, Manager de la First Bank of Nigeria. Pour lui, « Investir les réserves par les banques commerciales c’est très important, mais les régulateurs auront la responsabilité de bien surveiller la faisabilité. » Yamungu Kayandabila , Deputy Governor Bank of Tanzania, lui , semble plus optimiste en déclarant « Nous faisons confiance aux banques locales », mais Jean Pierre Godeme , Chairman et Ceo de Madupay, tempére et estime qu’ « il ya un besoin de réglementation robuste et une bonne gouvernance est une condition sine qua non ». On prend dés lors , que ces ressources sont les bienvenues pour le banques commerciales, mais la question fondamentale est : les banques commerciales africaines ont -elles la capacité, la liquidité, la gouvernance et les garanties nécessaires pour gérer des réserves de change souveraines ?
Pour mémoire, depuis des décennies, la majorité des États africains déposent leurs réserves de change dans des banques centrales étrangères, principalement en Europe et aux États-Unis. Cette pratique, héritée des structures coloniales garantit la sécurité et la liquidité, mais prive l’Afrique d’un levier financier considérable. Selon la Banque africaine de développement , le continent détient plus de 430 milliards de dollars de réserves de change , pour la plupart hors du continent. Une épargne dormante, alors même que les besoins de financement interne explosent.
Un double défi
Le panel a cependant exprimé des doutes, car les normes de crédit, de gestion d’actifs, de transparence et de couverture de change sont élevées. Un double défie se pose, alors. Il faudra construire ou renforcer un cadre de supervision et de règlementation (compliance, reporting, contrôle des risques) pour permettre à ces banques de gérer des réserves de manière fiable ; il faudra également assurer que le rôle ne crée pas de conflit d’intérêts ou ne fragilise pas le système bancaire domestique (par exemple en exposant la banque commerciale à des risques souverains élevés) — ce que le panel a appelé « soulever la question de la frontière entre banque commerciale et gestion d’actifs souverains ».
Par ailleurs, le transfert ou la domiciliation des réserves en Afrique doit être accompagné de mécanismes de gestion efficace du risque de contrepartie, du risque de change, et de la liquidité. Si la banque ne peut pas rapidement convertir ou mobiliser les actifs en cas de crise, cela pourrait poser un grave problème. En outre, le panel souligne que cela ne doit pas être perçu comme un remplacement immédiat, mais plutôt comme un complément ou une hybridation : garder une partie dans des banques africaines, tout en maintenant un accès à des institutions de réserve internationales pour certains besoins.
Enfin, les membres du panel ont insisté sur la nécessité de « pooler » les réserves (Un pool de liquidité est une collection de fonds bloqués dans un contrat intelligent sur un réseau financier décentralisé (DeFi)), de développer des swaps régionaux (Un swap de devises, ou cross-currency swap, est un contrat entre deux parties visant à échanger des paiements d’intérêts et des montants en capital dans deux devises différentes, selon un taux de change prédéfini) et d’utiliser des infrastructures comme le Pan‑African Payment and Settlement System (PAPSS) pour renforcer la liquidité intra-africaine et la gestion des devises.
En somme, pour un État envisageant de confier une partie de ses réserves à une banque commerciale panafricaine, les grandes lignes à retenir sont d’abord de s’assurer que la banque choisie répond à des critères solides de gestion des actifs, de liquidité et de supervision. Le transfert doit s’inscrire dans une stratégie plus large d’utilisation productive des réserves : par exemple les mobiliser pour l’investissement domestique, la stabilité monétaire, ou des mécanismes de swap régionaux ; il est aussi nécessaire de revoir les cadres réglementaires nationaux pour autoriser et encadrer ce type de domiciliation de réserves dans des banques commerciales, en intégrant des garanties, des clauses de liquidité, de reporting, etc.
Entre audace et prudence
Les réserves de change ne sont pas de simples dépôts dormants : elles sont la garantie de stabilité financière d’un pays, son bouclier contre les chocs externes et les crises monétaires. Confier leur gestion à des banques locales — souvent moins capitalisées, plus exposées au risque politique ou de liquidité — pourrait fragiliser la confiance des partenaires internationaux et des marchés.
Les économistes , plus prudents rappellent que la souveraineté n’a de sens que si elle s’appuie sur une infrastructure solide. Les réserves de change sont une ligne de défense stratégique. Les confier à des banques locales, souvent vulnérables aux fluctuations politiques, aux faillites ou à la mauvaise gouvernance, pourrait créer un risque systémique.
Entre audace et prudence, une solution intermédiaire semble se dessiner et certains suggèrent la création de fonds souverains africains, à l’image de ceux du Botswana ou du Nigéria, capables d’investir une portion des réserves dans des projets rentables tout en maintenant la discipline monétaire.
Ainsi, la question n’est peut-être pas de savoir où placer les réserves, mais comment les gérer pour concilier souveraineté, rendement et sécurité. Car une chose est sûre : la véritable indépendance financière de l’Afrique ne se décrète pas, elle se construit dans la rigueur, la transparence et la confiance.
Une autre lecture
En 2024, les réserves de change de l’UEMOA (gérées par la BCEAO) ont été estimées à 13 514 milliards de FCFA (23,4 milliards USD) soit une hausse de +42 % par rapport à l’année précédente. Concernant l’or, les réserves de la BCEAO en métal auraient atteint 2 531,8 milliards de FCFA à fin 2024, soit une hausse notable par rapport à l’année précédente.
Si le débat autour de la gestion locale des réserves de change divise, il prend une résonance encore plus particulière au Sénégal. Même si l’idée de confier une partie des réserves de change aux banques locales semble séduisante, elle se heurte à une réalité structurelle : le système bancaire national est largement dominé par des groupes étrangers.
Autrement dit, “relocaliser” les réserves reviendrait, dans les faits, à les placer sous gestion de filiales dont le centre de décision se trouve à Casablanca, Paris ou Lagos.
« Ce serait une souveraineté de façade », confie un économiste. Selon lui, « Tant que les institutions de dépôt ne sont pas véritablement nationales, transférer les réserves au niveau local ne changera pas la dépendance stratégique. On déplacerait les fonds sans rapatrier le pouvoir. »
Dans un tel contexte, le risque serait double : celui d’exposer une ressource critique à des acteurs eux-mêmes vulnérables, et celui de perdre l’argument de stabilité qui fonde la crédibilité monétaire du pays.
La véritable souveraineté ne viendra donc pas d’un transfert symbolique, mais d’un renforcement des capacités institutionnelles et du capital local au sein du système bancaire.
Malick NDAW, Casablanca
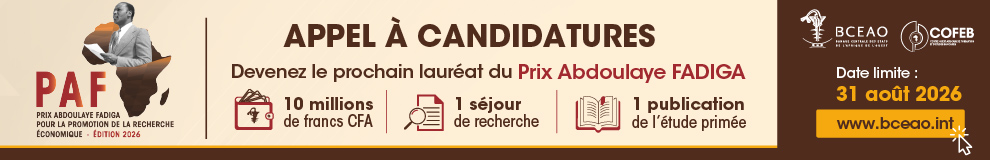

 chroniques
chroniques