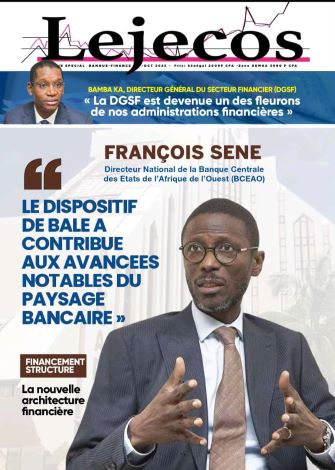L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa) cherche vaille que vaille à faire circuler les Organismes Génétiquement Modifiés (Ogm) et produits dérivés en Afrique de l'Ouest. C'est du moins la conviction de Mohamed Diédhiou, chercheur en droit environnemental à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar.
Invité, lors de la conférence de presse initiée par la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (Copagen), vendredi dernier, à faire une revue critique du Règlement de l'Uemoa, le chercheur a indiqué que «le projet de Règlement de l'Uemoa nous mène vers une direction qu'on ignore, d'où la nécessité d'y aller avec prudence».
Dans son exposé, Mohamed Diédhiou a expliqué pourquoi l'Uemoa cherche à passer par le Règlement au détriment des Directives. Selon lui, et conformément à l'article 43 du traité de l'Uemoa, «le Règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable à tous ses membres».
Mieux, il a indiqué que son but «est de mettre en compatibilité les différents systèmes nationaux. Il vise à transférer les compétences étatiques à une organisation internationale doté d'un pouvoir de décision et de compétence supranationale».
Et de conclure que pour contourner les lois nationales, à l'image de celle du Sénégal sur la biosécurité, «l'Uemoa a pensé mettre en place un Règlement pour prendre le dessus sur la loi sénégalaise, dans la mesure où la tentative de mettre en place des Directives sur la biosécurité avait échoué».
En outre, le chercheur en droit environnemental, venu remplacer son professeur indisponible, a indiqué avoir trouvé des écarts de définitions entre la loi sénégalaise et le Règlement de l'Uemoa. Ainsi, a-t-il relevé que, dans la définition du terme «biosécurité», le Règlement a axé son texte sur la politique au détriment de l'impact environnemental.
Ce qui n'est pas le cas pour la définition figurant dans la loi sénégalaise qui stipule que «la biosécurité est tout dispositif visant à éviter les risques découlant des technologies modernes». Ce qui veut dire, pour lui, que c'est l'étude sur l'impact environnemental qui y est privilégiée.
Par rapport à l'évaluation des risques, il a montré que, pour l'Uemoa, «c'est la mesure d'un dommage potentiel, de son ampleur et des chances de sa survenue».
Ce qui est tout autre dans la loi sénégalaise qui dispose, selon lui, que l'évaluation des risques est «l'évaluation des souhaits, procédures scientifiques reconnues pour évaluer les impacts directs ou indirects à court, moyen ou long termes».
Autres manquements et pas des moindres, c'est l'inadéquation du Règlement par rapport au protocole de Cartagena, «qui gère mieux ce qui se rapport aux Ogm», selon Mohamed Diédhiou.
A l'en croire, là où le Protocole a évoqué, au niveau de l'article 14, «des arrangements bilatéraux pour réguler le principe de la libre circulation», le Règlement quant à lui, en son article 9, parle de «la libre circulation des produits Ogm et dérivés».
Toujours, dans la logique d'affaiblissement des structures nationales, il a fait remarquer que «le Règlement a créé une Autorité régionale de biosécurité, un Comité scientifique et technique de biosécurité, et un Secrétariat régional de biosécurité».
Ce qui est contraire, selon lui, au Protocole de Cartagena qui a parlé de «subordination avec les structures nationales de biosécurité» en attribuant, à son article 16, «pleine compétence aux Etats de légiférer en matière de gestion de risque».
Pour ce faire, il a préconisé aux Etats membre de créer des lois pour favoriser le développement durable. Mieux, il a estimé qu'il faut aussi «une création de zones sans Ogm et la reconnaissance des droits souverains des Etats en matière de biosécurité». Poursuivant, il a jugé nécessaire de prévaloir les Directives au détriment du Règlement.
Sud Quotidien
Invité, lors de la conférence de presse initiée par la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (Copagen), vendredi dernier, à faire une revue critique du Règlement de l'Uemoa, le chercheur a indiqué que «le projet de Règlement de l'Uemoa nous mène vers une direction qu'on ignore, d'où la nécessité d'y aller avec prudence».
Dans son exposé, Mohamed Diédhiou a expliqué pourquoi l'Uemoa cherche à passer par le Règlement au détriment des Directives. Selon lui, et conformément à l'article 43 du traité de l'Uemoa, «le Règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable à tous ses membres».
Mieux, il a indiqué que son but «est de mettre en compatibilité les différents systèmes nationaux. Il vise à transférer les compétences étatiques à une organisation internationale doté d'un pouvoir de décision et de compétence supranationale».
Et de conclure que pour contourner les lois nationales, à l'image de celle du Sénégal sur la biosécurité, «l'Uemoa a pensé mettre en place un Règlement pour prendre le dessus sur la loi sénégalaise, dans la mesure où la tentative de mettre en place des Directives sur la biosécurité avait échoué».
En outre, le chercheur en droit environnemental, venu remplacer son professeur indisponible, a indiqué avoir trouvé des écarts de définitions entre la loi sénégalaise et le Règlement de l'Uemoa. Ainsi, a-t-il relevé que, dans la définition du terme «biosécurité», le Règlement a axé son texte sur la politique au détriment de l'impact environnemental.
Ce qui n'est pas le cas pour la définition figurant dans la loi sénégalaise qui stipule que «la biosécurité est tout dispositif visant à éviter les risques découlant des technologies modernes». Ce qui veut dire, pour lui, que c'est l'étude sur l'impact environnemental qui y est privilégiée.
Par rapport à l'évaluation des risques, il a montré que, pour l'Uemoa, «c'est la mesure d'un dommage potentiel, de son ampleur et des chances de sa survenue».
Ce qui est tout autre dans la loi sénégalaise qui dispose, selon lui, que l'évaluation des risques est «l'évaluation des souhaits, procédures scientifiques reconnues pour évaluer les impacts directs ou indirects à court, moyen ou long termes».
Autres manquements et pas des moindres, c'est l'inadéquation du Règlement par rapport au protocole de Cartagena, «qui gère mieux ce qui se rapport aux Ogm», selon Mohamed Diédhiou.
A l'en croire, là où le Protocole a évoqué, au niveau de l'article 14, «des arrangements bilatéraux pour réguler le principe de la libre circulation», le Règlement quant à lui, en son article 9, parle de «la libre circulation des produits Ogm et dérivés».
Toujours, dans la logique d'affaiblissement des structures nationales, il a fait remarquer que «le Règlement a créé une Autorité régionale de biosécurité, un Comité scientifique et technique de biosécurité, et un Secrétariat régional de biosécurité».
Ce qui est contraire, selon lui, au Protocole de Cartagena qui a parlé de «subordination avec les structures nationales de biosécurité» en attribuant, à son article 16, «pleine compétence aux Etats de légiférer en matière de gestion de risque».
Pour ce faire, il a préconisé aux Etats membre de créer des lois pour favoriser le développement durable. Mieux, il a estimé qu'il faut aussi «une création de zones sans Ogm et la reconnaissance des droits souverains des Etats en matière de biosécurité». Poursuivant, il a jugé nécessaire de prévaloir les Directives au détriment du Règlement.
Sud Quotidien
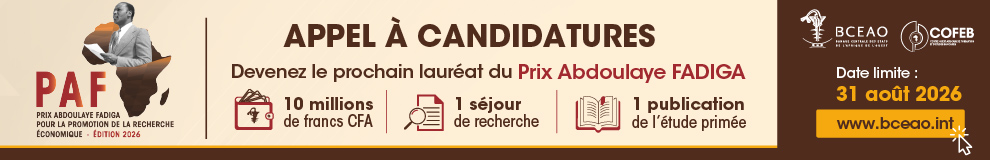

 chroniques
chroniques