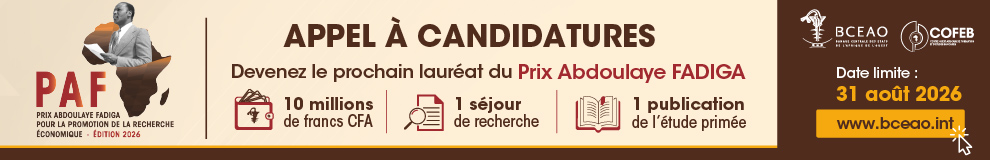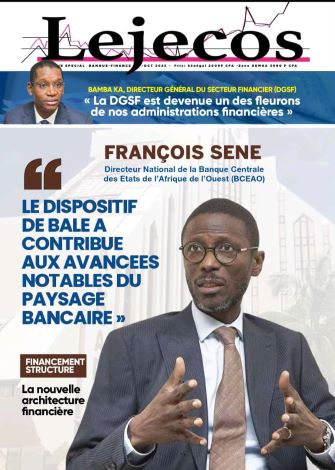Ce lundi 14 juillet 2025, sur les hauteurs du quartier Hay Riad, Avenue Mohammed VI, nous sommes au Campus de l’UM6P (Université Mohamed 6 Polytechnique) de Rabat, au Maroc. Lorsque les portes s’ouvrent sur le grand auditorium du Policy Center for the New South (PCNS), entre solennité et impatience, l’air est déjà chargé de cette douce tension que seuls les grands rendez-vous savent créer. La salle, vaste et baignée d’une lumière dorée, déploie ses travées, face à une scène sobre, où trônent un pupitre finement gravé et un large écran LED affichant en lettres blanches : “3ᵉ Symposium Économique Africain – L’Afrique dans un monde en mutation : vers des choix économiques audacieux”.
Dans les rangées bruissant d’accents venus des quatre coins d’Afrique, un flux continu de silhouettes élégantes : costumes sobres, robes colorées, foulards soyeux. Les badges scintillent sous les lumières, chacun cherchant son siège, certains échangeant déjà des poignées de main fermes, d’autres absorbés par leur programme imprimé. Puis, la lumière baisse légèrement. Le moment est solennel et un silence poli descend, coupé seulement par le froissement de quelques pages.
Debout derrière le pupitre, voix posée, Karim El Aynaoui, le président exécutif du Policy Center for the New South, plante le décor à travers trois grands messages qui ont structuré son adresse inaugurale : l’impératif de lucidité, le courage de la réforme et l’ambition collective africaine. « Notre continent », dit-il, « est confronté à un moment charnière. Les tensions géopolitiques, la transformation technologique et la crise climatique imposent des choix économiques décisifs. »
Le ton ainsi donné, à la fois lucide et mobilisateur, donne la mesure de l’événement. Ici, pas question d’édulcorer les diagnostics : ralentissement de la croissance, endettement croissant, faible industrialisation, intégration régionale encore balbutiante. Mais pas question non plus de céder au fatalisme. Ce n’est pas seulement une rencontre d’experts : c’est un moment où l’Afrique vient penser son avenir à haute voix.
Très vite, le premier panel plonge dans le dur des politiques monétaires : inflation persistante, volatilité des devises, endettement qui grève les marges de manœuvre budgétaires. Un constat partagé : l’Afrique navigue dans des eaux économiques étroites, où la prudence budgétaire et l’audace réformatrice doivent cohabiter. Les taux d’inflation restent élevés dans de nombreux pays, dépassant parfois 10 % voire 15 %. Pour tenter d’y répondre, les banques centrales ont relevé leurs taux directeurs, rendant plus coûteux l’accès au crédit, tout en alourdissant le service de la dette publique. La question traverse presque toutes les économies africaines, qu’il s’agisse de la BCEAO en Afrique de l’Ouest, de la Banque centrale du Nigeria ou de la Banque du Ghana. Un équilibre fragile que le ghanéen Emmanuel Owusu-Sekyere, économiste principal à l’Africa Centre for Economic Transformation (ACET), juge impossible à atteindre si les gouvernements se reposent uniquement sur les banques centrales : « Si nous laissons la politique monétaire porter seule le poids de la relance et de la stabilité, nous courons le risque de l’inefficacité et de la défiance », dit-il en estimant que la coordination entre politiques budgétaires et monétaires demeure le maillon faible.
Les réformes qui s’imposent
Pour sa part, le kenyan Kwame Owino, Directeur général de l’Institute of Economic Affairs, (Nairobi) a, lui, insisté sur le fait que la confiance du public est le principal capital des banques centrales, et plaidé pour plus de transparence des mécanismes de décision. Selon lui, le nerf de la guerre reste la crédibilité institutionnelle, mais, tempère-t-il : « La crédibilité ne se décrète pas. Elle se construit par des preuves répétées d’indépendance et de cohérence. » L’économiste marocain Ghassane Benmir, Professeur affilié à IE University (France), met en garde contre l’obsession de la stabilité nominale. Nous devons, déclare-t-il : « Sortir d’une vision étroite de la stabilité nominale. Sans marchés financiers profonds et sans stratégie de diversification, la politique monétaire reste un outil partiel », mettant ainsi le doigt sur la nécessité de ne pas se limiter à la seule cible d’inflation et citant en exemple la tendance de certaines banques centrales à calquer leur doctrine sur celle de pays industrialisés, alors que les contextes structurels africains diffèrent profondément. Dans la session relative à la question fiscale, Andrew Dabalen, économiste en chef Afrique à la Banque mondiale, résume le dilemme : « La priorité est de contenir l’inflation, mais cela ne doit pas tuer la reprise », dit-il.
Le message est clair : la maîtrise des prix et la solidité de la monnaie ne suffisent pas à elles seules à enclencher la transformation économique. Il faut y adosser des réformes structurelles, une intégration régionale accélérée et des instruments de financement innovants.
Accélérateurs ou mirages ?
Au fil des panels du symposium, une conviction s’est imposée : l’Afrique doit désormais répondre à ses propres défis avec ses propres outils. Exit les modèles copiés-collés. À la place, une réflexion collective sur ce que signifie réformer dans un contexte africain, avec des leviers endogènes. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), souvent perçue comme un projet emblématique, a été au cœur des discussions. Les experts réunis à Rabat ont été clairs : l’ambition ne suffit pas. « La ZLECAf ne transformera pas l’économie africaine si elle reste déconnectée du réel, des chaînes logistiques, des systèmes fiscaux ou des infrastructures régionales ». En d’autres termes, pas d’intégration sans concrétisation. Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, n’y va pas par quatre chemins et déclare : « L’heure n’est plus aux discours, nous avons signé, nous avons ratifié. Maintenant, il faut commercer. » Son appel à concrétiser les échanges résonne particulièrement, dans un contexte où rappelons-le, le commerce intra-africain ne dépasse toujours pas 15 % du total des échanges du continent. Il y a ainsi le besoin criant d’un ancrage pratique (corridors logistiques, production régionale, alignement fiscal et monétaire), sinon l’ambition risque de rester pure posture.
Même ton lucide sur la question des monnaies numériques de banques centrales (MNBC), présentées comme un moyen d’élargir l’inclusion financière et de renforcer la souveraineté monétaire. Arkebe Oqubay Metiku, British Academy Global Professor, SOAS University of London, voit dans les monnaies numériques un outil stratégique : « Si nous les concevons en fonction de nos réalités économiques et régionales, ces instruments peuvent devenir un catalyseur d’intégration. Mais la technologie seule ne suffit pas : il faut l’adosser à des politiques industrielles ambitieuses. » L’enthousiasme est tempéré par des experts qui défendent l’idée qu’« Une monnaie numérique ne résoudra pas les problèmes de gouvernance ou de confiance. Sans infrastructures solides et sans régulation claire, elle pourrait même les amplifier. »
Entre potentiel transformateur et risque de sur-promesse, tous s’accordent en tout cas sur un point : il est temps pour les États africains de réconcilier prudence économique et ambition politique. Cela suppose de bâtir des institutions solides, de stimuler l’investissement local, et surtout, de penser régional pour agir efficacement.
Financements innovants et transition verte : l’heure des choix
Un consensus s’est dégagé autour de la double urgence : financer la croissance tout en répondant à l’impératif climatique. Les différents intervenants s’accordent sur un point : les modèles traditionnels de financement du développement ne suffiront plus. Une raison pour que Nardos Bekele-Thomas, directrice générale de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), plaide pour une mobilisation accrue des ressources internes et pour des partenariats public-privé plus audacieux.
En d’autres termes, Faizel Ismail, Directeur de l’École de gouvernance publique Nelson Mandela, indique que la transition verte est aussi une opportunité industrielle : « Les technologies propres ne doivent pas être importées clé en main. Nous devons développer nos propres chaînes de valeur, adaptées à nos ressources et à nos talents. »
Le temps fort du symposium a été la présentation officielle du rapport 2025 de l’Africa Economic Symposium (AES) qui a captivé toute l’audience. Ce document, fruit d’un travail collectif d’experts et de chercheurs, dresse un état des lieux précis des transformations économiques africaines, et propose des pistes stratégiques pour accélérer la croissance durable. Le rapport met notamment en lumière la nécessité d’une mise en œuvre rapide et coordonnée de la ZLECAf, mais aussi et surtout, l’importance cruciale des réformes fiscales, ainsi que le potentiel encore largement inexploité des innovations technologiques, telles que les monnaies numériques. Ce moment a marqué un tournant dans les débats, rappelant que le symposium ne se limite pas à un exercice intellectuel, mais qu’il vise en plus, à influencer les agendas politiques et économiques à court et moyen terme.
Au-delà du débat technique, le message principal chevillé au thème principal du Symposium, est clair : l’Afrique doit faire des choix audacieux et coordonnés pour éviter le piège d’une croissance faible et d’un endettement insoutenable. Entre rigueur budgétaire, soutien à l’investissement et innovations monétaires, le continent cherche encore la formule qui lui permettra de bâtir une prospérité durable.
A travers des espaces comme le Policy Center For The New South (PCNS) qui a mobilisé plus de 200 participants de diverses nationalités, cette troisième édition a élargi les bases du parcours du Symposium économique africain (AES), qui se positionne ainsi, comme un espace d’influence intellectuelle pour le continent.
Lejecos Magazine
Dans les rangées bruissant d’accents venus des quatre coins d’Afrique, un flux continu de silhouettes élégantes : costumes sobres, robes colorées, foulards soyeux. Les badges scintillent sous les lumières, chacun cherchant son siège, certains échangeant déjà des poignées de main fermes, d’autres absorbés par leur programme imprimé. Puis, la lumière baisse légèrement. Le moment est solennel et un silence poli descend, coupé seulement par le froissement de quelques pages.
Debout derrière le pupitre, voix posée, Karim El Aynaoui, le président exécutif du Policy Center for the New South, plante le décor à travers trois grands messages qui ont structuré son adresse inaugurale : l’impératif de lucidité, le courage de la réforme et l’ambition collective africaine. « Notre continent », dit-il, « est confronté à un moment charnière. Les tensions géopolitiques, la transformation technologique et la crise climatique imposent des choix économiques décisifs. »
Le ton ainsi donné, à la fois lucide et mobilisateur, donne la mesure de l’événement. Ici, pas question d’édulcorer les diagnostics : ralentissement de la croissance, endettement croissant, faible industrialisation, intégration régionale encore balbutiante. Mais pas question non plus de céder au fatalisme. Ce n’est pas seulement une rencontre d’experts : c’est un moment où l’Afrique vient penser son avenir à haute voix.
Très vite, le premier panel plonge dans le dur des politiques monétaires : inflation persistante, volatilité des devises, endettement qui grève les marges de manœuvre budgétaires. Un constat partagé : l’Afrique navigue dans des eaux économiques étroites, où la prudence budgétaire et l’audace réformatrice doivent cohabiter. Les taux d’inflation restent élevés dans de nombreux pays, dépassant parfois 10 % voire 15 %. Pour tenter d’y répondre, les banques centrales ont relevé leurs taux directeurs, rendant plus coûteux l’accès au crédit, tout en alourdissant le service de la dette publique. La question traverse presque toutes les économies africaines, qu’il s’agisse de la BCEAO en Afrique de l’Ouest, de la Banque centrale du Nigeria ou de la Banque du Ghana. Un équilibre fragile que le ghanéen Emmanuel Owusu-Sekyere, économiste principal à l’Africa Centre for Economic Transformation (ACET), juge impossible à atteindre si les gouvernements se reposent uniquement sur les banques centrales : « Si nous laissons la politique monétaire porter seule le poids de la relance et de la stabilité, nous courons le risque de l’inefficacité et de la défiance », dit-il en estimant que la coordination entre politiques budgétaires et monétaires demeure le maillon faible.
Les réformes qui s’imposent
Pour sa part, le kenyan Kwame Owino, Directeur général de l’Institute of Economic Affairs, (Nairobi) a, lui, insisté sur le fait que la confiance du public est le principal capital des banques centrales, et plaidé pour plus de transparence des mécanismes de décision. Selon lui, le nerf de la guerre reste la crédibilité institutionnelle, mais, tempère-t-il : « La crédibilité ne se décrète pas. Elle se construit par des preuves répétées d’indépendance et de cohérence. » L’économiste marocain Ghassane Benmir, Professeur affilié à IE University (France), met en garde contre l’obsession de la stabilité nominale. Nous devons, déclare-t-il : « Sortir d’une vision étroite de la stabilité nominale. Sans marchés financiers profonds et sans stratégie de diversification, la politique monétaire reste un outil partiel », mettant ainsi le doigt sur la nécessité de ne pas se limiter à la seule cible d’inflation et citant en exemple la tendance de certaines banques centrales à calquer leur doctrine sur celle de pays industrialisés, alors que les contextes structurels africains diffèrent profondément. Dans la session relative à la question fiscale, Andrew Dabalen, économiste en chef Afrique à la Banque mondiale, résume le dilemme : « La priorité est de contenir l’inflation, mais cela ne doit pas tuer la reprise », dit-il.
Le message est clair : la maîtrise des prix et la solidité de la monnaie ne suffisent pas à elles seules à enclencher la transformation économique. Il faut y adosser des réformes structurelles, une intégration régionale accélérée et des instruments de financement innovants.
Accélérateurs ou mirages ?
Au fil des panels du symposium, une conviction s’est imposée : l’Afrique doit désormais répondre à ses propres défis avec ses propres outils. Exit les modèles copiés-collés. À la place, une réflexion collective sur ce que signifie réformer dans un contexte africain, avec des leviers endogènes. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), souvent perçue comme un projet emblématique, a été au cœur des discussions. Les experts réunis à Rabat ont été clairs : l’ambition ne suffit pas. « La ZLECAf ne transformera pas l’économie africaine si elle reste déconnectée du réel, des chaînes logistiques, des systèmes fiscaux ou des infrastructures régionales ». En d’autres termes, pas d’intégration sans concrétisation. Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, n’y va pas par quatre chemins et déclare : « L’heure n’est plus aux discours, nous avons signé, nous avons ratifié. Maintenant, il faut commercer. » Son appel à concrétiser les échanges résonne particulièrement, dans un contexte où rappelons-le, le commerce intra-africain ne dépasse toujours pas 15 % du total des échanges du continent. Il y a ainsi le besoin criant d’un ancrage pratique (corridors logistiques, production régionale, alignement fiscal et monétaire), sinon l’ambition risque de rester pure posture.
Même ton lucide sur la question des monnaies numériques de banques centrales (MNBC), présentées comme un moyen d’élargir l’inclusion financière et de renforcer la souveraineté monétaire. Arkebe Oqubay Metiku, British Academy Global Professor, SOAS University of London, voit dans les monnaies numériques un outil stratégique : « Si nous les concevons en fonction de nos réalités économiques et régionales, ces instruments peuvent devenir un catalyseur d’intégration. Mais la technologie seule ne suffit pas : il faut l’adosser à des politiques industrielles ambitieuses. » L’enthousiasme est tempéré par des experts qui défendent l’idée qu’« Une monnaie numérique ne résoudra pas les problèmes de gouvernance ou de confiance. Sans infrastructures solides et sans régulation claire, elle pourrait même les amplifier. »
Entre potentiel transformateur et risque de sur-promesse, tous s’accordent en tout cas sur un point : il est temps pour les États africains de réconcilier prudence économique et ambition politique. Cela suppose de bâtir des institutions solides, de stimuler l’investissement local, et surtout, de penser régional pour agir efficacement.
Financements innovants et transition verte : l’heure des choix
Un consensus s’est dégagé autour de la double urgence : financer la croissance tout en répondant à l’impératif climatique. Les différents intervenants s’accordent sur un point : les modèles traditionnels de financement du développement ne suffiront plus. Une raison pour que Nardos Bekele-Thomas, directrice générale de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), plaide pour une mobilisation accrue des ressources internes et pour des partenariats public-privé plus audacieux.
En d’autres termes, Faizel Ismail, Directeur de l’École de gouvernance publique Nelson Mandela, indique que la transition verte est aussi une opportunité industrielle : « Les technologies propres ne doivent pas être importées clé en main. Nous devons développer nos propres chaînes de valeur, adaptées à nos ressources et à nos talents. »
Le temps fort du symposium a été la présentation officielle du rapport 2025 de l’Africa Economic Symposium (AES) qui a captivé toute l’audience. Ce document, fruit d’un travail collectif d’experts et de chercheurs, dresse un état des lieux précis des transformations économiques africaines, et propose des pistes stratégiques pour accélérer la croissance durable. Le rapport met notamment en lumière la nécessité d’une mise en œuvre rapide et coordonnée de la ZLECAf, mais aussi et surtout, l’importance cruciale des réformes fiscales, ainsi que le potentiel encore largement inexploité des innovations technologiques, telles que les monnaies numériques. Ce moment a marqué un tournant dans les débats, rappelant que le symposium ne se limite pas à un exercice intellectuel, mais qu’il vise en plus, à influencer les agendas politiques et économiques à court et moyen terme.
Au-delà du débat technique, le message principal chevillé au thème principal du Symposium, est clair : l’Afrique doit faire des choix audacieux et coordonnés pour éviter le piège d’une croissance faible et d’un endettement insoutenable. Entre rigueur budgétaire, soutien à l’investissement et innovations monétaires, le continent cherche encore la formule qui lui permettra de bâtir une prospérité durable.
A travers des espaces comme le Policy Center For The New South (PCNS) qui a mobilisé plus de 200 participants de diverses nationalités, cette troisième édition a élargi les bases du parcours du Symposium économique africain (AES), qui se positionne ainsi, comme un espace d’influence intellectuelle pour le continent.
Lejecos Magazine


 chroniques
chroniques