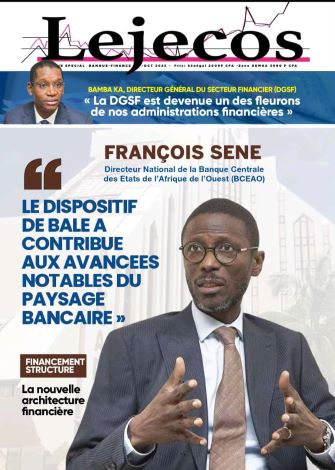Les enjeux sont de taille. En interconnectant différemment les réseaux, la région pourra mieux équilibrer des fluctuations de production et éviter des pannes d’électricité généralisées. Mais ce n’est pas le seul enjeu car, l’approvisionnement deviendra plus stable, et la mutualisation peut conduire à une baisse des coûts à long terme. Pour rappel, le West African Power Pool (WAPP), ou Système d’Échange d’Énergie Électrique Ouest-Africain, est une institution de la CEDEAO dont la mission est d’unifier progressivement les réseaux électriques de la région pour assurer un approvisionnement plus fiable et moins coûteux à ses populations.
Ainsi, ce stress test est une étape clé dans l’intégration énergétique régionale et il intervient après l’interconnexion réussie entre la Côte d’Ivoire et le Mali en 2023, marquant une avancée concrète vers un réseau harmonisé à l’échelle ouest-africaine. Après la synchronisation provisoire du 20 septembre 2025, il y a plusieurs étapes stratégiques prévues dans la feuille de route du WAPP (West African Power Pool).
Vers un marché régional de l’électricité
Il s’agira de procéder à l’évaluation technique de la synchronisation à travers la mesure de la stabilité du réseau interconnecté, l’identification des déséquilibres de fréquence, les pertes ou problèmes d’harmonisation et l’ajustement des systèmes de protection et de contrôle. Si les résultats du test sont concluants, la région passera d’une connexion temporaire à une interconnexion continue. Ce qui signifie que les pays connectés pourront échanger de l’électricité en temps réel, sans dépendre uniquement de leurs centrales nationales.
Le WAPP prépare un marché de gros de l’électricité pour permettre aux pays et producteurs indépendants d’acheter/vendre plus facilement de l’énergie. L’objectif est que d’ici 2026-2027, les transactions se fassent sur une plateforme commune, avec plus de transparence et de compétitivité. Les interconnexions devraient progressivement intégrer tous les 15 États membres du WAPP. La Côte d’Ivoire est déjà reliée au Ghana, Burkina et Mali ; à terme, le Nigeria (plus gros producteur) et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest seront pleinement synchronisés.
Le renforcement des infrastructures se poursuivra avec la construction de nouvelles lignes haute tension (225 kV, 330 kV), les projets de centrales régionales (hydroélectricité en Guinée, solaire et gaz ailleurs) et le déploiement de systèmes digitaux pour la gestion centralisée du réseau.
D’ici à 2030, le réseau ouest-africain devrait être complètement intégré, avec un accès à l’électricité pour plus de 80% de la population (contre environ 50% actuellement dans certains pays) et une réduction des coûts et moins de délestages chroniques.
Acteurs clés par étape
Dans le panorama des acteurs principaux impliqués dans chaque étape du processus WAPP, on retrouve Senelec, l’opérateur national (Sénégal) dans la phase de synchronisation provisoire. Elle est chargée de coordonner les tests sur son réseau, tandis que l’OMVG (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie) aura à gérer l’interconnexion Gambie–Sénégal–Guinée–Guinée-Bissau, avec la forte implication de sa sœur OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) à travers l’hydroélectricité (Manantali, Félou, Gouina).
Pour la phase d’évaluation technique (fin 2025 – début 2026), le Centre de Contrôle WAPP (Cotonou, Bénin) supervisera les données de stabilité et de fréquence ; le Comité de Régulation Régionale (CRR) veillera au respect des normes techniques et commerciales et le CEB (Communauté Électrique du Bénin) jouera un rôle pivot car son réseau est un carrefour entre Nigéria, Togo, Bénin et Ghana.
Quant à la phase de synchronisation permanente (2026), elle fera intervenir TCN (Transmission Company of Nigeria), un acteur majeur, car le Nigéria fournit plus de 50% de la capacité installée de la région ; CI-ENERGIES (Côte d’Ivoire) déjà interconnectée avec Ghana, Mali, Burkina, va renforcer la boucle et EDM-SA (Énergie du Mali), maillon central de la boucle Guinée–Mali–Sénégal.
La phase d’extension complète dans la CEDEAO (2028-2029) suit avec l’achèvement des interconnexions régionales, pour que tous les 15 pays soient reliés au réseau commun. C’est la dernière étape physique majeure, condition sine qua non pour que le marché régional de l’électricité puisse réellement fonctionner. Aujourd’hui, certains pays (ex. : Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Gambie) sont encore en cours de connexion au backbone régional. L’extension complète à la CEDEAO est donc une condition incontournable.
La mise en place complète du marché régional de l’électricité (Regional Electricity Market) est la dernière étape du processus WAPP, avec : Phase 1 : le marché de l’énergie de court terme (day-ahead, bilatéral, spot). Lancée en juin 2018, elle est encore en phase pilote, car toutes les interconnexions ne sont pas finalisées ; Phase 2 : le marché régional concurrentiel et intégré, prévu comme l’ultime étape où tous les pays de la CEDEAO reliés par un réseau électrique interconnecté et stable (les grandes lignes de transport régionales sont encore en cours de construction), pourront librement acheter/vendre de l’électricité au meilleur prix, en s’appuyant sur une interconnexion physique fiable et un cadre réglementaire commun.
C’est là qu’entre en scène le Secrétariat Général du WAPP (Cotonou) pour piloter la plateforme de marché de l’électricité (2027). C’est l’opérateur du système et du marché capable de gérer en temps réel l’équilibre offre-demande au niveau régional. Il ne sera pas seul puisque c’est le CRR (Régulateur régional) qui assurera la transparence et les règles d’échanges (pour éviter les abus de position dominante). C’est ce qui permettra aux pays en déficit d’importer rapidement, aux pays excédentaires (comme la Côte d’Ivoire ou le Ghana) d’exporter plus efficacement, et à la région entière de réduire les coûts et améliorer la sécurité énergétique.
A ce niveau, les Producteurs indépendants (IPP) comme Azito (Côte d’Ivoire), Karpowership (Sénégal/Gambie), ou centrales solaires en développement) jouent un rôle stratégique dans le paysage énergétique africain, notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Gambie. Leurs contributions vont bien au-delà de la simple production d’électricité, englobant des aspects économiques, environnementaux et sociaux essentiels.
Le rôle central des IPP
L’extension de la centrale thermique d’Azito en Côte d’Ivoire a ajouté 253 MW, portant la capacité totale à 710 MW, représentant environ 8 % de la capacité installée du pays. En termes de diversification du mix énergétique, les IPP facilitent la transition énergétique en intégrant des sources d’énergie renouvelable. Au Sénégal, Karpowership exploite une centrale flottante de 235 MW, tandis qu’en Gambie, une autre centrale flottante de 36 MW contribue à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.
Les IPP mobilisent des financements privés, souvent en partenariat avec des institutions financières internationales, pour le développement de projets énergétiques. Cette approche permet de réduire la pression sur les finances publiques tout en stimulant l’économie locale.
En fournissant de l’énergie de manière fiable et à moindre coût, les IPP contribuent à l’amélioration de l’accès à l’électricité, en particulier dans les zones rurales et périurbaines, soutenant ainsi le développement socio-économique. Pour finir, les projets des IPP génèrent des emplois directs et indirects, favorisant le développement des compétences locales et stimulant l’économie régionale.
Pour l’heure, la CEDEAO est partiellement interconnectée, mais des pays en périphérie restent à relier. Plusieurs projets cruciaux (CLSG, OMVG, North Core, lien Côte d’Ivoire–Ghana) sont en bonne voie, mais confrontés à des défis sécuritaires, réglementaires et financiers. Certains projets peinent à obtenir des ressources, malgré des soutiens de la Banque mondiale, de l’Union européenne et de la BAD. On note cependant des difficultés d’harmonisation des régulations, licences, tarifs entre les États membres.
Malick NDAW
Ainsi, ce stress test est une étape clé dans l’intégration énergétique régionale et il intervient après l’interconnexion réussie entre la Côte d’Ivoire et le Mali en 2023, marquant une avancée concrète vers un réseau harmonisé à l’échelle ouest-africaine. Après la synchronisation provisoire du 20 septembre 2025, il y a plusieurs étapes stratégiques prévues dans la feuille de route du WAPP (West African Power Pool).
Vers un marché régional de l’électricité
Il s’agira de procéder à l’évaluation technique de la synchronisation à travers la mesure de la stabilité du réseau interconnecté, l’identification des déséquilibres de fréquence, les pertes ou problèmes d’harmonisation et l’ajustement des systèmes de protection et de contrôle. Si les résultats du test sont concluants, la région passera d’une connexion temporaire à une interconnexion continue. Ce qui signifie que les pays connectés pourront échanger de l’électricité en temps réel, sans dépendre uniquement de leurs centrales nationales.
Le WAPP prépare un marché de gros de l’électricité pour permettre aux pays et producteurs indépendants d’acheter/vendre plus facilement de l’énergie. L’objectif est que d’ici 2026-2027, les transactions se fassent sur une plateforme commune, avec plus de transparence et de compétitivité. Les interconnexions devraient progressivement intégrer tous les 15 États membres du WAPP. La Côte d’Ivoire est déjà reliée au Ghana, Burkina et Mali ; à terme, le Nigeria (plus gros producteur) et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest seront pleinement synchronisés.
Le renforcement des infrastructures se poursuivra avec la construction de nouvelles lignes haute tension (225 kV, 330 kV), les projets de centrales régionales (hydroélectricité en Guinée, solaire et gaz ailleurs) et le déploiement de systèmes digitaux pour la gestion centralisée du réseau.
D’ici à 2030, le réseau ouest-africain devrait être complètement intégré, avec un accès à l’électricité pour plus de 80% de la population (contre environ 50% actuellement dans certains pays) et une réduction des coûts et moins de délestages chroniques.
Acteurs clés par étape
Dans le panorama des acteurs principaux impliqués dans chaque étape du processus WAPP, on retrouve Senelec, l’opérateur national (Sénégal) dans la phase de synchronisation provisoire. Elle est chargée de coordonner les tests sur son réseau, tandis que l’OMVG (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie) aura à gérer l’interconnexion Gambie–Sénégal–Guinée–Guinée-Bissau, avec la forte implication de sa sœur OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) à travers l’hydroélectricité (Manantali, Félou, Gouina).
Pour la phase d’évaluation technique (fin 2025 – début 2026), le Centre de Contrôle WAPP (Cotonou, Bénin) supervisera les données de stabilité et de fréquence ; le Comité de Régulation Régionale (CRR) veillera au respect des normes techniques et commerciales et le CEB (Communauté Électrique du Bénin) jouera un rôle pivot car son réseau est un carrefour entre Nigéria, Togo, Bénin et Ghana.
Quant à la phase de synchronisation permanente (2026), elle fera intervenir TCN (Transmission Company of Nigeria), un acteur majeur, car le Nigéria fournit plus de 50% de la capacité installée de la région ; CI-ENERGIES (Côte d’Ivoire) déjà interconnectée avec Ghana, Mali, Burkina, va renforcer la boucle et EDM-SA (Énergie du Mali), maillon central de la boucle Guinée–Mali–Sénégal.
La phase d’extension complète dans la CEDEAO (2028-2029) suit avec l’achèvement des interconnexions régionales, pour que tous les 15 pays soient reliés au réseau commun. C’est la dernière étape physique majeure, condition sine qua non pour que le marché régional de l’électricité puisse réellement fonctionner. Aujourd’hui, certains pays (ex. : Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Gambie) sont encore en cours de connexion au backbone régional. L’extension complète à la CEDEAO est donc une condition incontournable.
La mise en place complète du marché régional de l’électricité (Regional Electricity Market) est la dernière étape du processus WAPP, avec : Phase 1 : le marché de l’énergie de court terme (day-ahead, bilatéral, spot). Lancée en juin 2018, elle est encore en phase pilote, car toutes les interconnexions ne sont pas finalisées ; Phase 2 : le marché régional concurrentiel et intégré, prévu comme l’ultime étape où tous les pays de la CEDEAO reliés par un réseau électrique interconnecté et stable (les grandes lignes de transport régionales sont encore en cours de construction), pourront librement acheter/vendre de l’électricité au meilleur prix, en s’appuyant sur une interconnexion physique fiable et un cadre réglementaire commun.
C’est là qu’entre en scène le Secrétariat Général du WAPP (Cotonou) pour piloter la plateforme de marché de l’électricité (2027). C’est l’opérateur du système et du marché capable de gérer en temps réel l’équilibre offre-demande au niveau régional. Il ne sera pas seul puisque c’est le CRR (Régulateur régional) qui assurera la transparence et les règles d’échanges (pour éviter les abus de position dominante). C’est ce qui permettra aux pays en déficit d’importer rapidement, aux pays excédentaires (comme la Côte d’Ivoire ou le Ghana) d’exporter plus efficacement, et à la région entière de réduire les coûts et améliorer la sécurité énergétique.
A ce niveau, les Producteurs indépendants (IPP) comme Azito (Côte d’Ivoire), Karpowership (Sénégal/Gambie), ou centrales solaires en développement) jouent un rôle stratégique dans le paysage énergétique africain, notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Gambie. Leurs contributions vont bien au-delà de la simple production d’électricité, englobant des aspects économiques, environnementaux et sociaux essentiels.
Le rôle central des IPP
L’extension de la centrale thermique d’Azito en Côte d’Ivoire a ajouté 253 MW, portant la capacité totale à 710 MW, représentant environ 8 % de la capacité installée du pays. En termes de diversification du mix énergétique, les IPP facilitent la transition énergétique en intégrant des sources d’énergie renouvelable. Au Sénégal, Karpowership exploite une centrale flottante de 235 MW, tandis qu’en Gambie, une autre centrale flottante de 36 MW contribue à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.
Les IPP mobilisent des financements privés, souvent en partenariat avec des institutions financières internationales, pour le développement de projets énergétiques. Cette approche permet de réduire la pression sur les finances publiques tout en stimulant l’économie locale.
En fournissant de l’énergie de manière fiable et à moindre coût, les IPP contribuent à l’amélioration de l’accès à l’électricité, en particulier dans les zones rurales et périurbaines, soutenant ainsi le développement socio-économique. Pour finir, les projets des IPP génèrent des emplois directs et indirects, favorisant le développement des compétences locales et stimulant l’économie régionale.
Pour l’heure, la CEDEAO est partiellement interconnectée, mais des pays en périphérie restent à relier. Plusieurs projets cruciaux (CLSG, OMVG, North Core, lien Côte d’Ivoire–Ghana) sont en bonne voie, mais confrontés à des défis sécuritaires, réglementaires et financiers. Certains projets peinent à obtenir des ressources, malgré des soutiens de la Banque mondiale, de l’Union européenne et de la BAD. On note cependant des difficultés d’harmonisation des régulations, licences, tarifs entre les États membres.
Malick NDAW


 chroniques
chroniques