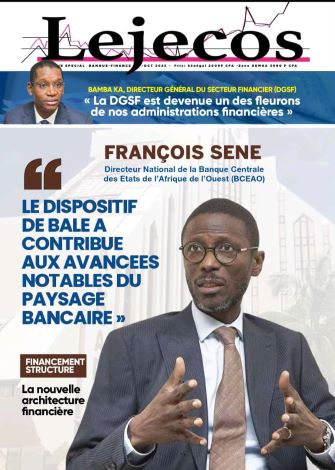La question n’est pas de rejeter la technologie, mais de réaffirmer la place de l’humain. D’où la question de savoir est-ce que notre société numérique nous sert, ou est-ce que nous nous adaptons à la machine ? On touche là à une inquiétude profonde : la société se digitalise si vite que le contact humain pourrait devenir un luxe.
On parle de “solitude connectée” : on est branché en permanence, mais on se sent parfois plus isolé. Dans nos vies hyperconnectées, la banque ne fait plus exception : applications mobiles, chatbots (programme ou application avec lequel les utilisateurs peuvent converser par le biais de la voix ou du texte), paiements instantanés… Tout est rapide, efficace et accessible depuis un smartphone. Mais derrière cette révolution digitale se cache un risque réel : la perte du contact humain, élément pourtant central dans la confiance et la relation client.
C’est un point tout à fait légitime, qui revient souvent dans les discussions sur la digitalisation, que ce soit dans la finance, l’administration ou même le commerce. La banque digitale, les FinTechs, les services automatisés offrent énormément de confort et d’efficacité, mais ils posent quand même un vrai dilemme : La déshumanisation.
Les clients ne voient plus de conseillers en chair et en os ; tout se fait via les applications, chatbot ou interface digitale. Les interactions humaines, les conseils personnalisés ou la simple dimension empathique disparait. Ce lien humain est pourtant aussi essentiel pour évaluer les besoins réels d’un client et détecter les situations de vulnérabilité.
La technologie valorise la vitesse et l’efficacité au détriment du dialogue et de l’écoute. Dans certains secteurs (santé, services financiers, éducation), cela peut affaiblir la confiance et la cohésion sociale. La dépendance aux machines et autres algorithmes peut créer un déséquilibre, entre ceux qui maîtrisent la tech et les autres, accentuant les inégalités.
Le phénomène dépasse la banque. Dans la santé, l’éducation ou les services publics, la technologie favorise la rapidité, mais peut affaiblir le lien social. L’obsession de l’efficacité transforme les interactions humaines en transactions froides et standardisées. De plus, la dépendance aux algorithmes crée un déclassement technologique : ceux qui maîtrisent la tech avancée bénéficient pleinement des services, tandis que les autres se retrouvent marginalisés.
Le futur du monde économique pourrait bien être façonné par ces acteurs digitaux. Leur avance technologique, leur agilité et leur proximité avec les usages quotidiens leur donnent un avantage décisif. Cependant, l’histoire n’est pas écrite. Les régulateurs, comme la BCEAO en Afrique de l’Ouest ou la BCE en Europe, auront le rôle crucial d’éviter que l’innovation ne devienne un risque systémique. De leur côté, les banques traditionnelles ne sont pas condamnées, car elles disposent d’un capital confiance et d’une expertise, encore irremplaçables.
Le monde économique d’aujourd’hui appartient déjà, en partie, aux fintechs. Celui de demain dépendra de la capacité des banques et des régulateurs à rattraper leur retard… ou à choisir de marcher aux côtés de ces nouveaux géants du clic.
L’illusion de la proximité
Les réseaux sociaux, services digitaux et assistants virtuels, donnent l’impression de proximité, mais c’est souvent une relation unilatérale ou médiatisée par un écran. Dans la banque, la santé, l’éducation ou le commerce, cette illusion peut masquer la vraie qualité du service ou du soutien. Les décisions basées sur l’IA ou les algorithmes (scoring de crédit, recommandations financières, tri des candidatures) sont rapides et efficaces. Mais elles suppriment le discernement humain, les nuances et la capacité à comprendre des situations uniques ou fragiles.
Cela peut entraîner des décisions injustes ou déshumanisantes sans qu’on s’en rende compte. Si tout devient transactionnel et numérique, les interactions humaines deviennent superficielles.
Le risque est grand de perdre de la solidarité dès lors que la dépendance à la technologie creuse les inégalités entre ceux qui maîtrisent la tech bénéficient pleinement, les autres qui du coup sont marginalisés. Les enfants et jeunes générations grandissent avec moins d’occasions d’apprentissage de l’empathie et de la communication réelle.
À l'ère numérique, nous sommes constamment connectés, mais paradoxalement, de nombreuses études révèlent une augmentation de la solitude et du sentiment d'isolement. Paradoxalement, être connecté en permanence ne protège pas de la solitude. Une étude menée en France a révélé que 62 % des jeunes de 18 à 24 ans se sentent régulièrement seuls, une situation exacerbée par la crise du Covid-19 (Le Monde.fr). Une enquête en Belgique a montré aussi que 54 % des jeunes entre 20 et 34 ans se sentent seuls (Mutualité chrétienne).
Ces chiffres suggèrent que, malgré une hyper-connectivité apparente, les individus, en particulier les jeunes, éprouvent une déconnexion émotionnelle croissante.
L'utilisation excessive des technologies numériques est également corrélée à des problèmes de santé mentale. Au Canada, une étude a révélé que les personnes passant plus de 20 heures par semaine sur Internet avaient une santé mentale perçue comme moins bonne que celles passant moins de temps en ligne (Statistique Canada). Une autre étude a montré que 90 % des jeunes isolés présentent au moins un trouble psychologique, tel que le stress, l'anxiété ou la dépression (prigenteliott.substack.com).
Ces données soulignent la nécessité de trouver un équilibre, entre l'utilisation des technologies, et le maintien de relations humaines authentiques pour préserver la santé mentale.
Demain appartient-il déjà aux fintechs ?
Dans le monde du travail, la digitalisation a transformé les interactions humaines. D’ailleurs, une étude a révélé que plus de la moitié des répondants considéraient que la technologie avait pour effet de déshumaniser la société, et diminuait les liens qu'ils entretenaient avec le monde réel (Randstad). Cette tendance est également observée dans les services à la clientèle, où l'automatisation et l'IA remplacent souvent les interactions humaines, réduisant ainsi l'empathie et la personnalisation du service.
Dans le service client, l’automatisation réduit l’empathie et la personnalisation. La rapidité et l’efficacité numériques ont donc un coût social et émotionnel. C’est le prix à payer. La fracture numérique qui en découle se mesure à l’aune des populations rurales, personnes âgées ou à faibles revenus. Ces derniers ont souvent un accès limité aux technologies renforçant ainsi l’isolement et les inégalités sociales.
La technologie peut enrichir nos vies et accélérer les services, mais si elle supprime le lien humain fondamental, elle risque de transformer la société en un réseau froid d’interactions superficielles. L’avenir sera humain ou ne sera pas.
Malick NDAW
On parle de “solitude connectée” : on est branché en permanence, mais on se sent parfois plus isolé. Dans nos vies hyperconnectées, la banque ne fait plus exception : applications mobiles, chatbots (programme ou application avec lequel les utilisateurs peuvent converser par le biais de la voix ou du texte), paiements instantanés… Tout est rapide, efficace et accessible depuis un smartphone. Mais derrière cette révolution digitale se cache un risque réel : la perte du contact humain, élément pourtant central dans la confiance et la relation client.
C’est un point tout à fait légitime, qui revient souvent dans les discussions sur la digitalisation, que ce soit dans la finance, l’administration ou même le commerce. La banque digitale, les FinTechs, les services automatisés offrent énormément de confort et d’efficacité, mais ils posent quand même un vrai dilemme : La déshumanisation.
Les clients ne voient plus de conseillers en chair et en os ; tout se fait via les applications, chatbot ou interface digitale. Les interactions humaines, les conseils personnalisés ou la simple dimension empathique disparait. Ce lien humain est pourtant aussi essentiel pour évaluer les besoins réels d’un client et détecter les situations de vulnérabilité.
La technologie valorise la vitesse et l’efficacité au détriment du dialogue et de l’écoute. Dans certains secteurs (santé, services financiers, éducation), cela peut affaiblir la confiance et la cohésion sociale. La dépendance aux machines et autres algorithmes peut créer un déséquilibre, entre ceux qui maîtrisent la tech et les autres, accentuant les inégalités.
Le phénomène dépasse la banque. Dans la santé, l’éducation ou les services publics, la technologie favorise la rapidité, mais peut affaiblir le lien social. L’obsession de l’efficacité transforme les interactions humaines en transactions froides et standardisées. De plus, la dépendance aux algorithmes crée un déclassement technologique : ceux qui maîtrisent la tech avancée bénéficient pleinement des services, tandis que les autres se retrouvent marginalisés.
Le futur du monde économique pourrait bien être façonné par ces acteurs digitaux. Leur avance technologique, leur agilité et leur proximité avec les usages quotidiens leur donnent un avantage décisif. Cependant, l’histoire n’est pas écrite. Les régulateurs, comme la BCEAO en Afrique de l’Ouest ou la BCE en Europe, auront le rôle crucial d’éviter que l’innovation ne devienne un risque systémique. De leur côté, les banques traditionnelles ne sont pas condamnées, car elles disposent d’un capital confiance et d’une expertise, encore irremplaçables.
Le monde économique d’aujourd’hui appartient déjà, en partie, aux fintechs. Celui de demain dépendra de la capacité des banques et des régulateurs à rattraper leur retard… ou à choisir de marcher aux côtés de ces nouveaux géants du clic.
L’illusion de la proximité
Les réseaux sociaux, services digitaux et assistants virtuels, donnent l’impression de proximité, mais c’est souvent une relation unilatérale ou médiatisée par un écran. Dans la banque, la santé, l’éducation ou le commerce, cette illusion peut masquer la vraie qualité du service ou du soutien. Les décisions basées sur l’IA ou les algorithmes (scoring de crédit, recommandations financières, tri des candidatures) sont rapides et efficaces. Mais elles suppriment le discernement humain, les nuances et la capacité à comprendre des situations uniques ou fragiles.
Cela peut entraîner des décisions injustes ou déshumanisantes sans qu’on s’en rende compte. Si tout devient transactionnel et numérique, les interactions humaines deviennent superficielles.
Le risque est grand de perdre de la solidarité dès lors que la dépendance à la technologie creuse les inégalités entre ceux qui maîtrisent la tech bénéficient pleinement, les autres qui du coup sont marginalisés. Les enfants et jeunes générations grandissent avec moins d’occasions d’apprentissage de l’empathie et de la communication réelle.
À l'ère numérique, nous sommes constamment connectés, mais paradoxalement, de nombreuses études révèlent une augmentation de la solitude et du sentiment d'isolement. Paradoxalement, être connecté en permanence ne protège pas de la solitude. Une étude menée en France a révélé que 62 % des jeunes de 18 à 24 ans se sentent régulièrement seuls, une situation exacerbée par la crise du Covid-19 (Le Monde.fr). Une enquête en Belgique a montré aussi que 54 % des jeunes entre 20 et 34 ans se sentent seuls (Mutualité chrétienne).
Ces chiffres suggèrent que, malgré une hyper-connectivité apparente, les individus, en particulier les jeunes, éprouvent une déconnexion émotionnelle croissante.
L'utilisation excessive des technologies numériques est également corrélée à des problèmes de santé mentale. Au Canada, une étude a révélé que les personnes passant plus de 20 heures par semaine sur Internet avaient une santé mentale perçue comme moins bonne que celles passant moins de temps en ligne (Statistique Canada). Une autre étude a montré que 90 % des jeunes isolés présentent au moins un trouble psychologique, tel que le stress, l'anxiété ou la dépression (prigenteliott.substack.com).
Ces données soulignent la nécessité de trouver un équilibre, entre l'utilisation des technologies, et le maintien de relations humaines authentiques pour préserver la santé mentale.
Demain appartient-il déjà aux fintechs ?
Dans le monde du travail, la digitalisation a transformé les interactions humaines. D’ailleurs, une étude a révélé que plus de la moitié des répondants considéraient que la technologie avait pour effet de déshumaniser la société, et diminuait les liens qu'ils entretenaient avec le monde réel (Randstad). Cette tendance est également observée dans les services à la clientèle, où l'automatisation et l'IA remplacent souvent les interactions humaines, réduisant ainsi l'empathie et la personnalisation du service.
Dans le service client, l’automatisation réduit l’empathie et la personnalisation. La rapidité et l’efficacité numériques ont donc un coût social et émotionnel. C’est le prix à payer. La fracture numérique qui en découle se mesure à l’aune des populations rurales, personnes âgées ou à faibles revenus. Ces derniers ont souvent un accès limité aux technologies renforçant ainsi l’isolement et les inégalités sociales.
La technologie peut enrichir nos vies et accélérer les services, mais si elle supprime le lien humain fondamental, elle risque de transformer la société en un réseau froid d’interactions superficielles. L’avenir sera humain ou ne sera pas.
Malick NDAW
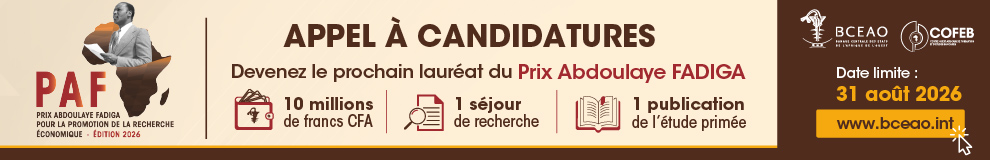

 chroniques
chroniques