C’est ainsi que l’Éthiopie était rapidement devenue l’une des principales prisons de journalistes de la planète.
Aujourd’hui, en présence du nouveau Premier ministre réformiste Abiy Ahmed, aux fonctions depuis seulement un an, l’Éthiopie a accompli tant de progrès dans la libération des journalistes incarcérés, et dans la levée des contrôles sur la presse, que le pays accueille cette année la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Mais il est encore trop tôt pour les célébrations. Certains organes de cette presse nouvellement libérée publient parfois de fausses informations – attisant les tensions ethniques, tribales, et s’attaquant à Abiy. À l’approche des premières élections libres depuis 15 ans dans le pays, qui auront lieu l’année prochaine, Abiy se retrouve dans la même situation que Meles autrefois, et envisage ainsi de rétablir certains contrôles sur la presse, qu’il avait pourtant abolis.
Avant de se lancer dans cette démarche, Abiy doit porter un regard attentif et critique sur la répression opérée par Meles, et sur la leçon qui s’en dégage : les journalistes sont irrépressibles, et tenter de les contrôler n’aboutit à rien sur le long terme. Cette démarche ne fait en réalité que retarder le développement de médias plus professionnels.
Meles avait formulé une justification simple aux actions de son gouvernement : « Nos journalistes ne sont pas professionnels comme aux États-Unis et en Europe occidentale », m’avait-il expliqué. « Ils ne savent pas rapporter les informations avec précision. Nous devons leur fixer des directives, le temps qu’ils apprennent à exercer leur métier. » S’il était encore en vie, Meles s’élèverait probablement aujourd’hui contre les « fake news ».
Au cours de plus de 30 années de lutte pour la liberté de la presse à travers le monde, et en tant que président de la première heure du Comité pour la protection des journalistes, j’ai très souvent entendu des arguments du même ordre que ceux de Meles. Les journalistes, insistent fréquemment les dirigeants des démocraties émergentes, devraient être contrôlés par l’État jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment compétents pour exercer leur travail avec responsabilité. Or, loin d’accélérer le développement d’une presse libre et crédible, cette approche l’entrave.
Après ma rencontre avec Meles, j’ai commencé à rechercher des preuves historiques susceptibles de fonder son affirmation selon laquelle le manque de professionnalisme journalistique justifiait d’étouffer la presse ; je pourrais ainsi contredire son argumentaire lors de notre prochaine rencontre. Je n’ai trouvé qu’un seul précédent, au début de l’histoire des États-Unis. J’ai d’ailleurs découvert que les mots employés par Meles étaient étrangement similaires aux arguments formulés au XVIIIe siècle par le président américain John Adams et ses fédéralistes, qui avaient autrefois dénoncé une presse libre et enthousiaste propagatrice de critiques – parfois légitimes, parfois infondées – à l’encontre des nouveaux dirigeants politiques du pays.
À l’époque, faisant valoir qu’une presse non contrôlée menacerait l’avenir de l’Amérique, Adams parvient temporairement à contenir les journalistes en 1798, via la signature des lois « Alien and Sedition Acts », qui autorisent l’incarcération et le prononcé d’amendes contre les journalistes qui « écrivent, impriment, formulent ou publient des informations fausses, scandaleuses et malveillantes » à l’encontre du gouvernement. Vingt rédacteurs en chef de journaux seront par la suite emprisonnés.
Mais Thomas Jefferson et ses républicains-démocrates vont s’opposer efficacement aux fédéralistes, à la fois au Congrès et devant les tribunaux. Et fort heureusement pour les journalistes américains, Jefferson sera élu président en 1800. En l’espace de deux ans, les lois sur les étrangers et la sédition arriveront à expiration ou seront abrogées. Ceci ouvrira la voie à une presse américaine qui pourra désormais expérimenter, et ainsi développer – pendant plus de deux siècles – une culture profonde et précise de l’information, faisant intervenir une vérification cohérente des faits.
Il n’existe pas de raccourci vers une presse libre et vivante ; une longue période d’essais et d’erreurs est nécessaire au développement des règles et institutions du journalisme professionnel. Les dirigeants politiques doivent faire confiance au processus – et garder la peau dure. Car si les lois répressives en matière de médias peuvent parfois bénéficier aux dirigeants à court terme, elles freinent à long terme le développement de la presse d’un pays tout entier.
Des preuves quantitatives de cet effet existent. Lorsque débute la Révolution française en 1789, les restrictions sur la presse sont levées. Quatre ans plus tard, on dénombre plus de 400 journaux dans le pays, dont 150 rien qu’à Paris. Dix ans plus tard, ce chiffre est passé à 1 300 au niveau national – autant de lieux permettant aux aspirants journalistes d’apprendre et d’affiner leur savoir-faire.
Mais la Révolution va prendre un virage répressif. Lorsque Napoléon Bonaparte gagne le pouvoir en 1799, le nombre de journaux parisiens est retombé à 72. Il passera bientôt à 13, puis à seulement quatre en 1811.
De même, après l’effondrement de l’Union soviétique, les médias de toutes sortes fleurissent. Certains des États successeurs nouvellement indépendants vont cependant adopter l’idée d’une nécessité d’imposer des « directives » aux médias. Beaucoup vont introduire des lois présentées comme garantes d’une presse libre, mais en réalité utilisées pour pénaliser les journalistes aux sujets trop agressifs et critiques. La diffamation deviendra passible de poursuites. De très lourdes amendes seront prononcées contre des publications, diffuseurs et autres blogueurs indépendants.
La Chine et la Turquie – toutes deux championnes de niveau olympique en matière d’emprisonnement de journalistes – ont renforcé la répression ces dernières années. De même, le mois dernier seulement, le président russe Vladimir Poutine a ratifié de nouvelles lois autorisant des sanctions contre les individus et médias en lignes qui propagent fake news et autres informations « irrespectueuses » à l’égard de l’État.
Le président américain Donald Trump s’efforce de prendre la même direction. Ses invectives constantes à l’encontre de journalistes qu’il qualifie de « menteurs » et d’« ennemis du peuple » rappellent l’injure préférée des nazis à l’endroit des médias : la Lügenpresse (ou presse mensongère).
Au sein même de l’Union européenne, les journalistes sont encore aujourd’hui emprisonnés pour diffamation et insulte au gouvernement, d’après une étude 2014 de l’International Press Institute. « La grande majorité des États de l’UE maintiennent des dispositions pénales en matière de diffamation, qui font de l’incarcération une sanction possible », rapporte l’IPI. « Des poursuites judiciaires demeurent mises en œuvre, et les journalistes continuent d’être condamnés à des peines criminelles ».
Permettre à la presse d’expérimenter, de commettre des erreurs, et d’en tirer les enseignements, constitue une démarche essentielle à la réussite de la démocratie à travers le monde. C’est la raison pour laquelle les gouvernements et la société civile doivent se montrer vigilants et œuvrer pour une presse libre, même lorsque – et particulièrement lorsque – cette presse demeure en phase de développement.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Josh Friedman, journaliste lauréat du Prix Pulitzer, a été président du Comité pour la protection des journalistes, et directeur des programmes internationaux de la Graduate School of Journalism de l’Université de Columbia. Il est préside aujourd’hui le conseil consultatif du Logan Nonfiction Program, siège au conseil consultatif du Dart Center on Journalism and Trauma, et exerce en tant que vice-président du Carey Institute for Global Good.
Aujourd’hui, en présence du nouveau Premier ministre réformiste Abiy Ahmed, aux fonctions depuis seulement un an, l’Éthiopie a accompli tant de progrès dans la libération des journalistes incarcérés, et dans la levée des contrôles sur la presse, que le pays accueille cette année la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Mais il est encore trop tôt pour les célébrations. Certains organes de cette presse nouvellement libérée publient parfois de fausses informations – attisant les tensions ethniques, tribales, et s’attaquant à Abiy. À l’approche des premières élections libres depuis 15 ans dans le pays, qui auront lieu l’année prochaine, Abiy se retrouve dans la même situation que Meles autrefois, et envisage ainsi de rétablir certains contrôles sur la presse, qu’il avait pourtant abolis.
Avant de se lancer dans cette démarche, Abiy doit porter un regard attentif et critique sur la répression opérée par Meles, et sur la leçon qui s’en dégage : les journalistes sont irrépressibles, et tenter de les contrôler n’aboutit à rien sur le long terme. Cette démarche ne fait en réalité que retarder le développement de médias plus professionnels.
Meles avait formulé une justification simple aux actions de son gouvernement : « Nos journalistes ne sont pas professionnels comme aux États-Unis et en Europe occidentale », m’avait-il expliqué. « Ils ne savent pas rapporter les informations avec précision. Nous devons leur fixer des directives, le temps qu’ils apprennent à exercer leur métier. » S’il était encore en vie, Meles s’élèverait probablement aujourd’hui contre les « fake news ».
Au cours de plus de 30 années de lutte pour la liberté de la presse à travers le monde, et en tant que président de la première heure du Comité pour la protection des journalistes, j’ai très souvent entendu des arguments du même ordre que ceux de Meles. Les journalistes, insistent fréquemment les dirigeants des démocraties émergentes, devraient être contrôlés par l’État jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment compétents pour exercer leur travail avec responsabilité. Or, loin d’accélérer le développement d’une presse libre et crédible, cette approche l’entrave.
Après ma rencontre avec Meles, j’ai commencé à rechercher des preuves historiques susceptibles de fonder son affirmation selon laquelle le manque de professionnalisme journalistique justifiait d’étouffer la presse ; je pourrais ainsi contredire son argumentaire lors de notre prochaine rencontre. Je n’ai trouvé qu’un seul précédent, au début de l’histoire des États-Unis. J’ai d’ailleurs découvert que les mots employés par Meles étaient étrangement similaires aux arguments formulés au XVIIIe siècle par le président américain John Adams et ses fédéralistes, qui avaient autrefois dénoncé une presse libre et enthousiaste propagatrice de critiques – parfois légitimes, parfois infondées – à l’encontre des nouveaux dirigeants politiques du pays.
À l’époque, faisant valoir qu’une presse non contrôlée menacerait l’avenir de l’Amérique, Adams parvient temporairement à contenir les journalistes en 1798, via la signature des lois « Alien and Sedition Acts », qui autorisent l’incarcération et le prononcé d’amendes contre les journalistes qui « écrivent, impriment, formulent ou publient des informations fausses, scandaleuses et malveillantes » à l’encontre du gouvernement. Vingt rédacteurs en chef de journaux seront par la suite emprisonnés.
Mais Thomas Jefferson et ses républicains-démocrates vont s’opposer efficacement aux fédéralistes, à la fois au Congrès et devant les tribunaux. Et fort heureusement pour les journalistes américains, Jefferson sera élu président en 1800. En l’espace de deux ans, les lois sur les étrangers et la sédition arriveront à expiration ou seront abrogées. Ceci ouvrira la voie à une presse américaine qui pourra désormais expérimenter, et ainsi développer – pendant plus de deux siècles – une culture profonde et précise de l’information, faisant intervenir une vérification cohérente des faits.
Il n’existe pas de raccourci vers une presse libre et vivante ; une longue période d’essais et d’erreurs est nécessaire au développement des règles et institutions du journalisme professionnel. Les dirigeants politiques doivent faire confiance au processus – et garder la peau dure. Car si les lois répressives en matière de médias peuvent parfois bénéficier aux dirigeants à court terme, elles freinent à long terme le développement de la presse d’un pays tout entier.
Des preuves quantitatives de cet effet existent. Lorsque débute la Révolution française en 1789, les restrictions sur la presse sont levées. Quatre ans plus tard, on dénombre plus de 400 journaux dans le pays, dont 150 rien qu’à Paris. Dix ans plus tard, ce chiffre est passé à 1 300 au niveau national – autant de lieux permettant aux aspirants journalistes d’apprendre et d’affiner leur savoir-faire.
Mais la Révolution va prendre un virage répressif. Lorsque Napoléon Bonaparte gagne le pouvoir en 1799, le nombre de journaux parisiens est retombé à 72. Il passera bientôt à 13, puis à seulement quatre en 1811.
De même, après l’effondrement de l’Union soviétique, les médias de toutes sortes fleurissent. Certains des États successeurs nouvellement indépendants vont cependant adopter l’idée d’une nécessité d’imposer des « directives » aux médias. Beaucoup vont introduire des lois présentées comme garantes d’une presse libre, mais en réalité utilisées pour pénaliser les journalistes aux sujets trop agressifs et critiques. La diffamation deviendra passible de poursuites. De très lourdes amendes seront prononcées contre des publications, diffuseurs et autres blogueurs indépendants.
La Chine et la Turquie – toutes deux championnes de niveau olympique en matière d’emprisonnement de journalistes – ont renforcé la répression ces dernières années. De même, le mois dernier seulement, le président russe Vladimir Poutine a ratifié de nouvelles lois autorisant des sanctions contre les individus et médias en lignes qui propagent fake news et autres informations « irrespectueuses » à l’égard de l’État.
Le président américain Donald Trump s’efforce de prendre la même direction. Ses invectives constantes à l’encontre de journalistes qu’il qualifie de « menteurs » et d’« ennemis du peuple » rappellent l’injure préférée des nazis à l’endroit des médias : la Lügenpresse (ou presse mensongère).
Au sein même de l’Union européenne, les journalistes sont encore aujourd’hui emprisonnés pour diffamation et insulte au gouvernement, d’après une étude 2014 de l’International Press Institute. « La grande majorité des États de l’UE maintiennent des dispositions pénales en matière de diffamation, qui font de l’incarcération une sanction possible », rapporte l’IPI. « Des poursuites judiciaires demeurent mises en œuvre, et les journalistes continuent d’être condamnés à des peines criminelles ».
Permettre à la presse d’expérimenter, de commettre des erreurs, et d’en tirer les enseignements, constitue une démarche essentielle à la réussite de la démocratie à travers le monde. C’est la raison pour laquelle les gouvernements et la société civile doivent se montrer vigilants et œuvrer pour une presse libre, même lorsque – et particulièrement lorsque – cette presse demeure en phase de développement.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Josh Friedman, journaliste lauréat du Prix Pulitzer, a été président du Comité pour la protection des journalistes, et directeur des programmes internationaux de la Graduate School of Journalism de l’Université de Columbia. Il est préside aujourd’hui le conseil consultatif du Logan Nonfiction Program, siège au conseil consultatif du Dart Center on Journalism and Trauma, et exerce en tant que vice-président du Carey Institute for Global Good.
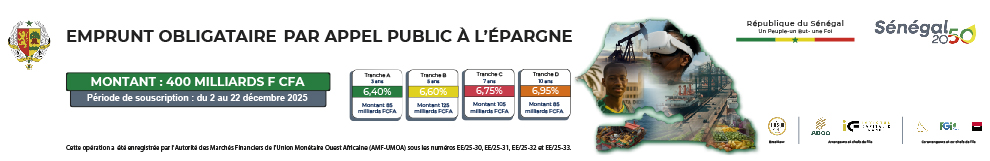

 chroniques
chroniques





















