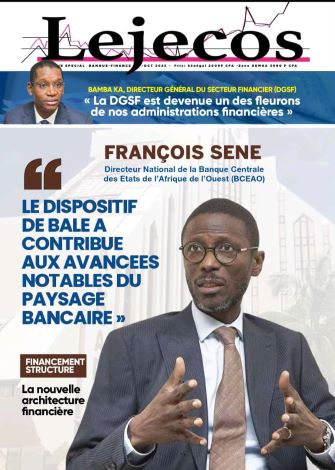Selon un communiqué , àv l’initiative de la Fondation Biovision, la rencontre a réuni décideurs politiques, institutions financières, investisseurs et société civile pour réfléchir aux moyens d’adapter les mécanismes financiers aux réalités des entreprises agro écologiques (Eae).
«Ces petites et moyennes structures, ancrées dans les territoires et engagées dans des pratiques durables, peinent depuis des années à accéder aux crédits classiques. Pourtant, elles représentent une alternative crédible aux modèles agricoles intensifs, longtemps privilégiés par les grandes institutions internationales », lit-on dans la note.
Pour Hawabai Abdulla, de la Banque de développement agricole de Tanzanie (Tadb), il faut aller au-delà des prêts : « Le financement doit être combiné à une assistance technique et à la sensibilisation, pour que les agriculteurs, les entrepreneurs et les marchés perçoivent pleinement les bénéfices de l’agroécologie. »
Hans von Zinkernagel, de la Fondation Biovision, a souligné l’importance de données probantes : « nous devons démontrer que les entreprises agroécologiques sont viables, rentables et créatrices d’impacts sociaux et environnementaux. ». Un rapport consolidé est prévu début 2026.
Selon Ruth Nabaggala, de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (Afsa), l’impact est déjà visible : « Dans huit pays, 300 entreprises agro écologiques améliorent les moyens de subsistance, créent des emplois, garantissent une alimentation saine et protègent l’environnement. ».
Les participants ont plaidé pour des mécanismes hybrides – crédits, appui technique, investissements à impact et politiques incitatives – afin de permettre aux entreprises agro écologiques de jouer un rôle central dans la transformation des systèmes alimentaires africains.
Adou FAYE
«Ces petites et moyennes structures, ancrées dans les territoires et engagées dans des pratiques durables, peinent depuis des années à accéder aux crédits classiques. Pourtant, elles représentent une alternative crédible aux modèles agricoles intensifs, longtemps privilégiés par les grandes institutions internationales », lit-on dans la note.
Pour Hawabai Abdulla, de la Banque de développement agricole de Tanzanie (Tadb), il faut aller au-delà des prêts : « Le financement doit être combiné à une assistance technique et à la sensibilisation, pour que les agriculteurs, les entrepreneurs et les marchés perçoivent pleinement les bénéfices de l’agroécologie. »
Hans von Zinkernagel, de la Fondation Biovision, a souligné l’importance de données probantes : « nous devons démontrer que les entreprises agroécologiques sont viables, rentables et créatrices d’impacts sociaux et environnementaux. ». Un rapport consolidé est prévu début 2026.
Selon Ruth Nabaggala, de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (Afsa), l’impact est déjà visible : « Dans huit pays, 300 entreprises agro écologiques améliorent les moyens de subsistance, créent des emplois, garantissent une alimentation saine et protègent l’environnement. ».
Les participants ont plaidé pour des mécanismes hybrides – crédits, appui technique, investissements à impact et politiques incitatives – afin de permettre aux entreprises agro écologiques de jouer un rôle central dans la transformation des systèmes alimentaires africains.
Adou FAYE
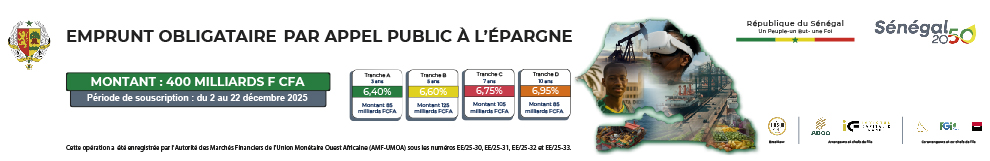

 chroniques
chroniques