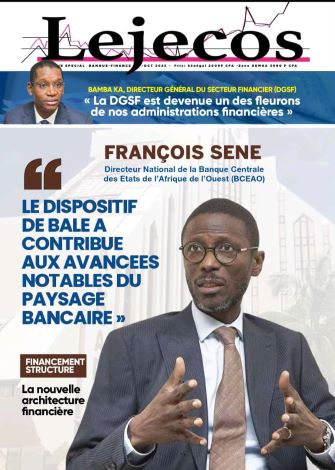Un être de parole et de paix, d’intelligence et de pudeur, qui traversa le siècle sans jamais cesser de croire en l’humain.
Un enfant de la Médina, un fils du monde
Dakar, 1921. Dans les ruelles encore sablonneuses de la Médina, un enfant apprend à lire entre deux langues — celle du Coran et celle des livres d’école. Son regard s’ouvre très tôt sur un monde complexe, mêlé d’Afrique et d’Occident, de prières et de récitations. De cette enfance, il gardera la douceur du rythme, la rigueur du savoir, et le goût de la nuance.
Rien encore ne dit qu’il deviendra ministre, diplomate, ou directeur général d’une grande institution mondiale.
Mais déjà, dans son silence attentif, il y a cette promesse d’écoute et de lumière. Il y a ce désir, humble et tenace, de comprendre avant de juger, de relier plutôt que d’opposer.
L’engagé sans uniformes
Engagé volontaire dans l’armée de l’air française durant la Seconde Guerre mondiale, il reçoit une première leçon de l’engagement et du service. Il a 18 ans.
Et pourtant, il choisit d’y aller. Non pas pour la gloire, mais par fidélité à une idée : celle du devoir, du courage et de la solidarité humaine.
Dans les ciels de guerre, il apprend la fragilité de la vie, mais aussi la grandeur du lien. Plus tard, il dira :
« J’ai vu des hommes de toutes couleurs risquer leur vie pour sauver celle des autres. C’est là que j’ai compris ce que voulait dire “fraternité”. » (Propos rapporté dans une interview à la RTS (2004) à propos de la Seconde Guerre mondiale).
De ce combat, il ne ramènera ni décorations ni amertume. Seulement une certitude : l’humanité n’a de sens que lorsqu’elle se partage.
L’éducateur aux mains nues
Après la guerre, il reprend le chemin des livres.
La Sorbonne, Paris, la rigueur du savoir. Mais aussi les nuits de réflexion, les débats entre jeunes Africains, les rêves d’indépendance et de dignité.
Quand il revient au Sénégal, c’est avec une mission : faire de l’école un lieu d’éveil, pas d’assimilation. Dans les villages, il s’assied à même le sol, écoute les anciens, parle aux enfants.
Il enseigne en wolof, en français, en gestes parfois — car pour lui, enseigner, c’est parler le langage du cœur.
Amadou Mahtar Mbow croyait en une éducation qui libère, pas celle qui formate. Une école qui apprenne à penser, pas à répéter. Une école qui embrasse le monde, sans renier ses racines.
Son engagement finit par le conduire aux plus hautes fonctions nationales : ministre de l’Éducation, puis ministre de la Culture et de la Jeunesse. Mais c’est sur la scène internationale qu’il portera le plus haut la voix de l’Afrique.
L’homme de l’UNESCO
Un jour, l’Afrique entre par sa voix dans les couloirs de l’UNESCO. Nous sommes en 1974. Amadou Mahtar Mbow devient le premier Africain à diriger l’organisation.
Il n’y arrive pas avec un drapeau, mais avec une idée : que la culture est une arme de paix, que l’éducation est le plus beau des droits, et que la parole du Sud mérite d’être entendue.
Sous son mandat, il porte le rêve d’un Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication, où chaque peuple pourrait raconter sa propre histoire. Certains le trouvent trop audacieux. D’autres le disent idéaliste. Mais Mbow ne fléchit pas. Il sait qu’aucune idée n’est trop grande quand elle sert la justice.
Ses adversaires l’accuseront d’utopie, certains États quitteront l’organisation, mais Mbow ne fléchira pas. « On ne construit pas la paix en imposant le silence à ceux qu’on n’écoute jamais », répétait-il.
Sous sa direction, l’UNESCO défendra aussi la diversité culturelle, l’éducation pour tous et la sauvegarde du patrimoine mondial.
Pendant ses 13 ans à la tête de l’institution (1974-1987), il militera pour : une éducation accessible à tous, en particulier dans le Sud ; la reconnaissance de la diversité des cultures et la lutte contre un modèle unique hégémonique ; la question du « Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication » (NOMIC), plaidant pour un rééquilibrage des flux d’information entre Nord et Sud. (RTS Officiel)
Son mandat ne fut pas exempt de controverses, mais son impact a été profond et durable.
Sa voix, calme et ferme, s’élève au-dessus du tumulte. Ses mots ne sont pas des slogans, mais des ponts. Des passerelles entre des mondes qui s’ignorent, mais que lui savait rapprocher.
L’homme derrière le titre
Son passage à l’UNESCO reste un modèle d’intégrité et de courage. Son humilité, une leçon à méditer dans un monde souvent bruyant.
Amadou Mahtar Mbow laisse derrière lui une trace lumineuse, celle des hommes qui n’ont jamais cessé de croire au pouvoir de l’esprit et de la parole. Dans les salons feutrés des Nations unies, il garde la simplicité d’un homme de Dakar. Toujours le sourire discret, le regard qui observe avant de parler. Il ne s’impose pas, il inspire. Il n’exige pas, il convainc.
Ceux qui l’ont côtoyé se souviennent d’un homme de paix, de patience et d’humour. D’un intellectuel sans arrogance, d’un sage qui préférait la nuance au dogme. « C’était un phare sans éclats, disait un collègue. Sa lumière venait de l’intérieur. » (Formule métaphorique qu’on pourrait qualifier d’apocryphe élégante — autrement dit, elle exprime une vérité poétique).
Le retour au pays, le legs d’un sage
Quand il quitte l’UNESCO, il rentre à Dakar. Non pour se reposer, mais pour transmettre. Il participe aux grandes réflexions sur l’éducation, la jeunesse, la mémoire.
Et quand, en 2021, le Sénégal célèbre son centenaire, le pays entier lui rend hommage : colloques, expositions, poèmes, chants d’écoliers.
L’Université Amadou Mahtar Mbow porte désormais son nom — juste retour d’un destin consacré à l’intelligence. Mais lui, dans sa modestie, souriait à peine. Il disait simplement :
« J’ai essayé de servir. Le reste appartient au temps. » (Reformulation poétique de sa réponse à une interview de la RTS (1999)
Même après son retrait de la vie internationale et politique, il demeure une boussole pour les éducateurs, les diplomates, les acteurs de culture et de développement.
L’éternité discrète
Amadou Mahtar Mbow s’est éteint en 2024.
Cent-trois ans de vie. Un siècle de combats paisibles. Et pourtant, ceux qui parlent de lui n’utilisent pas le passé. Ils disent : Mbow est là.
Dans les voix d’enfants qui apprennent à lire. Dans les professeurs qui refusent de céder au découragement. Dans les diplomates qui croient encore à la force du dialogue.
Son héritage ne se compte pas en institutions ni en discours.
Il se mesure à la trace invisible qu’il a laissée dans les consciences. Celle d’un homme debout, dans un monde souvent agenouillé devant la facilité.
Son centenaire n’est pas seulement une date. C’est un appel à poursuivre son combat pour une humanité éclairée, instruite, tolérante.
La voix du sage
A la question du plus grand défi de l’Afrique, il aimait à rappeler : « Il s’agit d’apprendre à se regarder avec fierté, mais sans arrogance ; à aimer son passé sans s’y enfermer ; et à bâtir son avenir avec tous les autres. »
C’est cette phrase, peut-être, qui résume tout Amadou Mahtar Mbow.
Un homme debout. Un homme de ponts, non de murs.
Un homme qui, à cent ans, incarnait encore la jeunesse du monde à qui il voulait laisser : « L’idée qu’il faut marcher longtemps, mais ne jamais marcher seul. »
C’était cela, Amadou Mahtar Mbow. Un homme qui croyait à la lenteur des choses vraies. Un homme qui savait que l’éducation est une prière. Un homme de paix, qui fit de la parole un art du lien.
Aujourd’hui, le monde qu’il a tant voulu éclairer continue sa course. Mais quelque part, dans le vent de Dakar, on pourrait presque entendre sa voix, douce et ferme, nous rappeler :
« L’avenir appartient à ceux qui savent écouter. » (Reformulation d’un propos sur le dialogue Nord-Sud qu’il développa à plusieurs reprises (UNESCO, 1978)).
Malick NDAW
Un enfant de la Médina, un fils du monde
Dakar, 1921. Dans les ruelles encore sablonneuses de la Médina, un enfant apprend à lire entre deux langues — celle du Coran et celle des livres d’école. Son regard s’ouvre très tôt sur un monde complexe, mêlé d’Afrique et d’Occident, de prières et de récitations. De cette enfance, il gardera la douceur du rythme, la rigueur du savoir, et le goût de la nuance.
Rien encore ne dit qu’il deviendra ministre, diplomate, ou directeur général d’une grande institution mondiale.
Mais déjà, dans son silence attentif, il y a cette promesse d’écoute et de lumière. Il y a ce désir, humble et tenace, de comprendre avant de juger, de relier plutôt que d’opposer.
L’engagé sans uniformes
Engagé volontaire dans l’armée de l’air française durant la Seconde Guerre mondiale, il reçoit une première leçon de l’engagement et du service. Il a 18 ans.
Et pourtant, il choisit d’y aller. Non pas pour la gloire, mais par fidélité à une idée : celle du devoir, du courage et de la solidarité humaine.
Dans les ciels de guerre, il apprend la fragilité de la vie, mais aussi la grandeur du lien. Plus tard, il dira :
« J’ai vu des hommes de toutes couleurs risquer leur vie pour sauver celle des autres. C’est là que j’ai compris ce que voulait dire “fraternité”. » (Propos rapporté dans une interview à la RTS (2004) à propos de la Seconde Guerre mondiale).
De ce combat, il ne ramènera ni décorations ni amertume. Seulement une certitude : l’humanité n’a de sens que lorsqu’elle se partage.
L’éducateur aux mains nues
Après la guerre, il reprend le chemin des livres.
La Sorbonne, Paris, la rigueur du savoir. Mais aussi les nuits de réflexion, les débats entre jeunes Africains, les rêves d’indépendance et de dignité.
Quand il revient au Sénégal, c’est avec une mission : faire de l’école un lieu d’éveil, pas d’assimilation. Dans les villages, il s’assied à même le sol, écoute les anciens, parle aux enfants.
Il enseigne en wolof, en français, en gestes parfois — car pour lui, enseigner, c’est parler le langage du cœur.
Amadou Mahtar Mbow croyait en une éducation qui libère, pas celle qui formate. Une école qui apprenne à penser, pas à répéter. Une école qui embrasse le monde, sans renier ses racines.
Son engagement finit par le conduire aux plus hautes fonctions nationales : ministre de l’Éducation, puis ministre de la Culture et de la Jeunesse. Mais c’est sur la scène internationale qu’il portera le plus haut la voix de l’Afrique.
L’homme de l’UNESCO
Un jour, l’Afrique entre par sa voix dans les couloirs de l’UNESCO. Nous sommes en 1974. Amadou Mahtar Mbow devient le premier Africain à diriger l’organisation.
Il n’y arrive pas avec un drapeau, mais avec une idée : que la culture est une arme de paix, que l’éducation est le plus beau des droits, et que la parole du Sud mérite d’être entendue.
Sous son mandat, il porte le rêve d’un Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication, où chaque peuple pourrait raconter sa propre histoire. Certains le trouvent trop audacieux. D’autres le disent idéaliste. Mais Mbow ne fléchit pas. Il sait qu’aucune idée n’est trop grande quand elle sert la justice.
Ses adversaires l’accuseront d’utopie, certains États quitteront l’organisation, mais Mbow ne fléchira pas. « On ne construit pas la paix en imposant le silence à ceux qu’on n’écoute jamais », répétait-il.
Sous sa direction, l’UNESCO défendra aussi la diversité culturelle, l’éducation pour tous et la sauvegarde du patrimoine mondial.
Pendant ses 13 ans à la tête de l’institution (1974-1987), il militera pour : une éducation accessible à tous, en particulier dans le Sud ; la reconnaissance de la diversité des cultures et la lutte contre un modèle unique hégémonique ; la question du « Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication » (NOMIC), plaidant pour un rééquilibrage des flux d’information entre Nord et Sud. (RTS Officiel)
Son mandat ne fut pas exempt de controverses, mais son impact a été profond et durable.
Sa voix, calme et ferme, s’élève au-dessus du tumulte. Ses mots ne sont pas des slogans, mais des ponts. Des passerelles entre des mondes qui s’ignorent, mais que lui savait rapprocher.
L’homme derrière le titre
Son passage à l’UNESCO reste un modèle d’intégrité et de courage. Son humilité, une leçon à méditer dans un monde souvent bruyant.
Amadou Mahtar Mbow laisse derrière lui une trace lumineuse, celle des hommes qui n’ont jamais cessé de croire au pouvoir de l’esprit et de la parole. Dans les salons feutrés des Nations unies, il garde la simplicité d’un homme de Dakar. Toujours le sourire discret, le regard qui observe avant de parler. Il ne s’impose pas, il inspire. Il n’exige pas, il convainc.
Ceux qui l’ont côtoyé se souviennent d’un homme de paix, de patience et d’humour. D’un intellectuel sans arrogance, d’un sage qui préférait la nuance au dogme. « C’était un phare sans éclats, disait un collègue. Sa lumière venait de l’intérieur. » (Formule métaphorique qu’on pourrait qualifier d’apocryphe élégante — autrement dit, elle exprime une vérité poétique).
Le retour au pays, le legs d’un sage
Quand il quitte l’UNESCO, il rentre à Dakar. Non pour se reposer, mais pour transmettre. Il participe aux grandes réflexions sur l’éducation, la jeunesse, la mémoire.
Et quand, en 2021, le Sénégal célèbre son centenaire, le pays entier lui rend hommage : colloques, expositions, poèmes, chants d’écoliers.
L’Université Amadou Mahtar Mbow porte désormais son nom — juste retour d’un destin consacré à l’intelligence. Mais lui, dans sa modestie, souriait à peine. Il disait simplement :
« J’ai essayé de servir. Le reste appartient au temps. » (Reformulation poétique de sa réponse à une interview de la RTS (1999)
Même après son retrait de la vie internationale et politique, il demeure une boussole pour les éducateurs, les diplomates, les acteurs de culture et de développement.
L’éternité discrète
Amadou Mahtar Mbow s’est éteint en 2024.
Cent-trois ans de vie. Un siècle de combats paisibles. Et pourtant, ceux qui parlent de lui n’utilisent pas le passé. Ils disent : Mbow est là.
Dans les voix d’enfants qui apprennent à lire. Dans les professeurs qui refusent de céder au découragement. Dans les diplomates qui croient encore à la force du dialogue.
Son héritage ne se compte pas en institutions ni en discours.
Il se mesure à la trace invisible qu’il a laissée dans les consciences. Celle d’un homme debout, dans un monde souvent agenouillé devant la facilité.
Son centenaire n’est pas seulement une date. C’est un appel à poursuivre son combat pour une humanité éclairée, instruite, tolérante.
La voix du sage
A la question du plus grand défi de l’Afrique, il aimait à rappeler : « Il s’agit d’apprendre à se regarder avec fierté, mais sans arrogance ; à aimer son passé sans s’y enfermer ; et à bâtir son avenir avec tous les autres. »
C’est cette phrase, peut-être, qui résume tout Amadou Mahtar Mbow.
Un homme debout. Un homme de ponts, non de murs.
Un homme qui, à cent ans, incarnait encore la jeunesse du monde à qui il voulait laisser : « L’idée qu’il faut marcher longtemps, mais ne jamais marcher seul. »
C’était cela, Amadou Mahtar Mbow. Un homme qui croyait à la lenteur des choses vraies. Un homme qui savait que l’éducation est une prière. Un homme de paix, qui fit de la parole un art du lien.
Aujourd’hui, le monde qu’il a tant voulu éclairer continue sa course. Mais quelque part, dans le vent de Dakar, on pourrait presque entendre sa voix, douce et ferme, nous rappeler :
« L’avenir appartient à ceux qui savent écouter. » (Reformulation d’un propos sur le dialogue Nord-Sud qu’il développa à plusieurs reprises (UNESCO, 1978)).
Malick NDAW
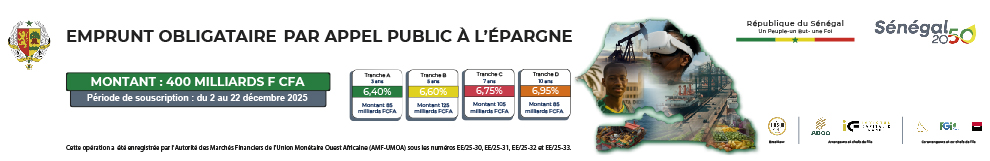

 chroniques
chroniques