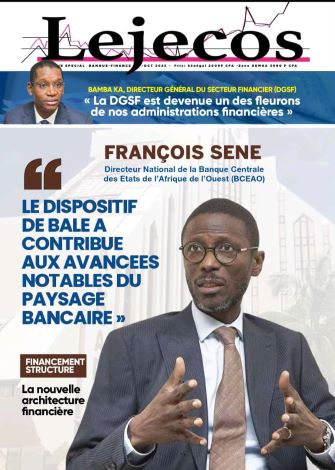Cette célébration annuelle doit agir, sur nous tous, comme une piqûre de rappel : les enjeux de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre revêtent une importance capitale pour le développement durable. Pourquoi ?
« Alliances et solidarité » : c’est le thème choisi cette année pour la journée IDAHOT. S’unir, c’est être solidaire des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI). Mais pas seulement. S’unir, c’est aussi agir collectivement pour mieux lutter contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.
Mais qui dit identités multiples dit exclusions multiples : une personne LGBTI et handicapée risque de faire doublement l’objet de discriminations et de stigmatisation. Une « double peine » qui peut être synonyme d’une plus grande vulnérabilité à l’exclusion sociale et à la violence.
Le constat est flagrant dans les phénomènes de harcèlement scolaire.
Et les conséquences sont les mêmes pour les personnes handicapées et LGBTI : les discriminations et les violences scolaires ont pour effet de limiter leurs possibilités d’étudier et, par conséquent, leurs possibilités d’emploi, les privant ainsi durablement d’opportunités économiques.
S’allier pour favoriser une prospérité partagée
Même exclusion, même combat : nous devons nous soutenir les uns les autres, et cela passe par des alliances qui renforcent notre action.
Les exemples ne manquent pas dans l’histoire des luttes pour l’égalité des droits. En Afrique du Sud, ce sont des groupes religieux qui se sont unis pour combattre l’apartheid. Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques s’est associé à de nombreux alliés en dehors des cercles afro-américains pour défendre l’égalité raciale et obtenir finalement sa reconnaissance dans la loi. Et on pourrait en dire autant du mouvement pour les droits des femmes.
Aujourd’hui, nous appliquons les leçons du passé : nous nous associons à tout l’éventail de nos interlocuteurs dans le monde entier — décideurs politiques, organisations de la société civile, milieux universitaires, autres organisations de développement — pour
Banquemondiale
« Alliances et solidarité » : c’est le thème choisi cette année pour la journée IDAHOT. S’unir, c’est être solidaire des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI). Mais pas seulement. S’unir, c’est aussi agir collectivement pour mieux lutter contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.
Des « handicaps » qui se cumulent
Origine ethnique, sexe, identité raciale, sexuelle ou de genre, etc. : tout individu a de multiples identités, perçues ou réelles, par lesquelles la société le reconnaît ou qui sont le reflet de la manière dont il se définit lui-même.Mais qui dit identités multiples dit exclusions multiples : une personne LGBTI et handicapée risque de faire doublement l’objet de discriminations et de stigmatisation. Une « double peine » qui peut être synonyme d’une plus grande vulnérabilité à l’exclusion sociale et à la violence.
Le constat est flagrant dans les phénomènes de harcèlement scolaire.
Et les conséquences sont les mêmes pour les personnes handicapées et LGBTI : les discriminations et les violences scolaires ont pour effet de limiter leurs possibilités d’étudier et, par conséquent, leurs possibilités d’emploi, les privant ainsi durablement d’opportunités économiques.
S’allier pour favoriser une prospérité partagée
Même exclusion, même combat : nous devons nous soutenir les uns les autres, et cela passe par des alliances qui renforcent notre action.
Les exemples ne manquent pas dans l’histoire des luttes pour l’égalité des droits. En Afrique du Sud, ce sont des groupes religieux qui se sont unis pour combattre l’apartheid. Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques s’est associé à de nombreux alliés en dehors des cercles afro-américains pour défendre l’égalité raciale et obtenir finalement sa reconnaissance dans la loi. Et on pourrait en dire autant du mouvement pour les droits des femmes.
Aujourd’hui, nous appliquons les leçons du passé : nous nous associons à tout l’éventail de nos interlocuteurs dans le monde entier — décideurs politiques, organisations de la société civile, milieux universitaires, autres organisations de développement — pour
Banquemondiale
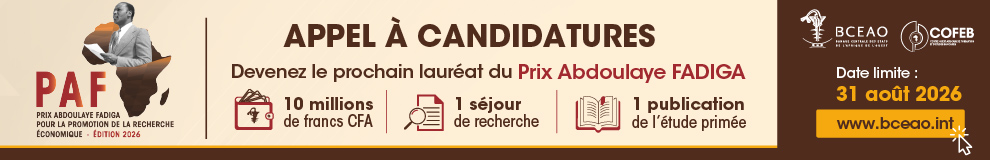

 chroniques
chroniques