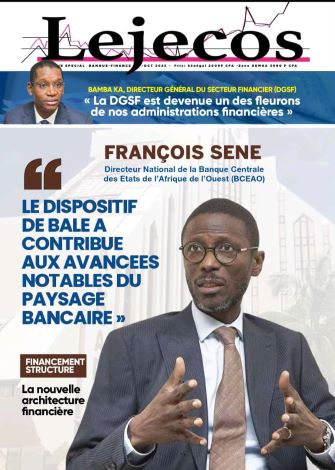Le propre des pays comme le nôtre est que le travail salarié est l'exception et non la règle. Au Sénégal, selon l’ANSD, dans son rapport « d’Enquête sur l’Emploi, la Rémunération et les Heures de travail » publié en 2024, le nombre d’employés salariés dans le secteur des entreprises formelles est évalué à 335 653 salariés et dans celui du secteur public à peu près 130 000 soit en cumul un peu moins de 500 000. Alors que la population en âge de travailler 11 662 633 selon le rapport « Enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal (ENES) Premier trimestre 2025 » publié par l’ANSD.
De ce fait, l’entrepreneuriat et le travail indépendant constituent un important vecteur d’inclusion économique et social. Selon une étude de la Banque mondiale, dans les pays à faible revenu, 7 % seulement des femmes de 15 ans et plus sont salariées, contre 18 % des hommes.
Bâtir des dynamiques économiques inclusives : l’entrepreneuriat féminin un levier incontournable
Il est important de relever que la prise en charge des problématiques du statut de la femme et de leur autonomisation est devenue une priorité mondiale depuis quelques décennies. En effet, la tenue de conférences internationales sur la condition féminine (Mexico 1975 ; Copenhague en 1980 ; Nairobi en 1985 et Beijing en 1995) en est des preuves tangibles (cf : Politiques publiques de promotion de l’entrepreneuriat féminin au Sénégal, Edition Harmattan). Celles-ci ont beaucoup contribué à l’éveil des consciences dans le monde avec une batterie de recommandations et de résolutions portant, entre autres, sur la valorisation du potentiel économique des femmes dans nos différentes économies.
Au niveau africain, dans l’aspiration 6 de l’Agenda 2063 publié en 2015, les points suivants sont mis en exergue :
• la réalisation de l’égalité complète entre les hommes et les femmes dans tous les domaines tels que les droits sociaux, politiques et économiques, y compris le droit de propriété et d’héritage, de signer un contrat, d’enregistrer et de gérer une entreprise ;
• l’accès des femmes rurales aux moyens de production, y compris à la terre, au crédit, aux intrants et aux services financiers.
Au niveau de la CEDEAO, L’article 63 du traité révisé stipule que les États membres s’engagent à élaborer, harmoniser, coordonner et définir des politiques et des mécanismes appropriés pour améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles des femmes en prenant toutes les mesures nécessaires.
Le Traité modifié de l’UEMOA, notamment le protocole additionnel n° 2, relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA, dispose en son article 2 que « l’Union met en œuvre des actions communes en vue de créer un cadre favorable au renforcement du rôle de la femme dans l’intégration régionale et le développement économique et social des pays membres ».
Aussi, le Conseil des ministres, par décision n° 03-2018/CM/UEMOA du 29 juin 2028, a adopté la stratégie Genre de l’Union pour la période 2018-2027, dont l’objectif est de « contribuer à la promotion d’un environnement institutionnel communautaire favorable à l’égalité et l’équité entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques, politique, social, et culturel, au moyen d’une approche transversale du Genre dans les politiques, programmes, les projets, les budgets et dans les pratiques managériales des États membres et des organes de l’UEMOA ».
Au Sénégal, la mise en œuvre de ces recommandations a permis l’implémentation à partir des années 2000 de mécanismes et directions d’appui à l’entrepreneuriat féminin (cf : Politiques publiques de promotion de l’entrepreneuriat féminin au Sénégal, Edition Harmattan). A cette époque, les principaux défis étaient l’accès au capital pour le démarrage d’une activité économique, la formation et le renforcement des méthodes de production et de transformation de qualité, la disponibilité des emballages en quantité et en qualité.
Une évaluation objective a permis de relever que le Sénégal a réalisé des progrès considérables de valorisation du statut économique de la femme. L’accès des femmes au capital est aujourd’hui une réalité, même s’il reste encore un grand chemin à parcourir.
La combinaison des efforts de l’Etat à travers ses mécanismes d’accompagnement et le système financier (SFD, Banques) montrent que du chemin a été fait et les femmes sont de plus en plus considérées non pas comme des couches vulnérables mais de véritables agents économiques rationnels capables de prendre des décisions opportunes et créer de la valeur. Récemment, le Système financier décentralisé U-IMCEC a lancé un nouveau produit financier dénommé les « Lingères de U-IMCEC » avec des financements de 5 à 50 millions de francs FCFA et un dispositif de coaching de proximité. L’objectif visé est d’accompagner la transition d’activités génératrices de revenus vers une véritable entreprise telle que pensé par Schumpeter c’est-à-dire le lieu de création de la valeur par l’innovation.
Cela n’est qu’un exemple par rapport à la panoplie de produits financiers repensés et réadaptés proposés par le secteur financier y compris aussi les banques qui adressent de plus en plus ce segment de notre économie. En ce qui concerne les mécanismes de l’Etat, la bonification du taux d’intérêt et l’allégement de la garantie ont considérablement renforcé le secteur de l’entrepreneuriat féminin.
De même, dans les services non financiers, d’importants progrès sont constatés dans le renforcement du capital humain en faveur des femmes ainsi que le goût du risque et la confiance en soi. L’intégration par le secteur financier, surtout les institutions de microfinance dans leur chaine de financement le volet renforcement de capacités est une réalité. Du coté des politiques publiques, il est à noter les avancées plus que notoires, surtout dans le secteur de la transformation de produits locaux grâce aux interventions de divers acteurs tels que 3FPT, ADEPME, ITA, ASN, … Aujourd’hui, le défi est bien pris en compte. La comparaison des emballages que les femmes utilisaient au début des années 2000 par rapport à nos jours en est une parfaite illustration. Il suffit juste de faire un tour au niveau des grandes surfaces pour en être convaincu. La qualité des produits aussi, s’est fortement améliorée avec un système de maitrise de la traçabilité depuis l’étape de matières premières jusqu’au produit fini. De même que l’élargissement de la capacité de production. Ainsi, le véritable challenge qui reste, pour nos femmes, est celui de la recherche de nouveaux consommateurs tant interne qu’externe.
La conquête de nouveaux marchés : un déterminant fondamental pour l’autonomisation économique des femmes
Les politiques publiques d’autonomisation économiques des femmes doivent, aujourd’hui se projetées sur les opportunités de marchés potentiels et/ou réelles et le cadre d’intervention pour en tirer le maximum de profit d’abord au niveau individuel et ensuite sur le plan de la macroéconomie. Potentiellement, le Sénégal est un marché de 18 millions de consommateurs, l’UEMOA de 148 millions et la CEDEAO de 440 millions ainsi que les énormes opportunités qu’offrent la ZLECAF. De ce fait, des stratégies offensives de captation ou de renforcement de nouveaux marchés doivent être pensées. Celles-ci doivent cependant, être déployées avec organisation et méthode pour plus de maîtrise. Je reste convaincu que le développement c’est d’abord à la base, à travers des stratégies organisationnelles dynamiques par cercles concentriques. Ainsi, par rapport à l’accès au marché, les collectivités locales doivent jouer un rôle important de positionnement de leur terroir mais aussi les agents économiques qui y résident (organisations de femmes ; etc…).
La confiance et la notoriété s’acquièrent d’abord au niveau local. A cet effet, la mise en œuvre de politiques de territorialisation devient un puissant levier de promotion de produits locaux transformés. Les collectivités territoriales doivent favoriser promotion des produits du terroir à travers des rencontres à caractère économiques (l’organisation de foires locales pour renforcer la visibilité des produits des femmes entrepreneures et leur permettre de nouer des partenariats commerciaux, la mise à disposition d’infrastructures de soutien ect). Cette approche permettra aux collectivités locales de devenir de véritables catalyseurs de développement économique territorial, capables de transformer les initiatives entrepreneuriales locales en moteur de croissance inclusive. Ainsi, il s’agira pour les collectivités locales, de promouvoir les produits locaux mais aussi de récupérer des taxes par conséquent d’élargir son budget et sa capacité d’intervention.
En prenant l’exemple de la farine infantile enrichie, qui est un marché estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. S’il y a un secteur où les femmes sont les plus présentes c’est la transformation de produits locaux. En positionnant nos femmes sur ce segment de marché, on aura avancé considérablement sur deux points importants de notre quête de souveraineté :
De ce fait, l’entrepreneuriat et le travail indépendant constituent un important vecteur d’inclusion économique et social. Selon une étude de la Banque mondiale, dans les pays à faible revenu, 7 % seulement des femmes de 15 ans et plus sont salariées, contre 18 % des hommes.
Bâtir des dynamiques économiques inclusives : l’entrepreneuriat féminin un levier incontournable
Il est important de relever que la prise en charge des problématiques du statut de la femme et de leur autonomisation est devenue une priorité mondiale depuis quelques décennies. En effet, la tenue de conférences internationales sur la condition féminine (Mexico 1975 ; Copenhague en 1980 ; Nairobi en 1985 et Beijing en 1995) en est des preuves tangibles (cf : Politiques publiques de promotion de l’entrepreneuriat féminin au Sénégal, Edition Harmattan). Celles-ci ont beaucoup contribué à l’éveil des consciences dans le monde avec une batterie de recommandations et de résolutions portant, entre autres, sur la valorisation du potentiel économique des femmes dans nos différentes économies.
Au niveau africain, dans l’aspiration 6 de l’Agenda 2063 publié en 2015, les points suivants sont mis en exergue :
• la réalisation de l’égalité complète entre les hommes et les femmes dans tous les domaines tels que les droits sociaux, politiques et économiques, y compris le droit de propriété et d’héritage, de signer un contrat, d’enregistrer et de gérer une entreprise ;
• l’accès des femmes rurales aux moyens de production, y compris à la terre, au crédit, aux intrants et aux services financiers.
Au niveau de la CEDEAO, L’article 63 du traité révisé stipule que les États membres s’engagent à élaborer, harmoniser, coordonner et définir des politiques et des mécanismes appropriés pour améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles des femmes en prenant toutes les mesures nécessaires.
Le Traité modifié de l’UEMOA, notamment le protocole additionnel n° 2, relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA, dispose en son article 2 que « l’Union met en œuvre des actions communes en vue de créer un cadre favorable au renforcement du rôle de la femme dans l’intégration régionale et le développement économique et social des pays membres ».
Aussi, le Conseil des ministres, par décision n° 03-2018/CM/UEMOA du 29 juin 2028, a adopté la stratégie Genre de l’Union pour la période 2018-2027, dont l’objectif est de « contribuer à la promotion d’un environnement institutionnel communautaire favorable à l’égalité et l’équité entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques, politique, social, et culturel, au moyen d’une approche transversale du Genre dans les politiques, programmes, les projets, les budgets et dans les pratiques managériales des États membres et des organes de l’UEMOA ».
Au Sénégal, la mise en œuvre de ces recommandations a permis l’implémentation à partir des années 2000 de mécanismes et directions d’appui à l’entrepreneuriat féminin (cf : Politiques publiques de promotion de l’entrepreneuriat féminin au Sénégal, Edition Harmattan). A cette époque, les principaux défis étaient l’accès au capital pour le démarrage d’une activité économique, la formation et le renforcement des méthodes de production et de transformation de qualité, la disponibilité des emballages en quantité et en qualité.
Une évaluation objective a permis de relever que le Sénégal a réalisé des progrès considérables de valorisation du statut économique de la femme. L’accès des femmes au capital est aujourd’hui une réalité, même s’il reste encore un grand chemin à parcourir.
La combinaison des efforts de l’Etat à travers ses mécanismes d’accompagnement et le système financier (SFD, Banques) montrent que du chemin a été fait et les femmes sont de plus en plus considérées non pas comme des couches vulnérables mais de véritables agents économiques rationnels capables de prendre des décisions opportunes et créer de la valeur. Récemment, le Système financier décentralisé U-IMCEC a lancé un nouveau produit financier dénommé les « Lingères de U-IMCEC » avec des financements de 5 à 50 millions de francs FCFA et un dispositif de coaching de proximité. L’objectif visé est d’accompagner la transition d’activités génératrices de revenus vers une véritable entreprise telle que pensé par Schumpeter c’est-à-dire le lieu de création de la valeur par l’innovation.
Cela n’est qu’un exemple par rapport à la panoplie de produits financiers repensés et réadaptés proposés par le secteur financier y compris aussi les banques qui adressent de plus en plus ce segment de notre économie. En ce qui concerne les mécanismes de l’Etat, la bonification du taux d’intérêt et l’allégement de la garantie ont considérablement renforcé le secteur de l’entrepreneuriat féminin.
De même, dans les services non financiers, d’importants progrès sont constatés dans le renforcement du capital humain en faveur des femmes ainsi que le goût du risque et la confiance en soi. L’intégration par le secteur financier, surtout les institutions de microfinance dans leur chaine de financement le volet renforcement de capacités est une réalité. Du coté des politiques publiques, il est à noter les avancées plus que notoires, surtout dans le secteur de la transformation de produits locaux grâce aux interventions de divers acteurs tels que 3FPT, ADEPME, ITA, ASN, … Aujourd’hui, le défi est bien pris en compte. La comparaison des emballages que les femmes utilisaient au début des années 2000 par rapport à nos jours en est une parfaite illustration. Il suffit juste de faire un tour au niveau des grandes surfaces pour en être convaincu. La qualité des produits aussi, s’est fortement améliorée avec un système de maitrise de la traçabilité depuis l’étape de matières premières jusqu’au produit fini. De même que l’élargissement de la capacité de production. Ainsi, le véritable challenge qui reste, pour nos femmes, est celui de la recherche de nouveaux consommateurs tant interne qu’externe.
La conquête de nouveaux marchés : un déterminant fondamental pour l’autonomisation économique des femmes
Les politiques publiques d’autonomisation économiques des femmes doivent, aujourd’hui se projetées sur les opportunités de marchés potentiels et/ou réelles et le cadre d’intervention pour en tirer le maximum de profit d’abord au niveau individuel et ensuite sur le plan de la macroéconomie. Potentiellement, le Sénégal est un marché de 18 millions de consommateurs, l’UEMOA de 148 millions et la CEDEAO de 440 millions ainsi que les énormes opportunités qu’offrent la ZLECAF. De ce fait, des stratégies offensives de captation ou de renforcement de nouveaux marchés doivent être pensées. Celles-ci doivent cependant, être déployées avec organisation et méthode pour plus de maîtrise. Je reste convaincu que le développement c’est d’abord à la base, à travers des stratégies organisationnelles dynamiques par cercles concentriques. Ainsi, par rapport à l’accès au marché, les collectivités locales doivent jouer un rôle important de positionnement de leur terroir mais aussi les agents économiques qui y résident (organisations de femmes ; etc…).
La confiance et la notoriété s’acquièrent d’abord au niveau local. A cet effet, la mise en œuvre de politiques de territorialisation devient un puissant levier de promotion de produits locaux transformés. Les collectivités territoriales doivent favoriser promotion des produits du terroir à travers des rencontres à caractère économiques (l’organisation de foires locales pour renforcer la visibilité des produits des femmes entrepreneures et leur permettre de nouer des partenariats commerciaux, la mise à disposition d’infrastructures de soutien ect). Cette approche permettra aux collectivités locales de devenir de véritables catalyseurs de développement économique territorial, capables de transformer les initiatives entrepreneuriales locales en moteur de croissance inclusive. Ainsi, il s’agira pour les collectivités locales, de promouvoir les produits locaux mais aussi de récupérer des taxes par conséquent d’élargir son budget et sa capacité d’intervention.
En prenant l’exemple de la farine infantile enrichie, qui est un marché estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. S’il y a un secteur où les femmes sont les plus présentes c’est la transformation de produits locaux. En positionnant nos femmes sur ce segment de marché, on aura avancé considérablement sur deux points importants de notre quête de souveraineté :
- d’abord, la captation de l’enveloppe financière par des agents économiques internes avec effets directs en termes de redistribution de revenus et de bien-être aux populations donc de croissance endogène et inclusive ;
- ensuite, les aspects liés à la souveraineté alimentaire et aussi à la gestion des questions de santé publique avec certains produits infantiles importés.
Au Sénégal, selon les statistiques de l’ANSD « Enquêtes de Démographie et de Santé de 2023 », 18 % des enfants de moins de cinq ans présentent un retard de croissance ou une malnutrition chronique ; 4 % des enfants présentent un retard de croissance sévère. Le positionnement de l’entrepreneuriat féminin sur ce secteur peut davantage aider à améliorer ces statistiques. Cela est d’autant plus vrai que les produits transformés proposés sont souvent issus de fruits du terroir suivant des périodes déterminées de l’année. Ce qui donne des gammes de produits diversifiés à des prix modérés et accessibles tant au niveau urbain que rural.
L’entrepreneuriat féminin et la commande publique : une relation à repenser
Concernant la promotion de l’accès des femmes à la commande publique, il est prévu à l’article 29 du décret sur les marchés publics une marge de préférence de 2% applicable aux entreprises dont l’actionnariat majoritaire est détenu par des femmes. Cette préférence pour les entreprises de femmes représente un marché potentiel global de 60 milliards de FCFA sur la commande publique estimée à 3 000 milliards de FCFA soit 17% du PIB. Au constat, les entreprises de femmes ont encore du mal à absorber cette enveloppe. Selon les statistiques, le poids des entrepreneures dans la commande publique globale est de l’ordre de 1% soit 30 milliards de FCFA. Cela appelle à repenser l’opérationnalisation de ce puissant levier de promotion de l’entrepreneuriat féminin. La disponibilité de statistiques sur la structuration de l’enveloppe absorbée et les différents marchés concernés (biens et services, prestations de services, travaux etc…) aurait permis de mieux affiner l’analyse.
A mon avis, pour être en droite ligne avec les orientations des nouvelles autorités, une bonne partie de cette enveloppe doit cibler des biens et services à forte composition à la base de produits locaux. En reprenant l’exemple des collectivités locales, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition surtout infantile doivent être amenées à accompagner les structures sanitaires, écoles, daraas avec des produits à base de farines enrichies améliorées en fonction du niveau de leur budget. Cette enveloppe va être réservée, sous forme de marché, aux entreprises de femmes (Réseaux de groupement, entreprises individuelle, coopérative de femmes …). Cette émulation de l’économie au niveau local sur toute la chaine de valeur (de la cueillette à la transformation) aura aussi des effets positifs sur l’amélioration de la malnutrition infantile et par conséquent sur la qualité de l’enseignement.
Il s’agit de repenser, au-delà des aspects importants de formation et d’information sur les procédures de passation, les voies et moyens d’utiliser cet important instrument de politique publique à mieux dynamiser les économies locales et favoriser l’émulation d’un secteur privé local fort ainsi qu’un leadership féminin affirmé. Cela à la lumière de la nouvelle stratégie d’érection de nouveaux pôles de développement au niveau national.
Je suis d’autant plus optimiste en écoutant Monsieur le Premier Ministre, lors du lancement de Dakar Ville Métropole 2050, revenir sur le rôle éminemment économique que doivent jouer les collectivités locales en perspective dans l’acte 4 de la décentralisation.
Abdoulaye Dayibou SECK
Administrateur Fonds national de Promotion de l’entreprenariat féminin
L’entrepreneuriat féminin et la commande publique : une relation à repenser
Concernant la promotion de l’accès des femmes à la commande publique, il est prévu à l’article 29 du décret sur les marchés publics une marge de préférence de 2% applicable aux entreprises dont l’actionnariat majoritaire est détenu par des femmes. Cette préférence pour les entreprises de femmes représente un marché potentiel global de 60 milliards de FCFA sur la commande publique estimée à 3 000 milliards de FCFA soit 17% du PIB. Au constat, les entreprises de femmes ont encore du mal à absorber cette enveloppe. Selon les statistiques, le poids des entrepreneures dans la commande publique globale est de l’ordre de 1% soit 30 milliards de FCFA. Cela appelle à repenser l’opérationnalisation de ce puissant levier de promotion de l’entrepreneuriat féminin. La disponibilité de statistiques sur la structuration de l’enveloppe absorbée et les différents marchés concernés (biens et services, prestations de services, travaux etc…) aurait permis de mieux affiner l’analyse.
A mon avis, pour être en droite ligne avec les orientations des nouvelles autorités, une bonne partie de cette enveloppe doit cibler des biens et services à forte composition à la base de produits locaux. En reprenant l’exemple des collectivités locales, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition surtout infantile doivent être amenées à accompagner les structures sanitaires, écoles, daraas avec des produits à base de farines enrichies améliorées en fonction du niveau de leur budget. Cette enveloppe va être réservée, sous forme de marché, aux entreprises de femmes (Réseaux de groupement, entreprises individuelle, coopérative de femmes …). Cette émulation de l’économie au niveau local sur toute la chaine de valeur (de la cueillette à la transformation) aura aussi des effets positifs sur l’amélioration de la malnutrition infantile et par conséquent sur la qualité de l’enseignement.
Il s’agit de repenser, au-delà des aspects importants de formation et d’information sur les procédures de passation, les voies et moyens d’utiliser cet important instrument de politique publique à mieux dynamiser les économies locales et favoriser l’émulation d’un secteur privé local fort ainsi qu’un leadership féminin affirmé. Cela à la lumière de la nouvelle stratégie d’érection de nouveaux pôles de développement au niveau national.
Je suis d’autant plus optimiste en écoutant Monsieur le Premier Ministre, lors du lancement de Dakar Ville Métropole 2050, revenir sur le rôle éminemment économique que doivent jouer les collectivités locales en perspective dans l’acte 4 de la décentralisation.
Abdoulaye Dayibou SECK
Administrateur Fonds national de Promotion de l’entreprenariat féminin
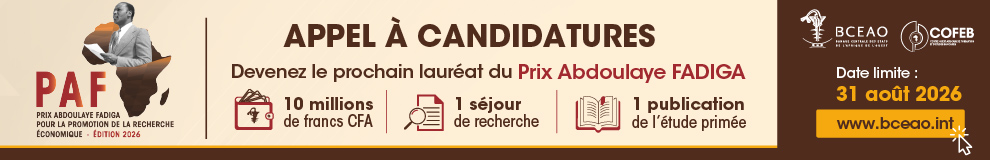

 chroniques
chroniques