
Jeffrey D. Sachs est professeur de développement durable, professeur en politique et gestion de la santé, et directeur du Earth Institute de l’Université de Columbia
La stratégie mise en œuvre par les États-Unis en Syrie se fonde sur la combinaison étrange – et inefficace – de deux piliers de la politique étrangère américaine. Le premier réside dans l'establishment sécuritaire des États-Unis, composé par l'armée et les agences de renseignement, appuyées par de fervents soutiens au Congrès. Le second réside dans une communauté de défense des droits de l'Homme. Cette combinaison spécifique a pu s'observer à travers plusieurs guerres récentes menées par l'Amérique au Moyen-Orient et en Afrique. Malheureusement, les résultats se sont systématiquement révélés dévastateurs.
L'establishment sécuritaire du pays s'appuie sur une tendance de longue date consistant pour les dirigeants politique américains à recourir à la force militaire et aux opérations secrètes afin de renverser des régimes jugés nuisibles aux intérêts américains. Qu'il s'agisse du renversement du gouvernement démocratiquement élu de Mohammad Mossadegh en Iran en 1953, qu'il s'agisse de l' « autre 11 septembre » (coup d'État militaire soutenu par les États-Unis en 1973 contre le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende au Chili), ou plus récemment des épisode d'Afghanistan, d'Irak, de Lybie, et désormais de Syrie, la sécurité de l'Amérique passe depuis bien longtemps par l'exercice des changements de régime.
Dans le même temps, certains acteurs de la communauté des droits de l'Homme ont soutenu plusieurs interventions militaires américaines récentes, en invoquant la « responsabilité de protéger », dite R2P. Cette doctrine, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU en 2005, énonce l'obligation pour la communauté internationale d'intervenir afin de protéger une population civile lorsque celle-ci subit en masse la violence de son propre gouvernement. Face à la brutalité d'un Saddam Hussein, d'un Mouammar Kadhafi ou d'un Bachar el-Assad, certains défenseurs des droits de l'Homme se rallient à la cause de l'establishment sécuritaire américain, tandis que la Chine, la Russie et d'autres considèrent la R2P comme le prétexte des changements de régime imposés par les Américains.
Seulement voilà, et c'est l'enseignement que les défenseurs des droits de l'Homme auraient dû tirer depuis bien longtemps, le modèle appliqué par la sécurité américaine aux fins des changements de régime ne fonctionne tout simplement pas. Les solutions de fortune censées protéger les populations locales et les intérêts américains dégénèrent bien souvent en chaos, anarchie, guerres civiles et autres crises humanitaires vouées à se propager, comme ce fut la cas en Afghanistan, en Irak, en Lybie, et désormais en Syrie. Par ailleurs, les risques d'échec sont décuplés dès lors que le Conseil de sécurité de l'ONU dans son ensemble ne vient pas soutenir le pan militaire de l'intervention.
L'intervention américaine en Syrie trouve également racine dans les décisions prises par l'establishment sécuritaire américain il y a un quart de siècle, à l'époque du renversement de régimes appuyés par les soviétiques au Moyen-Orient. Comme l'a expliqué le Secrétaire de la Défense de l'époque Paul Wolfowitz au général Wesley Clark en 1991 : « Nous savons désormais pouvoir intervenir militairement dans la région en toute impunité, sans que les soviétiques ne fassent quoi que ce soit pour nous arrêter... [Nous avons] encore cinq à dix ans pour nettoyer tous ces régimes favorables à l’ex-Union soviétique – Irak, Syrie, et les autres – avant que la prochaine superpuissance [la Chine] n’émerge et vienne nous défier dans la région. »
Au lendemain des attentats perpétrés par Al-Qaïda aux États-Unis le 11 septembre 2001, l'attaque fut utilisé comme prétexte par la sécurité américaine pour lancer la guerre qu'elle attendait depuis longtemps, destinée à renverser Saddam. Lorsqu'ont éclaté les soulèvements du Printemps arabe dix ans plus tard, l'establishment sécuritaire américain a considéré la soudaine vulnérabilité des régimes de Kadhafi ou d'Assad comme une opportunité similaire, susceptible de permettre l'installation de nouveaux régimes en Lybie et en Syrie. Telle était la théorie à appliquer, d'une manière ou d'une autre.
Dans le cas de la Syrie, les alliés régionaux de l'Amérique ont également encouragé l'administration du président Barack Obama à intervenir contre Assad. L'Arabie Saoudite entendait voir partir Assad afin d'affaiblir un état satellite de l'Iran, principal rival du royaume sur le chemin de la suprématie régionale. Israël le souhaitait également, afin de fragiliser les voies par lesquelles l'Iran approvisionne le Hezbollah au sud du Liban. La Turquie espérait elle aussi voir partir Assad, afin d'étendre sa portée stratégique et de stabiliser ses frontières au sud.
La communauté humanitaire s'est jointe au concert du changement de régime lorsqu'Assad a répondu aux manifestants du Printemps arabe, et à leurs demandes de libéralisation politique, en déployant une armée de soldats et de paramilitaires. Entre mars et août 2011, les troupes d'Assad ont tué près de 2 000 personnes. C'est à partir de cette période qu'Obama a déclaré qu'Assad devait « s'en aller ».
Nous ignorons la pleine étendue des agissements américains en Syrie après cette période. Sur le plan diplomatique, les États-Unis ont créé le groupe des « Amis de la Syrie », principalement composé de pays occidentaux et d'alliés au Moyen-Orient, déterminés à renverser Assad. La CIA a commencé à travailler secrètement avec la Turquie afin d'approvisionner en armes, en financements et autres aides la fameuse « Armée syrienne libre », ainsi que d'autres groupes d'insurgés combattant pour le renversement d'Assad.
Ces démarches ont eu pour résultat un véritable désastre. Après une moyenne mensuelle de 500 morts entre mars et août 2011, pas moins de 100 000 civils – 3 200 par mois – ont été tués entre septembre 2011 et avril 2015, le nombre total de décès, combattants inclus, ayant semble-t-il atteint 310 000, soit 10 000 par mois. Par ailleurs, l'État islamique et autres violents groupes extrémistes venant capitaliser sur l'anarchie engendrée par la guerre civile, les perspectives de paix apparaissent plus lointaines que jamais.
Menées ou appuyées par les États-Unis, les interventions militaires américaines d'Afghanistan, d'Irak et de Lybie ont toutes engendré des catastrophes similaires. C'est une chose que de renverser un régime politique ; le remplacer par un gouvernement stable et légitime en est une autre.
Si les États-Unis entendent produire de meilleurs résultats, il leur faut cesser d'agir seuls. L'Amérique ne peut continuer d'imposer sa volonté de manière unilatérale, et continuer de rallier contre elle d'autres puissances majeures parmi lesquelles la Chine et la Russie. Tout comme les États-Unis, la Russie trouve un solide intérêt dans une stabilité en Syrie, et dans une défaite de l'État islamique ; elle n'a toutefois aucun intérêt à permettre aux États-Unis d'installer les régimes de leur choix en Syrie ou ailleurs dans la région. C'est la raison pour laquelle ont jusqu'à présent échoué tous les efforts fournis par le Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire émerger une position commune autour de la question syrienne.
Le chemin de l'ONU peut – et doit – être emprunté à nouveau. La conclusion d'un pacte nucléaire entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (États-Unis, Chine, France, Russie et Royaume-Uni), accompagnés de l'Allemagne, vient tout juste de fournir une puissante démonstration des capacités des leadership du Conseil. Celui-ci peut également être décisif en Syrie, si l'Amérique consent à mettre de côté sa volonté unilatérale de changement de régime, et accepte de travailler avec les autres membres du Conseil, y compris aux côtés de la Chine et de la Russie, autour d'une approche commune.
Dans le cas Syrien, seul le multilatéralisme pourra l'emporter. L'ONU demeure à ce jour le meilleur espoir – et en réalité le seul – de stopper le massacre syrien, ainsi que le torrent de réfugiés vers l'Europe.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Jeffrey D. Sachs est professeur de développement durable, professeur en politique et gestion de la santé, et directeur du Earth Institute de l’Université de Columbia. Il est également conseiller spécial auprès du Secrétaire général des Nations Unies sur la question des Objectifs du millénaire pour le développement.
© Project Syndicate 1995–2015
L'establishment sécuritaire du pays s'appuie sur une tendance de longue date consistant pour les dirigeants politique américains à recourir à la force militaire et aux opérations secrètes afin de renverser des régimes jugés nuisibles aux intérêts américains. Qu'il s'agisse du renversement du gouvernement démocratiquement élu de Mohammad Mossadegh en Iran en 1953, qu'il s'agisse de l' « autre 11 septembre » (coup d'État militaire soutenu par les États-Unis en 1973 contre le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende au Chili), ou plus récemment des épisode d'Afghanistan, d'Irak, de Lybie, et désormais de Syrie, la sécurité de l'Amérique passe depuis bien longtemps par l'exercice des changements de régime.
Dans le même temps, certains acteurs de la communauté des droits de l'Homme ont soutenu plusieurs interventions militaires américaines récentes, en invoquant la « responsabilité de protéger », dite R2P. Cette doctrine, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU en 2005, énonce l'obligation pour la communauté internationale d'intervenir afin de protéger une population civile lorsque celle-ci subit en masse la violence de son propre gouvernement. Face à la brutalité d'un Saddam Hussein, d'un Mouammar Kadhafi ou d'un Bachar el-Assad, certains défenseurs des droits de l'Homme se rallient à la cause de l'establishment sécuritaire américain, tandis que la Chine, la Russie et d'autres considèrent la R2P comme le prétexte des changements de régime imposés par les Américains.
Seulement voilà, et c'est l'enseignement que les défenseurs des droits de l'Homme auraient dû tirer depuis bien longtemps, le modèle appliqué par la sécurité américaine aux fins des changements de régime ne fonctionne tout simplement pas. Les solutions de fortune censées protéger les populations locales et les intérêts américains dégénèrent bien souvent en chaos, anarchie, guerres civiles et autres crises humanitaires vouées à se propager, comme ce fut la cas en Afghanistan, en Irak, en Lybie, et désormais en Syrie. Par ailleurs, les risques d'échec sont décuplés dès lors que le Conseil de sécurité de l'ONU dans son ensemble ne vient pas soutenir le pan militaire de l'intervention.
L'intervention américaine en Syrie trouve également racine dans les décisions prises par l'establishment sécuritaire américain il y a un quart de siècle, à l'époque du renversement de régimes appuyés par les soviétiques au Moyen-Orient. Comme l'a expliqué le Secrétaire de la Défense de l'époque Paul Wolfowitz au général Wesley Clark en 1991 : « Nous savons désormais pouvoir intervenir militairement dans la région en toute impunité, sans que les soviétiques ne fassent quoi que ce soit pour nous arrêter... [Nous avons] encore cinq à dix ans pour nettoyer tous ces régimes favorables à l’ex-Union soviétique – Irak, Syrie, et les autres – avant que la prochaine superpuissance [la Chine] n’émerge et vienne nous défier dans la région. »
Au lendemain des attentats perpétrés par Al-Qaïda aux États-Unis le 11 septembre 2001, l'attaque fut utilisé comme prétexte par la sécurité américaine pour lancer la guerre qu'elle attendait depuis longtemps, destinée à renverser Saddam. Lorsqu'ont éclaté les soulèvements du Printemps arabe dix ans plus tard, l'establishment sécuritaire américain a considéré la soudaine vulnérabilité des régimes de Kadhafi ou d'Assad comme une opportunité similaire, susceptible de permettre l'installation de nouveaux régimes en Lybie et en Syrie. Telle était la théorie à appliquer, d'une manière ou d'une autre.
Dans le cas de la Syrie, les alliés régionaux de l'Amérique ont également encouragé l'administration du président Barack Obama à intervenir contre Assad. L'Arabie Saoudite entendait voir partir Assad afin d'affaiblir un état satellite de l'Iran, principal rival du royaume sur le chemin de la suprématie régionale. Israël le souhaitait également, afin de fragiliser les voies par lesquelles l'Iran approvisionne le Hezbollah au sud du Liban. La Turquie espérait elle aussi voir partir Assad, afin d'étendre sa portée stratégique et de stabiliser ses frontières au sud.
La communauté humanitaire s'est jointe au concert du changement de régime lorsqu'Assad a répondu aux manifestants du Printemps arabe, et à leurs demandes de libéralisation politique, en déployant une armée de soldats et de paramilitaires. Entre mars et août 2011, les troupes d'Assad ont tué près de 2 000 personnes. C'est à partir de cette période qu'Obama a déclaré qu'Assad devait « s'en aller ».
Nous ignorons la pleine étendue des agissements américains en Syrie après cette période. Sur le plan diplomatique, les États-Unis ont créé le groupe des « Amis de la Syrie », principalement composé de pays occidentaux et d'alliés au Moyen-Orient, déterminés à renverser Assad. La CIA a commencé à travailler secrètement avec la Turquie afin d'approvisionner en armes, en financements et autres aides la fameuse « Armée syrienne libre », ainsi que d'autres groupes d'insurgés combattant pour le renversement d'Assad.
Ces démarches ont eu pour résultat un véritable désastre. Après une moyenne mensuelle de 500 morts entre mars et août 2011, pas moins de 100 000 civils – 3 200 par mois – ont été tués entre septembre 2011 et avril 2015, le nombre total de décès, combattants inclus, ayant semble-t-il atteint 310 000, soit 10 000 par mois. Par ailleurs, l'État islamique et autres violents groupes extrémistes venant capitaliser sur l'anarchie engendrée par la guerre civile, les perspectives de paix apparaissent plus lointaines que jamais.
Menées ou appuyées par les États-Unis, les interventions militaires américaines d'Afghanistan, d'Irak et de Lybie ont toutes engendré des catastrophes similaires. C'est une chose que de renverser un régime politique ; le remplacer par un gouvernement stable et légitime en est une autre.
Si les États-Unis entendent produire de meilleurs résultats, il leur faut cesser d'agir seuls. L'Amérique ne peut continuer d'imposer sa volonté de manière unilatérale, et continuer de rallier contre elle d'autres puissances majeures parmi lesquelles la Chine et la Russie. Tout comme les États-Unis, la Russie trouve un solide intérêt dans une stabilité en Syrie, et dans une défaite de l'État islamique ; elle n'a toutefois aucun intérêt à permettre aux États-Unis d'installer les régimes de leur choix en Syrie ou ailleurs dans la région. C'est la raison pour laquelle ont jusqu'à présent échoué tous les efforts fournis par le Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire émerger une position commune autour de la question syrienne.
Le chemin de l'ONU peut – et doit – être emprunté à nouveau. La conclusion d'un pacte nucléaire entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (États-Unis, Chine, France, Russie et Royaume-Uni), accompagnés de l'Allemagne, vient tout juste de fournir une puissante démonstration des capacités des leadership du Conseil. Celui-ci peut également être décisif en Syrie, si l'Amérique consent à mettre de côté sa volonté unilatérale de changement de régime, et accepte de travailler avec les autres membres du Conseil, y compris aux côtés de la Chine et de la Russie, autour d'une approche commune.
Dans le cas Syrien, seul le multilatéralisme pourra l'emporter. L'ONU demeure à ce jour le meilleur espoir – et en réalité le seul – de stopper le massacre syrien, ainsi que le torrent de réfugiés vers l'Europe.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Jeffrey D. Sachs est professeur de développement durable, professeur en politique et gestion de la santé, et directeur du Earth Institute de l’Université de Columbia. Il est également conseiller spécial auprès du Secrétaire général des Nations Unies sur la question des Objectifs du millénaire pour le développement.
© Project Syndicate 1995–2015
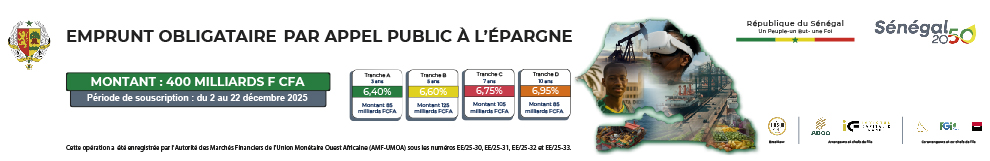

 chroniques
chroniques




















