
De gauche à droite : Joseph Stiglitz et Martin Guzman
En septembre l'ONU a fait un grand pas en avant pour combler ce vide en adoptant 9 principes pour la restructuration des dettes souveraines : le droit des Etats à entamer une restructuration, leur immunité, le traitement équitable des créanciers, la règle majoritaire (avec l'exigence d'une très forte majorité), la transparence, l’impartialité, la légitimité, la durabilité et la bonne foi dans les négociations.
Ces principes constituent les bases d'une législation internationale efficace. Ils bénéficient d'un très large soutien, 136 pays ayant voté en leur faveur et seulement 6 contre (avec à leur tête les USA), ce qui traduit la reconnaissance quasi général de la nécessité de résoudre en temps voulu les crises liées aux dettes souveraines. Mais l'étape suivante (un traité international créant un cadre juridique contraignant pour tous les pays) pourrait s'avérer beaucoup plus difficile.
De récents événements soulignent les énormes risques liés à l'absence d'une législation applicable à la restructuration des dettes souveraines. Ainsi la crise de la dette de Porto Rico ne peut être résolue, notamment parce que les tribunaux américains ont abrogé la loi de ce territoire en matière de faillite. Ils ont jugé que l'île étant de fait une colonie des USA, son gouvernement n'a pas autorité pour promulguer sa propre législation.
Dans le cas de l'Argentine, un tribunal de New-York a autorisé une petite minorité de "fonds vautours" à mettre en danger une restructuration approuvée par 92,4% des créanciers du pays. Dans le cas de la Grèce, c'est aussi en grande partie l'absence d'une législation internationale qui a permis à ses créanciers – la troïka constituée par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI – de lui imposer une politique qui lui a été néfaste.
Mais certaines organisations dotées de pouvoirs importants ne sont pas loin d'établir un cadre juridique international. L'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA), soutenue par le FMI et par le Trésor américain, propose de modifier le vocabulaire des contrats de prêt. Le point clé de sa proposition consiste à améliorer les clauses d'action collective. Un processus de restructuration approuvé par une forte majorité de créanciers serait alors contraignant pour tous les autres.
Cela compliquerait sûrement la vie des fonds vautours, mais ce n'est pas une solution d'ensemble. Régler au plus fin les contrats de prêt ne résout pas des problèmes cruciaux. D'une certaine façon, cela pérennise les défauts du système actuel – voire même les aggrave.
Ainsi la proposition de l'ICMA laisse sans réponse la question de savoir comment résoudre un conflit lorsque des obligations sont émises dans des cadres juridiques différents et dépendent de juridictions différentes. Le droit des contrats est efficace lorsqu'il y a une seule classe d'obligations ; mais lorsqu'elles sont émises dans des juridictions différentes et en devises différentes, la proposition de l'ICMA ne résout pas le difficile problème de l'agrégation : comment pondérer le vote des différents requérants ?
Par ailleurs, la proposition de l'ICMA favorise une collusion entre les principaux centres financiers : pour activer les clauses d'action collective, seuls compteraient les votes des créanciers détenteurs d'obligations provenant d'un ensemble limité de juridictions. Et cette proposition ne remédie pas à l'inégalité de traitement entre créanciers reconnus et créanciers de fait (les retraités et les travailleurs dont les débiteurs ont d'autres obligations prioritaires) qui n'auraient pas droit au chapitre quant à une restructuration.
Les 6 pays qui ont voté contre la résolution de l'ONU (les USA, le Canada, l'Allemagne, Israël, le Japon et le Royaume-Uni) disposent d'une législation sur les faillites, car ils estiment que les clauses d'action collective ne sont pas suffisantes. Pourtant ils ne veulent pas qu'une législation nationale s'applique au niveau international. Ils s'opposent notamment aux dispositions destinées à protéger les emprunteurs en position de faiblesse contre des créanciers puissants, prêts à abuser de leur pouvoir. C'est peut-être parce que ce sont tous d'importants pays créanciers qui ne veulent pas de limitation de leur pouvoir.
Les 9 principes de l'ONU ont été bafoués au cours des dernières décennies. En 2012 par exemple, la restructuration de la dette grecque n'a pas restauré la durabilité, puisqu'il a fallu procéder à une nouvelle restructuration seulement 3 ans plus tard. Le non-respect de l'immunité des Etats et du traitement équitable des créanciers est devenu quasiment la norme, comme l'a montré la décision du tribunal de New-York sur la dette de l'Argentine. Le marché des CDS (credit default swap) a entraîné une restructuration des dettes en l'absence de transparence, ce qui n'incite pas à négocier de bonne foi.
Il est paradoxal que des pays comme les USA soient réticents à adopter un cadre juridique international parce que cela entamerait leur souveraineté. La communauté internationale a reconnu comme principe fondamental le respect de l'immunité des Etats : il existe des limites que les marchés – et les Etats – ne peuvent franchir.
Un gouvernement peut avoir la tentation d'abandonner cette immunité en échange de meilleures conditions de financement à court terme - avec un prix à payer bien plus important pour ses successeurs. Aucun gouvernement ne devrait avoir le droit de renoncer à l'immunité souveraine, de même que personne n'a le droit de se vendre comme esclave.
La restructuration des dettes n'est pas un jeu à somme nulle. Le cadre juridique d'une restructuration détermine non seulement la répartition des parts de gâteau entre les créanciers reconnus et entre ces derniers et les créanciers de fait, mais aussi la taille du gâteau. Les législations nationales sur les faillites ont évolué parce qu'il est contre-productif de mettre en prison un débiteur insolvable : un prisonnier ne peut pas rembourser ses dettes. De même, imposer des conditions abusives à un pays endetté aggrave sa situation : si son économie se retrouve en chute libre, il sera dans l'incapacité de rembourser.
Un système qui permet de résoudre les crises de dettes souveraines doit être fondé sur des principes tels que le gâteau soit le plus grand possible et qu'il soit partagé équitablement. La communauté internationale a adopté les principes voulus ; il reste à construire le système.
Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz
Joseph Stiglitz est professeur à l'université de Columbia à New-York et économiste à l'Institut Roosevelt. Il est prix Nobel d'économie. Martin Guzman est chercheur au département d'économie et de finance de la faculté de gestion de l'université de Columbia et co-président de l'Initiative de Columbia en faveur d'un Groupe de travail sur la restructuration des dettes et faillites souveraines (Columbia Initiative for Policy Dialogue Taskforce on Debt Restructuring and Sovereign Bankruptcy). Il est également membre du Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale (CIGI).
Ces principes constituent les bases d'une législation internationale efficace. Ils bénéficient d'un très large soutien, 136 pays ayant voté en leur faveur et seulement 6 contre (avec à leur tête les USA), ce qui traduit la reconnaissance quasi général de la nécessité de résoudre en temps voulu les crises liées aux dettes souveraines. Mais l'étape suivante (un traité international créant un cadre juridique contraignant pour tous les pays) pourrait s'avérer beaucoup plus difficile.
De récents événements soulignent les énormes risques liés à l'absence d'une législation applicable à la restructuration des dettes souveraines. Ainsi la crise de la dette de Porto Rico ne peut être résolue, notamment parce que les tribunaux américains ont abrogé la loi de ce territoire en matière de faillite. Ils ont jugé que l'île étant de fait une colonie des USA, son gouvernement n'a pas autorité pour promulguer sa propre législation.
Dans le cas de l'Argentine, un tribunal de New-York a autorisé une petite minorité de "fonds vautours" à mettre en danger une restructuration approuvée par 92,4% des créanciers du pays. Dans le cas de la Grèce, c'est aussi en grande partie l'absence d'une législation internationale qui a permis à ses créanciers – la troïka constituée par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI – de lui imposer une politique qui lui a été néfaste.
Mais certaines organisations dotées de pouvoirs importants ne sont pas loin d'établir un cadre juridique international. L'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA), soutenue par le FMI et par le Trésor américain, propose de modifier le vocabulaire des contrats de prêt. Le point clé de sa proposition consiste à améliorer les clauses d'action collective. Un processus de restructuration approuvé par une forte majorité de créanciers serait alors contraignant pour tous les autres.
Cela compliquerait sûrement la vie des fonds vautours, mais ce n'est pas une solution d'ensemble. Régler au plus fin les contrats de prêt ne résout pas des problèmes cruciaux. D'une certaine façon, cela pérennise les défauts du système actuel – voire même les aggrave.
Ainsi la proposition de l'ICMA laisse sans réponse la question de savoir comment résoudre un conflit lorsque des obligations sont émises dans des cadres juridiques différents et dépendent de juridictions différentes. Le droit des contrats est efficace lorsqu'il y a une seule classe d'obligations ; mais lorsqu'elles sont émises dans des juridictions différentes et en devises différentes, la proposition de l'ICMA ne résout pas le difficile problème de l'agrégation : comment pondérer le vote des différents requérants ?
Par ailleurs, la proposition de l'ICMA favorise une collusion entre les principaux centres financiers : pour activer les clauses d'action collective, seuls compteraient les votes des créanciers détenteurs d'obligations provenant d'un ensemble limité de juridictions. Et cette proposition ne remédie pas à l'inégalité de traitement entre créanciers reconnus et créanciers de fait (les retraités et les travailleurs dont les débiteurs ont d'autres obligations prioritaires) qui n'auraient pas droit au chapitre quant à une restructuration.
Les 6 pays qui ont voté contre la résolution de l'ONU (les USA, le Canada, l'Allemagne, Israël, le Japon et le Royaume-Uni) disposent d'une législation sur les faillites, car ils estiment que les clauses d'action collective ne sont pas suffisantes. Pourtant ils ne veulent pas qu'une législation nationale s'applique au niveau international. Ils s'opposent notamment aux dispositions destinées à protéger les emprunteurs en position de faiblesse contre des créanciers puissants, prêts à abuser de leur pouvoir. C'est peut-être parce que ce sont tous d'importants pays créanciers qui ne veulent pas de limitation de leur pouvoir.
Les 9 principes de l'ONU ont été bafoués au cours des dernières décennies. En 2012 par exemple, la restructuration de la dette grecque n'a pas restauré la durabilité, puisqu'il a fallu procéder à une nouvelle restructuration seulement 3 ans plus tard. Le non-respect de l'immunité des Etats et du traitement équitable des créanciers est devenu quasiment la norme, comme l'a montré la décision du tribunal de New-York sur la dette de l'Argentine. Le marché des CDS (credit default swap) a entraîné une restructuration des dettes en l'absence de transparence, ce qui n'incite pas à négocier de bonne foi.
Il est paradoxal que des pays comme les USA soient réticents à adopter un cadre juridique international parce que cela entamerait leur souveraineté. La communauté internationale a reconnu comme principe fondamental le respect de l'immunité des Etats : il existe des limites que les marchés – et les Etats – ne peuvent franchir.
Un gouvernement peut avoir la tentation d'abandonner cette immunité en échange de meilleures conditions de financement à court terme - avec un prix à payer bien plus important pour ses successeurs. Aucun gouvernement ne devrait avoir le droit de renoncer à l'immunité souveraine, de même que personne n'a le droit de se vendre comme esclave.
La restructuration des dettes n'est pas un jeu à somme nulle. Le cadre juridique d'une restructuration détermine non seulement la répartition des parts de gâteau entre les créanciers reconnus et entre ces derniers et les créanciers de fait, mais aussi la taille du gâteau. Les législations nationales sur les faillites ont évolué parce qu'il est contre-productif de mettre en prison un débiteur insolvable : un prisonnier ne peut pas rembourser ses dettes. De même, imposer des conditions abusives à un pays endetté aggrave sa situation : si son économie se retrouve en chute libre, il sera dans l'incapacité de rembourser.
Un système qui permet de résoudre les crises de dettes souveraines doit être fondé sur des principes tels que le gâteau soit le plus grand possible et qu'il soit partagé équitablement. La communauté internationale a adopté les principes voulus ; il reste à construire le système.
Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz
Joseph Stiglitz est professeur à l'université de Columbia à New-York et économiste à l'Institut Roosevelt. Il est prix Nobel d'économie. Martin Guzman est chercheur au département d'économie et de finance de la faculté de gestion de l'université de Columbia et co-président de l'Initiative de Columbia en faveur d'un Groupe de travail sur la restructuration des dettes et faillites souveraines (Columbia Initiative for Policy Dialogue Taskforce on Debt Restructuring and Sovereign Bankruptcy). Il est également membre du Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale (CIGI).
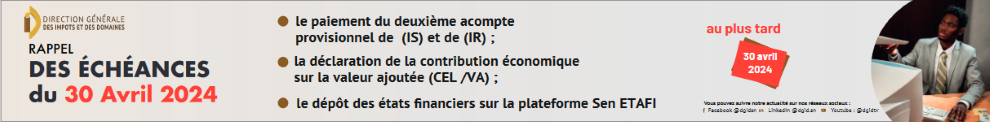


 chroniques
chroniques





















