Le même problème hante l'hypothèse de Bernanke, selon laquelle la croissance lente reflète un « excès d'épargne mondiale. » D'un point de vue keynésien, une augmentation de l'épargne ne peut pas expliquer le regain d'activité que le monde a connu au début des années 2000.
Les partisans de l'hypothèse de la stagnation séculaire ont apparemment identifié le mauvais problème. Du point de vue réellement séculaire et mondial, la difficulté réside dans l'explication du boom d'avant la crise. Plus précisément, il se trouve dans l'explication de la conjonction de trois grands développements mondiaux : une accélération de la croissance (pas une stagnation), une baisse de l'inflation et une réduction des taux d'intérêt réels (indexés sur l'inflation). Toute explication convaincante de ces trois développements doit minimiser l'importance d'un cadre global à la demande pure et se concentrer sur la hausse des marchés émergents, notamment celui de la Chine.
Essentiellement, le monde a connu un grand choc de productivité positif émanant des marchés émergents, qui ont accéléré la croissance mondiale tout en renforçant les pressions désinflationnistes déjà été mises en branle par la Grande modération de la volatilité du cycle conjoncturel. Cette évolution cruciale permet de concilier deux principales évolutions mondiales sur trois : une croissance plus rapide et une inflation plus faible.
Le véritable casse-tête consiste alors à concilier l'augmentation de la croissance de la productivité mondiale, avec la baisse des taux d'intérêt réels. Bernanke a souligné à juste titre le fait que les taux d'intérêt réels à long terme sont déterminés par la croissance réelle. Donc le choc de productivité positif aurait dû augmenter le rendement du capital et par conséquent l'équilibre des taux d'intérêt réels. En outre, cette tendance aurait dû être accentuée par le fait que le choc de productivité reflète une baisse du rapport capital/travail mondial, impliqué par l'intégration des travailleurs chinois et indiens dans l'économie mondiale. Mais cela n'a pas été le cas. Au lieu de cela, les taux d'intérêt réels mondiaux ont diminué.
Deux traits distinctifs du choc de productivité sur les marchés émergents sont essentiels pour comprendre cette énigme : ce phénomène a été gourmand en ressources et mercantiliste à son origine et dans ses suites. Ces deux caractéristiques ont augmenté l'épargne mondiale.
Tout d'abord, parce que les grands pays relativement pauvres (l'Inde et surtout la Chine), ont été les moteurs de la croissance mondiale et ont été gourmands en ressources, les prix mondiaux du pétrole ont grimpé. Ce fait a redistribué les revenus mondiaux vers les pays ayant une plus forte propension à l'épargne : les pays exportateurs de pétrole.
Les politiques mercantilistes se sont avérées encore plus déterminantes. La Chine et d'autres pays émergents ont poursuivi une stratégie économique qui a défié les principes standards de croissance et la théorie du développement. La croissance mercantiliste s'est fondée (et dans une certaine mesure a nécessité) une volonté de faire sortir le capital, plutôt que de l'attirer. En limitant entrées de capitaux étrangers et en maintenant de faibles taux d'intérêt nationaux, la Chine a réussi à maintenir une monnaie relativement faible, qui a servi à maintenir son modèle de croissance par les exportations. Cela a conduit à d'énormes excédents sur ses comptes courants (plus de 10% du PIB à un moment donné), ce qui a créé des flux de capitaux vers le reste du monde.
Reconnaître l'importance de cette stratégie révèle une erreur commune, selon laquelle la surabondance d'épargne mondiale est attribuée à la volonté des pays des marchés émergents de se prémunir contre la crise financière par l'acquisition de réserves en dollars. Cela a peut-être été vrai dans le sillage immédiat de la crise financière asiatique à la fin des années 1990, mais ce mécanisme a été rapidement dépassé par l'impératif de croissance. En d'autres termes, le motif d'auto-assurance pourrait expliquer le premier milliard de dollars des réserves obligataires de la Chine, mais cela n'a rien à voir avec les trois milliards de dollars suivants.
Ce qui a contribué davantage à la surabondance de l'épargne a été la croissance elle-même. Comme les revenus ont augmenté, les Asiatiques déjà prudents sont devenus encore plus prudents et les entreprises rentables sont devenues encore plus rentables. Cette réponse endogène à la croissance rapide de la productivité a été un facteur clé qui a contribué à la surabondance d'épargne. Il a fallu remettre en question d'anciennes vérités sur le développement, parce que dans une certaine mesure, la croissance des marchés émergents a produit de l'épargne.
C'est là que se trouve l'explication de l'énigme des taux d'intérêt. Comme l'épargne (et donc l'offre mondiale de fonds prêtables) a augmenté, les taux réels ont subi une pression à la baisse. Les faibles taux, à leur tour, ont fourni la lubrification nécessaire pour financer la bulle d'actifs aux États-Unis et ailleurs. D'après Summers, l'épargne élevée a entraîné une croissance faible. Selon l'explication alternative proposée ici, c'est surtout une croissance rapide (et ses traits distinctifs), qui ont produit une épargne importante.
Aujourd'hui, alors que la croissance mondiale ralentit, la stagnation séculaire semble à nouveau plausible. Mais la stagnation séculaire est une maladie des pays à la frontière économique. Pour le reste du monde en développement, le vrai souci n'est pas une demande insuffisante : c'est le besoin de maintenir des taux élevés de croissance de la productivité, afin de pouvoir rattraper les économies avancées. A l'heure où les responsables politiques se réunissent à Washington pour leurs conversations rituelles cette semaine, ils ne doivent pas perdre de vue cette distinction cruciale.
Arvind Subramanian est Conseiller économique en chef au ministère des Finances de l'Inde.
Les partisans de l'hypothèse de la stagnation séculaire ont apparemment identifié le mauvais problème. Du point de vue réellement séculaire et mondial, la difficulté réside dans l'explication du boom d'avant la crise. Plus précisément, il se trouve dans l'explication de la conjonction de trois grands développements mondiaux : une accélération de la croissance (pas une stagnation), une baisse de l'inflation et une réduction des taux d'intérêt réels (indexés sur l'inflation). Toute explication convaincante de ces trois développements doit minimiser l'importance d'un cadre global à la demande pure et se concentrer sur la hausse des marchés émergents, notamment celui de la Chine.
Essentiellement, le monde a connu un grand choc de productivité positif émanant des marchés émergents, qui ont accéléré la croissance mondiale tout en renforçant les pressions désinflationnistes déjà été mises en branle par la Grande modération de la volatilité du cycle conjoncturel. Cette évolution cruciale permet de concilier deux principales évolutions mondiales sur trois : une croissance plus rapide et une inflation plus faible.
Le véritable casse-tête consiste alors à concilier l'augmentation de la croissance de la productivité mondiale, avec la baisse des taux d'intérêt réels. Bernanke a souligné à juste titre le fait que les taux d'intérêt réels à long terme sont déterminés par la croissance réelle. Donc le choc de productivité positif aurait dû augmenter le rendement du capital et par conséquent l'équilibre des taux d'intérêt réels. En outre, cette tendance aurait dû être accentuée par le fait que le choc de productivité reflète une baisse du rapport capital/travail mondial, impliqué par l'intégration des travailleurs chinois et indiens dans l'économie mondiale. Mais cela n'a pas été le cas. Au lieu de cela, les taux d'intérêt réels mondiaux ont diminué.
Deux traits distinctifs du choc de productivité sur les marchés émergents sont essentiels pour comprendre cette énigme : ce phénomène a été gourmand en ressources et mercantiliste à son origine et dans ses suites. Ces deux caractéristiques ont augmenté l'épargne mondiale.
Tout d'abord, parce que les grands pays relativement pauvres (l'Inde et surtout la Chine), ont été les moteurs de la croissance mondiale et ont été gourmands en ressources, les prix mondiaux du pétrole ont grimpé. Ce fait a redistribué les revenus mondiaux vers les pays ayant une plus forte propension à l'épargne : les pays exportateurs de pétrole.
Les politiques mercantilistes se sont avérées encore plus déterminantes. La Chine et d'autres pays émergents ont poursuivi une stratégie économique qui a défié les principes standards de croissance et la théorie du développement. La croissance mercantiliste s'est fondée (et dans une certaine mesure a nécessité) une volonté de faire sortir le capital, plutôt que de l'attirer. En limitant entrées de capitaux étrangers et en maintenant de faibles taux d'intérêt nationaux, la Chine a réussi à maintenir une monnaie relativement faible, qui a servi à maintenir son modèle de croissance par les exportations. Cela a conduit à d'énormes excédents sur ses comptes courants (plus de 10% du PIB à un moment donné), ce qui a créé des flux de capitaux vers le reste du monde.
Reconnaître l'importance de cette stratégie révèle une erreur commune, selon laquelle la surabondance d'épargne mondiale est attribuée à la volonté des pays des marchés émergents de se prémunir contre la crise financière par l'acquisition de réserves en dollars. Cela a peut-être été vrai dans le sillage immédiat de la crise financière asiatique à la fin des années 1990, mais ce mécanisme a été rapidement dépassé par l'impératif de croissance. En d'autres termes, le motif d'auto-assurance pourrait expliquer le premier milliard de dollars des réserves obligataires de la Chine, mais cela n'a rien à voir avec les trois milliards de dollars suivants.
Ce qui a contribué davantage à la surabondance de l'épargne a été la croissance elle-même. Comme les revenus ont augmenté, les Asiatiques déjà prudents sont devenus encore plus prudents et les entreprises rentables sont devenues encore plus rentables. Cette réponse endogène à la croissance rapide de la productivité a été un facteur clé qui a contribué à la surabondance d'épargne. Il a fallu remettre en question d'anciennes vérités sur le développement, parce que dans une certaine mesure, la croissance des marchés émergents a produit de l'épargne.
C'est là que se trouve l'explication de l'énigme des taux d'intérêt. Comme l'épargne (et donc l'offre mondiale de fonds prêtables) a augmenté, les taux réels ont subi une pression à la baisse. Les faibles taux, à leur tour, ont fourni la lubrification nécessaire pour financer la bulle d'actifs aux États-Unis et ailleurs. D'après Summers, l'épargne élevée a entraîné une croissance faible. Selon l'explication alternative proposée ici, c'est surtout une croissance rapide (et ses traits distinctifs), qui ont produit une épargne importante.
Aujourd'hui, alors que la croissance mondiale ralentit, la stagnation séculaire semble à nouveau plausible. Mais la stagnation séculaire est une maladie des pays à la frontière économique. Pour le reste du monde en développement, le vrai souci n'est pas une demande insuffisante : c'est le besoin de maintenir des taux élevés de croissance de la productivité, afin de pouvoir rattraper les économies avancées. A l'heure où les responsables politiques se réunissent à Washington pour leurs conversations rituelles cette semaine, ils ne doivent pas perdre de vue cette distinction cruciale.
Arvind Subramanian est Conseiller économique en chef au ministère des Finances de l'Inde.
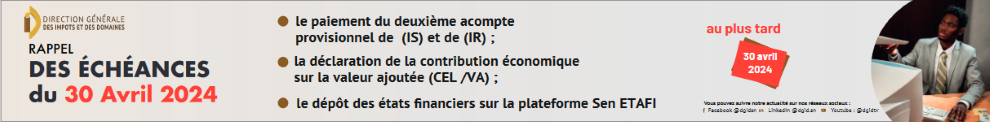


 chroniques
chroniques






















