
Jeffrey D. Sachs est professeur de développement durable, professeur en politique et gestion de la santé, et directeur du Earth Institute de l’Université de Columbia
Bien que le QE ne permette pas de générer une croissance à long terme, cette politique peut considérablement dégager le chemin vers la fin de cette récession qui affecte la zone euro depuis 2008. Le marchés boursiers européens, exceptionnellement élevés cette semaine dans un contexte d’anticipation du QE, indiquent en effet non seulement une confiance croissante, mais constituent également un canal direct via lequel l’assouplissement monétaire peut dynamiser à la fois l’investissement et la consommation.
Un certain nombre d’observateurs, tels que le prix Nobel Paul Krugman et l’ancien Secrétaire du Trésor américain Larry Summers, continuent toutefois de douter de l’efficacité du QE. Comme l’a récemment fait valoir Krugman, un « vortex déflationniste » pèserait sur l’économie mondiale, la chute des prix entraînant une inéluctable spirale baissière de la demande. Des propos dont semblent convenir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tous deux ayant dernièrement revu légèrement à la baisse leurs prévisions de croissance.
Les pessimistes évoquent une économie mondiale si souffrante de l’insurmontable pénurie de la demande globale qu’il s’agirait de parler de nouvelle « stagnation séculaire. » Ils considèrent la politique monétaire comme relativement inefficace, en raison de la fameuse borne inférieure zéro (ou ZLB, pour zero lower bound) sur les taux d’intérêt nominaux. L’argument consiste à affirmer que dans la mesure où les taux d’intérêt directeurs avoisinent le zéro, les banques centrales seraient plus ou moins incapables d’échapper au vortex déflationniste, et les économies se retrouveraient prises dans le fameux piège de la liquidité. Dans un tel scénario, l’insuffisance de la demande s’autoalimente, poussant les prix à la baisse, provoquant la hausse des taux d’intérêts réels (ajusté à l’inflation) et réduisant encore davantage la demande.
Ce point de vue domine depuis 2008 chez les économistes keynésiens d’Amérique et du Royaume-Uni. Selon Krugman, le Japon serait tout simplement le premier d’une longue liste d’économies majeures vouées à succomber à la déflation chronique, comme lui dans les années 1990, et serait actuellement suivi par l’Union européenne, la Chine, et plus récemment la Suisse, qui connaît une montée en flèche de son franc ainsi qu’une chute des prix. Toujours selon cette conception, les États-Unis demeureraient également proches du vortex, conduisant les keynésiens à préconiser fréquemment davantage de relance budgétaire, laquelle, à la différence de la politique monétaire, est considérée par les pessimistes comme particulièrement efficace en présence de la ZLB.
J’estime pour ma part que les pessimistes exagèrent les risques de la déflation, ce que confirme l’erreur de leurs dernières prévisions. Plus révélateur encore, ils n’ont pas su prédire le rebond observé à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, caractérisé par une hausse de la croissance et une diminution du chômage malgré une résorption des déficits. À défaut d’un diagnostic précis de la crise de 2008, aucun traitement efficace ne peut être prescrit.
Cette école pessimiste fait valoir un fort déclin de la volonté d’investir, dans la lignée de cette perte des « esprits animaux » que décrit Keynes. Selon elle, même en présence de taux d’intérêt extrêmement faibles, la demande d’investissement est vouée à demeurer au plus bas, la demande globale restant par conséquent inefficace. La déflation aggraverait encore la situation, le fossé de la demande ne pouvant alors être comblé que par d’importants déficits budgétaires.
Or, les causes du ralentissement profond de 2008 sont beaucoup plus spécifiques, et nécessitent des solutions beaucoup plus ciblées. La crise de 2008 a été précédée d’une importante bulle immobilière dans les pays les plus durement touchés (États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal et Italie). Comme l’a expliqué Friedrich Hayek dès les années 1930, un certain temps est nécessaire à la résolution des conséquences d’un tel phénomène d’investissement mal avisé, dans la mesure où lui succède une surabondance de capitaux spécifiques (en l’occurrence les logements).
Mais plus dévastatrice encore que cette bulle immobilière, il faut citer cette panique financière qui a envahi les marchés de capitaux à la suite de l’effondrement de Lehman Brothers. La décision prise par la Réserve fédérale et par le Trésor américain consistant à donner une leçon aux marchés en laissant Lehman faire faillite s’est révélée absolument désastreuse. Elle a engendré une panique brutale et profonde, obligeant les banques centrales à jouer leur rôle fondamental de prêteur de dernier recours.
Là où la Fed s’est montrée extrêmement peu performante au cours des années ayant précédé l’effondrement de Lehman Brothers, elle s’est en revanche brillamment comportée après l’événement, en inondant les marchés de liquidité afin de rompre la panique. C’est également ce qu’a fait la Banque d’Angleterre, toutefois un peu plus lente à réagir.
Sans surprise, ce sont la Banque du Japon et la BCE qui ont réagi le moins rapidement, maintenant plus longtemps leurs forts taux directeurs, et n’envisageant que tardivement la mise en œuvre du QE et d’autres mesures de liquidité extraordinaires. Il a en effet fallu attendre l’arrivée d’un nouveau dirigeant à la tête de ces deux institutions – Haruhiko Kuroda à la BDJ et Mario Draghi à la BCE – pour que la bonne politique monétaire soit enfin appliquée.
La bonne nouvelle, c’est que même aux alentours de la ZLB, la politique monétaire fonctionne. Le QE élève le prix des capitaux, abaisse les taux d’intérêt à long terme, favorise une dépréciation des monnaies, et atténue la contraction du crédit, même en présence de taux d’intérêt proches de zéro. Ce n’est pas d’une pénurie d’outils réflationnistes dont ont souffert la BCE et la BDJ, mais bien d’un manque d’action appropriée.
S’il faut voir une bonne nouvelle dans l’efficacité de la politique monétaire, c’est parce que la relance budgétaire constitue un piètre instrument de gestion de la demande à court terme. Aspect ironique, c’est ce qu’expliquait Krugman dans une importante publication de 1998. Il avait fait valoir à l’époque, selon moi à juste titre, que les transferts et réductions d’impôts à court terme se retrouveraient dans l’épargne, et ne seraient donc pas dépensés, et que les dettes publiques se multiplieraient et jetteraient une ombre à long terme sur l’équilibre budgétaire et l’économie. Malgré des taux d’intérêts actuellement faibles, avait-il précisé, ces taux seraient voués à augmenter, accentuant encore davantage le fardeau du remboursement de la dette en plus de la dette nouvellement accumulée.
Tandis que les plus grandes banques centrales appliquent désormais des politiques monétaires expansionnistes, que les prix du pétrole diminuent considérablement, et à l’heure où la révolution des technologies de l’information promet de nombreuses opportunités d’investissement, les perspectives de croissance économique pour 2015 et au-delà apparaissent plus favorables que dans les prévisions des pessimistes. Les profits sont en hausse, il existe de raisonnables perspectives d’investissement pour les entreprises, un important retard de dépenses en infrastructure quasiment partout en Europe et aux États-Unis, ainsi qu’une opportunité de financer des exportations de biens d’équipement vers les régions à faible revenu telles que l’Afrique subsaharienne, et de répondre aux besoins mondiaux en investissements dans un système énergétique novateur et faiblement émetteur de carbone.
S’il existe une pénurie d’investissements privés, le problème ne réside pas tant dans un manque de projets intéressants que dans un manque de clarté des politiques et de complémentarité des investissements publics à long terme. C’est pourquoi la volonté du président de la Commission Jean-Claude Junker de financer des investissements à long terme en Europe, en mobilisant un volume de fonds publics relativement réduit afin de déverrouiller de larges flux de capitaux privés, constitue une étape importante dans la bonne direction.
De toute évidence, il ne faut pas sous-estimer la capacité des dirigeants politiques à changer une situation défavorable en un contexte encore plus catastrophique (songez à la pression imposée à la Grèce afin que le pays rembourse sa dette au-delà des limites de la tolérance sociale). Nous devons toutefois comprendre que les principales menaces pour la croissance cette année – persistance de la crise de la dette grecque, conflit entre la Russie et l’Ukraine, et troubles au sein du Moyen-Orient – sont de nature davantage géopolitique que macroéconomique. En 2015, sagesse diplomatique et intelligence des politiques monétaires peuvent nous permettre de tracer un chemin vers la prospérité. À condition que nous sachions gérer ces deux exercices, la reprise généralisée est à notre portée.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Jeffrey D. Sachs est professeur de développement durable, professeur en politique et gestion de la santé, et directeur du Earth Institute de l’Université de Columbia. Il est également conseiller spécial auprès du Secrétaire général des Nations Unies sur la question des Objectifs du millénaire pour le développement.
Un certain nombre d’observateurs, tels que le prix Nobel Paul Krugman et l’ancien Secrétaire du Trésor américain Larry Summers, continuent toutefois de douter de l’efficacité du QE. Comme l’a récemment fait valoir Krugman, un « vortex déflationniste » pèserait sur l’économie mondiale, la chute des prix entraînant une inéluctable spirale baissière de la demande. Des propos dont semblent convenir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tous deux ayant dernièrement revu légèrement à la baisse leurs prévisions de croissance.
Les pessimistes évoquent une économie mondiale si souffrante de l’insurmontable pénurie de la demande globale qu’il s’agirait de parler de nouvelle « stagnation séculaire. » Ils considèrent la politique monétaire comme relativement inefficace, en raison de la fameuse borne inférieure zéro (ou ZLB, pour zero lower bound) sur les taux d’intérêt nominaux. L’argument consiste à affirmer que dans la mesure où les taux d’intérêt directeurs avoisinent le zéro, les banques centrales seraient plus ou moins incapables d’échapper au vortex déflationniste, et les économies se retrouveraient prises dans le fameux piège de la liquidité. Dans un tel scénario, l’insuffisance de la demande s’autoalimente, poussant les prix à la baisse, provoquant la hausse des taux d’intérêts réels (ajusté à l’inflation) et réduisant encore davantage la demande.
Ce point de vue domine depuis 2008 chez les économistes keynésiens d’Amérique et du Royaume-Uni. Selon Krugman, le Japon serait tout simplement le premier d’une longue liste d’économies majeures vouées à succomber à la déflation chronique, comme lui dans les années 1990, et serait actuellement suivi par l’Union européenne, la Chine, et plus récemment la Suisse, qui connaît une montée en flèche de son franc ainsi qu’une chute des prix. Toujours selon cette conception, les États-Unis demeureraient également proches du vortex, conduisant les keynésiens à préconiser fréquemment davantage de relance budgétaire, laquelle, à la différence de la politique monétaire, est considérée par les pessimistes comme particulièrement efficace en présence de la ZLB.
J’estime pour ma part que les pessimistes exagèrent les risques de la déflation, ce que confirme l’erreur de leurs dernières prévisions. Plus révélateur encore, ils n’ont pas su prédire le rebond observé à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, caractérisé par une hausse de la croissance et une diminution du chômage malgré une résorption des déficits. À défaut d’un diagnostic précis de la crise de 2008, aucun traitement efficace ne peut être prescrit.
Cette école pessimiste fait valoir un fort déclin de la volonté d’investir, dans la lignée de cette perte des « esprits animaux » que décrit Keynes. Selon elle, même en présence de taux d’intérêt extrêmement faibles, la demande d’investissement est vouée à demeurer au plus bas, la demande globale restant par conséquent inefficace. La déflation aggraverait encore la situation, le fossé de la demande ne pouvant alors être comblé que par d’importants déficits budgétaires.
Or, les causes du ralentissement profond de 2008 sont beaucoup plus spécifiques, et nécessitent des solutions beaucoup plus ciblées. La crise de 2008 a été précédée d’une importante bulle immobilière dans les pays les plus durement touchés (États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal et Italie). Comme l’a expliqué Friedrich Hayek dès les années 1930, un certain temps est nécessaire à la résolution des conséquences d’un tel phénomène d’investissement mal avisé, dans la mesure où lui succède une surabondance de capitaux spécifiques (en l’occurrence les logements).
Mais plus dévastatrice encore que cette bulle immobilière, il faut citer cette panique financière qui a envahi les marchés de capitaux à la suite de l’effondrement de Lehman Brothers. La décision prise par la Réserve fédérale et par le Trésor américain consistant à donner une leçon aux marchés en laissant Lehman faire faillite s’est révélée absolument désastreuse. Elle a engendré une panique brutale et profonde, obligeant les banques centrales à jouer leur rôle fondamental de prêteur de dernier recours.
Là où la Fed s’est montrée extrêmement peu performante au cours des années ayant précédé l’effondrement de Lehman Brothers, elle s’est en revanche brillamment comportée après l’événement, en inondant les marchés de liquidité afin de rompre la panique. C’est également ce qu’a fait la Banque d’Angleterre, toutefois un peu plus lente à réagir.
Sans surprise, ce sont la Banque du Japon et la BCE qui ont réagi le moins rapidement, maintenant plus longtemps leurs forts taux directeurs, et n’envisageant que tardivement la mise en œuvre du QE et d’autres mesures de liquidité extraordinaires. Il a en effet fallu attendre l’arrivée d’un nouveau dirigeant à la tête de ces deux institutions – Haruhiko Kuroda à la BDJ et Mario Draghi à la BCE – pour que la bonne politique monétaire soit enfin appliquée.
La bonne nouvelle, c’est que même aux alentours de la ZLB, la politique monétaire fonctionne. Le QE élève le prix des capitaux, abaisse les taux d’intérêt à long terme, favorise une dépréciation des monnaies, et atténue la contraction du crédit, même en présence de taux d’intérêt proches de zéro. Ce n’est pas d’une pénurie d’outils réflationnistes dont ont souffert la BCE et la BDJ, mais bien d’un manque d’action appropriée.
S’il faut voir une bonne nouvelle dans l’efficacité de la politique monétaire, c’est parce que la relance budgétaire constitue un piètre instrument de gestion de la demande à court terme. Aspect ironique, c’est ce qu’expliquait Krugman dans une importante publication de 1998. Il avait fait valoir à l’époque, selon moi à juste titre, que les transferts et réductions d’impôts à court terme se retrouveraient dans l’épargne, et ne seraient donc pas dépensés, et que les dettes publiques se multiplieraient et jetteraient une ombre à long terme sur l’équilibre budgétaire et l’économie. Malgré des taux d’intérêts actuellement faibles, avait-il précisé, ces taux seraient voués à augmenter, accentuant encore davantage le fardeau du remboursement de la dette en plus de la dette nouvellement accumulée.
Tandis que les plus grandes banques centrales appliquent désormais des politiques monétaires expansionnistes, que les prix du pétrole diminuent considérablement, et à l’heure où la révolution des technologies de l’information promet de nombreuses opportunités d’investissement, les perspectives de croissance économique pour 2015 et au-delà apparaissent plus favorables que dans les prévisions des pessimistes. Les profits sont en hausse, il existe de raisonnables perspectives d’investissement pour les entreprises, un important retard de dépenses en infrastructure quasiment partout en Europe et aux États-Unis, ainsi qu’une opportunité de financer des exportations de biens d’équipement vers les régions à faible revenu telles que l’Afrique subsaharienne, et de répondre aux besoins mondiaux en investissements dans un système énergétique novateur et faiblement émetteur de carbone.
S’il existe une pénurie d’investissements privés, le problème ne réside pas tant dans un manque de projets intéressants que dans un manque de clarté des politiques et de complémentarité des investissements publics à long terme. C’est pourquoi la volonté du président de la Commission Jean-Claude Junker de financer des investissements à long terme en Europe, en mobilisant un volume de fonds publics relativement réduit afin de déverrouiller de larges flux de capitaux privés, constitue une étape importante dans la bonne direction.
De toute évidence, il ne faut pas sous-estimer la capacité des dirigeants politiques à changer une situation défavorable en un contexte encore plus catastrophique (songez à la pression imposée à la Grèce afin que le pays rembourse sa dette au-delà des limites de la tolérance sociale). Nous devons toutefois comprendre que les principales menaces pour la croissance cette année – persistance de la crise de la dette grecque, conflit entre la Russie et l’Ukraine, et troubles au sein du Moyen-Orient – sont de nature davantage géopolitique que macroéconomique. En 2015, sagesse diplomatique et intelligence des politiques monétaires peuvent nous permettre de tracer un chemin vers la prospérité. À condition que nous sachions gérer ces deux exercices, la reprise généralisée est à notre portée.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Jeffrey D. Sachs est professeur de développement durable, professeur en politique et gestion de la santé, et directeur du Earth Institute de l’Université de Columbia. Il est également conseiller spécial auprès du Secrétaire général des Nations Unies sur la question des Objectifs du millénaire pour le développement.
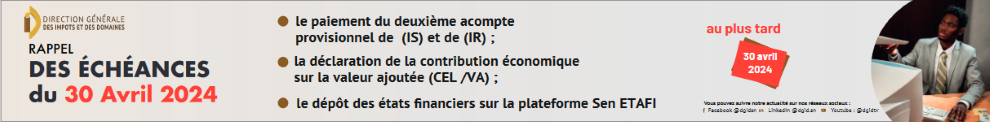


 chroniques
chroniques





















